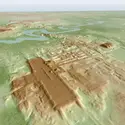PRÉCOLOMBIENS Méso-Amérique
Article modifié le
Les musiques amérindiennes
Les Amériques – la géographie et l'histoire distinguent l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et le domaine caraïbe – possèdent une histoire très ancienne. Des recherches anthropologiques ont précisé les origines du peuplement américain par l'Alaska et posé le problème des migrations d'Africains, de Mélanésiens et de Polynésiens. La diversité impressionnante des langues, des traditions culturelles et des civilisations amène la question : existe-t-il un dénominateur commun aux cultures des Amériques ? La musique, répondent les Cubains Alejo Carpentier et Walterio Carbonnell. Qu'on la dénomme folklore, qu'elle ressortisse à la musicologie comparative ou à l' ethnomusicologie, la musique de chacune des cultures américaines a une histoire, une théorie, une esthétique. S'interroger sur ces musiques, c'est se mettre « à l'affût de secrets essentiels », observe l'ethnomusicologue roumain Constantin Brăiloiu (1893-1958), qui a le premier porté des coups décisifs à la perspective européocentriste.
La musique des Amériques comporte trois composantes : un élément endogène, amérindien, des apports africains et des apports européens – essentiellement portugais, espagnols, anglais, néerlandais et français. On a jugé « primitif » le fond amérindien, et les « folkloristes » ont préféré souligner la place prééminente tenue par la musique européenne. Or un primitivisme implique des sociétés arriérées, ce qui est loin d'être l'opinion des historiens et des archéologues qui ont étudié les civilisations précolombiennes. Brăiloiu a fait remarquer, après l'Allemand Carl Stumpf (1848-1936), que les chants amérindiens « supposent une gestion millénaire et se placent, dans le temps, infiniment plus loin d'un état original de la musique que de notre art musical présent ». Quant à la musique africaine, les musicologues ont depuis longtemps montré ses richesses harmoniques, polyphoniques, rythmiques et instrumentales (Joseph H. Kwabena Nketia et Lazarus E. N. Ekwueme).
L'influence européenne s'est exercée, par le biais de la colonisation, à partir du xvie siècle : les éléments portugais au Brésil, l'élément espagnol dans le reste de l'Amérique du Sud, en Amérique centrale et aux Caraïbes, l'élément anglais et néerlandais en Amérique du Nord, l'élément français en Louisiane, au Québec et dans certaines îles. La composante africaine, introduite par la traite des Noirs, s'est répandue dans les territoires qui ont vu se développer le système esclavagiste, du xvie au xixe siècle. On observe sur le terrain, suivant l'évolution des populations, des cas de fusion musicale, des invariants ou des combinaisons parfois difficiles à démêler.
Les instruments
Grâce aux fresques mayas de Bonampak (dans le sud du Yucatán), aux monolithes de San Agustín (Colombie), aux codex et aux témoignages des premiers chroniqueurs de la conquête (Bernardino de Sahagún, Fernández de Oviedo, Tomás de Torquemada), on connaît assez précisément l'ancien orchestre des indigènes. Les ethnomusicologues ont établi l'homogénéité de l'ensemble instrumental dans un espace qui s'étend du Guatemala à la Colombie, au Venezuela et à la région amazonienne. De 1948 à 1950, une mission a étudié particulièrement les musiques maya et karib. Les recherches n'ont fait que confirmer ce qu'on savait déjà implicitement depuis 1920 : on ne devait plus séparer l'archéologie de l'ethnomusicologie des Amériques, l'homme de sa musique et de son histoire.
Sans doute les plus anciens, les instruments à percussion avaient pour fonction rythmique de scander la danse et d'accompagner les chants. Les Maya et les Aztèques semblent avoir employé de nombreuses variétés de crécelles, de racleurs et de grattoirs qui se répandirent jusqu'en Colombie. Le chikawastli et l'omicikawastli étaient des tuyaux en os évidé et incisé, l'ayotl une carapace de tortue qu'on frottait avec un os ou une coquille. Les danseurs agitaient à la main des sonnailles (ayakastli), des grelots (koyoli) en métal, en bois ou en terre cuite. Les tambours occupaient une place importante dans les manifestations religieuses et dans les réjouissances. Les Maya et les Aztèques ont employé deux types de tambours : le tunkul, appelé wewetl par les Aztèques – un instrument lourd, gros cylindre de bois évidé et fermé à une extrémité par une peau séchée –, et le teponaztli. Les officiants mayas frappaient le tunkul avec des baguettes dont les extrémités portaient une petite boule d'argile recouverte de cuir ou de caoutchouc. Le son lugubre du grand wewetl des Aztèques situé près du Templo Mayor retentit dans la nuit du 30 janvier 1520 (Noche triste) pour annoncer le signal de la révolte destinée à chasser les Espagnols de Mexico. Il existait des tambours plus petits, fabriqués en bois ou en terre cuite, portés sous le bras ou bien suspendus au cou, les tlapawewetl. On les utilisait au combat pour transmettre les ordres des chefs. Le teponaztli, beaucoup plus petit que le wewetl, tenait du tambour et du xylophone. On le disposait horizontalement sur une sorte de fût, de colonne ou de tabouret qui faisait office de résonateur, l'isolait du sol et rendait le jeu des baguettes plus aisé. Une version portative, le tecomapiloa, qui comportait une calebasse comme résonateur, se plaçait sous l'aisselle. Le teponaztli, très populaire au Yucatán et au Mexique, a été signalé dans les grandes îles, à Panamá et dans la région amazonienne, où on l'appelle quiringua, tinco ou teponahuaztli. On utilise encore l'ayotl – un genre d'idiophone – dans les régions des Chiapas et de Oaxaca.
La famille des instruments à vent comprenait des conques marines (teksistli ou atekokoli), des trompes en terre cuite ou faites de calebasses, des trompettes en bois, en écorce, en argile et même en métal (bronze, or ou argent). Alexander von Humboldt a décrit la trompette sacrée (botuto), en forme de vase bi- ou triglobuleux, de la frontière du Venezuela et de la Colombie. Les indigènes Salivas de l'Orénoque employaient encore au xviiie siècle des trompes en bois ou en écorce qu'ils appelaient jurupari ou majagua. Alors que la kèna (ou quena), la flûte droite, était très populaire dans l'ancien Pérou, la flûte à bec – tlapitzali, wilakapitstli ou sosoloktli – en roseau, en os ou en argile cuite était répandue au Mexique. Il existait une grande variété de sifflets en terre cuite, flageolets minuscules ou petits ocarinas. Les plus parfaits de ces instruments, capables de donner quatre ou cinq notes, ont été trouvés chez les Maya et chez les Aztèques. Ces sifflets (tototlaptzali ou totonotzalistli en nahuatl) cherchaient à imiter le chant des oiseaux. La syrinx ou flûte de Pan était répandue en Colombie et au Brésil. Un instrument exclusivement quiché, la chirimia, une sorte de flûte-clarinette, d'origine toltèque, figurait dans la liste des attributs octroyés par Nacxit (synonyme de Quetzalcóatl-Kukulkán) aux Quiché. On joue encore de la chirimia dans les États mexicains de Puebla, Oaxaca et Veracruz. Au Pérou, il existait une variété de trompe, le pinkillu, et une sorte de tambourin, le tinya. Un instrument similaire, l'erke, en os, était utilisé en Argentine avec le siku ou antara – une flûte de Pan –, la grande trompette trutruka et le tambour caja.
Les chants et les danses
Les anciens Amérindiens associaient intimement la musique aux cérémonies religieuses ou politiques. Danses et chants se déroulaient avec un faste de costumes et une étiquette rigoureuse. Mexico possédait une sorte de conservatoire, appelé mixkoakali, où se réunissaient les danseurs et les chanteurs et où étaient regroupés les instruments de musique et les accessoires (costumes, masques, ornements). On peut avoir une idée de la beauté du spectacle de l'areyto ou mitote, cette danse chantée, par les descriptions qu'en donnèrent les chroniqueurs. Elle avait lieu sur les places des villages, après qu'on eut arrêté le choix des airs dansés. Le matin de l'exécution, on plaçait au milieu de la place, sur une grande natte, les deux tambours, wewetl et teponaztli. La danse commençait soit à l'aube, soit au milieu du jour et se prolongeait assez tard dans la nuit. Les caciques de l'île d'Ayti offrirent aux premiers Espagnols des spectacles d'areytos qui les stupéfièrent. Poétesse et musicienne, la reine Anacaona, peu avant de mourir assassinée par les conquistadores en 1498, les invita à écouter un merveilleux areyto de sa composition. On peut avoir une idée de cette forme musicale par la description qu'en a laissée Torquemada : « Lorsqu'ils veulent commencer la danse, trois ou quatre Indiens font retentir des sifflets très aigus, puis les tambours sont battus sourdement, la sonorité s'élevant peu à peu. La troupe des danseurs, en entendant le prélude des tambours, comprend quels sont le chant et la danse à interpréter, et elle les commence aussitôt. Les danses du début s'exécutent sur un ton grave, comme bémolisé[sic], et lentement, le premier étant en conformité avec la fête ; deux coryphées l'entonnent, puis tout le chœur le poursuit, chantant et dansant à la fois. Ces gens remuent les jambes aussi adroitement que les plus habiles danseurs espagnols ; et, qui plus est, le corps entier, la tête aussi bien que les bras et les mains, suit une cadence si bien réglée et concertée que l'on ne peut constater une différence d'un demi-temps dans ses mouvements ; en outre, ce que l'on fait avec le pied droit et avec le pied gauche, tous le font en même temps et en mesure. De sorte que les tambours, le chant et les danseurs ont une cadence concertée et commune qui ne diffère pas d'un iota entre les uns et les autres. »
Au Mexique, les danses sacrées, le chantunuyan et le weytecuilhuitl, servaient à invoquer le dieu du maïs. Seules subsistent encore les danses indigènes, où l'on dénote une certaine influence espagnole : ixtoles, danza de los soles, ritubari, nacoleros et xachipitzahua, accompagnées de chants. Dans le Memorial de Sololá relatif à l'invasion toltèque au Guatemala, les Cakchiquels manifestent leur surprise de voir que « les Pokomans exécutaient leur danse sans chevreuils, sans oiseaux, sans pièges et sans filet ». La danse du Chevreuil était en effet inconnue non seulement des Pokomans mais aussi de tous les anciens Maya et fut acquise par le groupe quiché lors de son contact avec les chasseurs chichimèques. L'origine aztèque de la danse du Chevreuil est révélée par son nom même, masat, signifiant cerf en nahuatl. Le personnage central de la danse quiché portait en guise de coiffure une tête de chevreuil. Cette danse était connue en outre des Yaquis, des Hopis de Sololá, des Nahuas de la sierra Madre du Sud et des Huichols. En revanche, les danses rituelles des Quichés s'exécutaient autour de la représentation de Quetzalcóatl, le Serpent à plumes, héros toltèque figurant sur les temples de Teotihuacán, Xochicalco et Tula. Dans une danse cakchiquel, tous les danseurs se meuvent à la file en zigzag pour imiter le mouvement ondulant du serpent.
L'ambitus des chants, très étendu, atteint et même dépasse la douzième ; les intervalles de septième sont fréquents. On distingue de nos jours dans les Andes plusieurs genres de composition : lamentations funéraires (ou llantos), chants d'adieux (ou kasharpari), pastorales, chants d'amour (harawi), chants de travail agricole, airs de danse joués ou chantés, parmi lesquels le kaswa, le takteo, la khaxampa et la makkana.
Le musicologue péruvien Leandro Alviña avait proposé une classification de la musique indigène présentée sous trois vocables : la wanka, le harawi, le wayano. Le premier terme regroupait la musique officielle, celle qui accompagnait les cérémonies religieuses ou agricoles, le deuxième concernait la musique intime, amoureuse, et le troisième la danse.
La musique des indigènes d'Amérique du Nord est essentiellement vocale. Les instruments sont très divers : idiophones, membranophones, acrophones et quelques cordophones accompagnent les chants et les danses. Dans les tribus indiennes des États-Unis et du Canada (Omahas, Algonkins, Sioux, Chippewas, Utes, Hidatsas), chants et danses se rapportent à la guerre : entrée en guerre, exaltation des vertus guerrières, fin des combats, calumet de paix ; il existe des chants de guérisseurs, des chants funèbres, des chants de jeux (dés, mocassins), des chants de chasse (incantations pour attirer le gibier dans les pièges) et des chants d'amour.
Une ancienne cérémonie représentant des oiseaux en vol descendant du ciel vers la terre subsiste sous la forme du volador ou jeu de la voltige. Les voltigeurs-oiseaux s'introduisent dans les anneaux d'une corde et se jettent dans l'air pour décrire des spirales qui s'élargissent de plus en plus, à mesure que le câble se déroule, jusqu'à ce qu'ils arrivent à terre. Deux musiciens jouent de la flûte ou du tambour au sommet du clocher de l'église, à l'endroit qui symbolise le ciel. Ce jeu subsiste dans le Panhuatlan de l'État mexicain de Hidalgo et dans le jeu du Mât graissé célébré au Guatemala, au Honduras et au Salvador durant la fête patronale. Une variante de ce jeu, la danse des Éperviers, ou des Aigles, est aussi observée chez les Huaxtèques. L'origine de cette « danse des artistes en haut de l'arbre » (en quiché) se trouve expliquée dans le Popol-Vuh : il s'agit du mât de voltige de la culture toltèque. Chansons et danses folkloriques des Amérindiens de Bolivie (Cochuas, Guaranis et Aymaras) restent liées aux cérémonies vouées au culte solaire d'Inti : Pacoches, Huacastocoris, Danzantes, Morenos, Chunchos, Tundigues, Mecapaquenas et danses guerrières (Chiriguanos).
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Rosario ACOSTA NIEVA : docteure en archéologie à l'université Paris I-Panthéon Sorbonne, chercheuse associée Universidad de Guadalajara (Mexique)
- Brigitte FAUGÈRE : maître de conférences à l'université de Paris-I-Panthéon-Sorbonne
- Oruno D. LARA : professeur d'histoire, directeur du Centre de recherches Caraïbes-Amériques
- Éric TALADOIRE : professeur émérite des Universités
- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis
Classification
Médias
Autres références
-
AGUADA CULTURE
- Écrit par Susana MONZON
- 374 mots
-
AGUADA FÉNIX, site archéologique
- Écrit par Éric TALADOIRE
- 2 830 mots
- 3 médias
Le site prémaya d’Aguada Fénix (Tabasco, Mexique) a été révélé au public en 2017. Son identification repose sur l’analyse, par l’archéologue Takeshi Inomata (université de l’Arizona), de relevés lidar de l’Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), originellement destinés à l’étude de...
-
AMÉRINDIENS - Hauts plateaux andins
- Écrit par Carmen BERNAND
- 4 691 mots
Avant l'arrivée des Espagnols, les vallées d'altitude de la Cordillère des Andes étaient habitées par des groupes ethniques qui reconnaissaient des lignées ancestrales spécifiques, possédaient leurs propres sanctuaires et lieux sacrés désignés sous le nom générique huacas, portaient... -
AMÉRIQUE (Structure et milieu) - Géographie
- Écrit par Jacqueline BEAUJEU-GARNIER , Danièle LAVALLÉE et Catherine LEFORT
- 18 110 mots
- 9 médias
Examinons maintenant les faits archéologiques et les différentes hypothèses qu'ils étayent avec plus ou moins de bonheur. Actuellement, trois thèses s'affrontent. Quelques chercheurs suggèrent une arrivée très ancienne, antérieure à la première crue froide du Wisconsin vers — 70 000 ou durant cette... - Afficher les 91 références
Voir aussi
- ETHNOMUSICOLOGIE
- OBSIDIENNES
- DATATION, archéologie
- RITES FUNÉRAIRES
- COPÁN
- OLMÈQUE ART
- TRES ZAPOTES
- OAXACA
- POINTE, outillage préhistorique
- TROMPE, musique
- SÉDENTARISATION
- TENOCHTITLÁN
- AMÉRINDIENS ou INDIENS D'AMÉRIQUE, Amérique centrale et Mexique
- CALAKMUL
- NAKBÉ
- MIXE-ZOQUES
- SAN LORENZO
- TEUCHITLÁN
- CHUPÍCUARO
- MEXIQUE PRÉCOLOMBIEN
- LAME, industrie préhistorique
- MÉSO-AMÉRIQUE
- CACAXTLA SITE DE
- LITHIQUES INDUSTRIES
- VILLE, urbanisme et architecture
- MÉTALLURGIE, histoire
- FIGURINE
- AMAS DE COQUILLAGES
- TERRE CUITE, sculpture
- GUANAJUATO