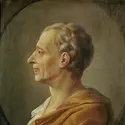- 1. Sciences sociales, recherches sociales et quantification
- 2. Les premières connaissances concrètes et quantifiées du social
- 3. De l'Antiquité à la Renaissance
- 4. Les débuts de la statistique descriptive et quantitative au XVIe siècle
- 5. Les recherches sociales concrètes et quantifiées aux XVIIe et XVIIIe siècles
- 6. Bibliographie
SCIENCES SOCIALES PRÉHISTOIRE DES
Article modifié le
Les premières connaissances concrètes et quantifiées du social
Le souci de compter et de se compter remonte aux plus anciennes civilisations connues. On ne le rappelle pas ici par goût de l'exhaustivité mais pour mieux montrer l'illusion de séparations trop précises : celles de la périodisation certes, avec des surgissements bien identifiés et des révolutions qualitativement radicales et radicalement datées ; celles aussi que l'on dresse entre le savoir et les savoir-faire, entre les sciences et les techniques. Très longtemps avant que se constitue une « arithmétique politique » aux connotations encore pratiques mais qui donnera naissance à plusieurs sciences sociales distinctes, on relève les traces de ce qu'on peut appeler un « art social » ou, sans excès d'anachronisme, une « technologie sociale » ou « expertise sociale » qui supposent l'existence de bureaucraties (sinon de véritables technocraties) dont le double but, concernant la société, est de savoir afin de pouvoir.
Ainsi en est-il de l'idée et des tentatives de dénombrement dans les cités-États et les grands empires de l'Antiquité. D'excellents auteurs ont adopté dans des ouvrages très accessibles (G. Pieri, 1968 ; M. Reinhard, A. Armengaud et J. Dupâquier, 1968 ; J. Hecht, 1977) un ordre d'exposition commode qu'on se contentera de reprendre. La civilisation de Sumer, l'une des plus anciennes qui nous soient connues (VIe-fin du IVe millénaire av. J.-C.), a laissé des tablettes d'argile portant en caractères cunéiformes des listes de biens et de gens dénombrés selon une numération sexagésimale. Ensuite, vers 3000 avant J.-C., des États s'organisent du Nil à l'Indus. Le souci du nombre et la science arithmétique apparaissent à peu près au même moment, mais pas dans toutes ces civilisations simultanément ni avec la même emprise. Certains auteurs ont cru pouvoir affirmer au sujet de ces civilisations que « celles de l'Indus demeurèrent étrangères au souci statistique, qui fut pourtant commun à la Mésopotamie, à l'Égypte et à la Chine » (M. Reinhard et al., p. 23, 1968). Cela n'est sans doute vrai que pour les civilisations de l'Indus des IIIe et IIe millénaires : pour l'Inde du ive siècle avant J.-C., l'Arthaśâstra de Kautilya (M. Dambuyant, 1971) révèle un souci de science de la société au sens large et de statistique au sens strict qui classe l'auteur au niveau de Machiavel et de Vauban (J. Hecht, pp. 27 et 28, 1977).
Les civilisations du Nil et de l'Euphrate
La Mésopotamie émergeant du Déluge vers l'an 3000 avant J.-C. apporte une civilisation développée, une population nombreuse, une science des nombres poussée servant de support à l'astronomie – le calendrier lunaire se perfectionne peu à peu en s'appuyant sur les mouvements solaires – mais appliquée aussi à une meilleure connaissance des éléments constituants de la société. L'État recensait périodiquement les imposables et leurs biens. On sait que l'opération administrative et fiscale avait aussi une valeur religieuse qui se retrouve en Israël et à Rome. Sur les tablettes de Chagar Bazar, le même terme signifiant à la fois « purifier » et « recenser » figure sur des comptes mentionnant les quantités de denrées alimentaires comme offrandes rituelles à l'occasion d'un dénombrement. À vrai dire, il n'y a rien d'étonnant dans cette union intime du rite, du mythe et du fait positif (cf. C. Morazé, 1975, par exemple). Cependant, la comptabilité sociale ainsi entreprise demeure limitée dans son extension : en effet, si certains fragments ont fourni des listes détaillant les membres d'une famille ou d'une maisonnée, rien ne subsiste qui s'applique à un quelconque ensemble politique, et moins encore à l'État, si ce n'est des listes de contingents armés (Sainte-Fare Garnot, 1958) ou de tués et de prisonniers.
Autre civilisation fluviale, l' Égypte antique disposait à la même époque d'une numération plus fruste mais permettant d'atteindre le million d'unités, ainsi que d'un calendrier solaire ; on savait observer les astres, mesurer les crues du Nil et en anticiper les conséquences sur le niveau des subsistances – l'expression de « Nil bas » était lourde de menaces. Les « Admonitions d'un vieux sage » contiennent des descriptions de famines dues à la guerre et de leurs conséquences directes et indirectes sur le niveau de la population : « Les femmes sont stériles, on ne fait plus d'enfants » ; deux processus fondamentaux sont ainsi juxtaposés : la stérilité due à l'épuisement physiologique et « la volonté de ne pas créer », ce qui confirmerait la pratique de la contraception dès cette haute époque.
Les recensements semblent avoir été en Égypte plus réguliers et plus généraux qu'en Mésopotamie. Une inscription datant d'environ 2900 avant J.-C. (pierre de Palerme, Ire dynastie) fait allusion à un recensement de personnes. Viennent ensuite des preuves de recensements biennaux sous la IIe dynastie, et même annuels sous la VIe. À ces premières attestations d'opérations de nature fiscale s'ajoutent, sous les XIIe et XIIIe dynasties, des indications destinées à une utilisation militaire. Les deux types de données, fiscales et militaires, sont réunies dans une même opération sous la XVIIIe dynastie. Des recensements portant sur l'ensemble de la population auraient aussi été opérés, semble-t-il, si l'on en croit des listes retrouvées qui détaillent dans certains cas particuliers (familles de soldats ou de travailleurs) les familles et les occupants des maisons. Qu'en était-il du mouvement de la population ? Il semblerait que les naissances aient été enregistrées au moins à partir du début du xiiie siècle, si l'on en croit l'anecdote relative aux garçons nés le même jour que Ramsès II, que Séthi Ier fit élever à ses frais et dont il forma une garde particulière pour son fils. Toutefois, le chiffre des garçons nés en un jour fourni à cette occasion (1 700) correspondrait pour nos démographes à environ 1 200 000 naissances annuelles, ce qui paraît tout à fait sujet à caution.
Ces quelques épaves sont infiniment précieuses pour qui veut rechercher les plus lointaines origines des tentatives pour établir une comptabilité sociale et créer ainsi les conditions mêmes d'existence de sciences sociales positives. Mais la quasi-totalité de l'édifice statistique dont l'existence nous est ainsi attestée a pratiquement sombré. Au risque d'anticiper sur les développements ultérieurs de la comptabilité sociale, il est intéressant de noter ici que les seules évaluations globales de population dont nous disposions pour l'Égypte antique sont dues à des géographes, ethnographes, mémorialistes et historiens grecs et judéo-romains des époques hellénique, hellénistique et romaine : Hécatée d'Abdère et Diodore de Sicile (ive-iiie siècles et ier siècle av. J.-C.), qui donnent rétrospectivement pour l'Égypte pharaonique 7 millions ; Hérodote, dont l'estimation de la population de l'Égypte de Cambyse (ive siècle) est moitié moindre, et, au ier siècle après J.-C., l'historien judéo-grec et politicien judéo-romain Flavius Josèphe, qui fournit le chiffre de 7 millions et demi d'habitants, plus environ 700 000 à Alexandrie.
Israël
Dans la Bible la comptabilité sociale – ou plutôt ce qui peut passer pour tel, et c'est là le problème – occupe une place centrale et, en raison même de cette centralité, parfaitement paradoxale. D'une part, les Nombres donnant leur titre à l'un des livres de la Bible, le populationnisme qui s'y trouve ouvertement professé dès la Genèse et, même a contrario, dans les Proverbes (xiv, 28 : la nation nombreuse fait la gloire du Roi ; lorsque le peuple diminue, c'est la ruine du Prince) est en principe un élément, absent comme on le verra de la tradition gréco-latine, puissamment favorable aux entreprises de dénombrement. Celles-ci sont effectivement mentionnées à plusieurs reprises. Un premier recensement opéré dans le Sinaï est mentionné deux fois (Nombres, i, 2, et Exode, xxx, 12-15). Quarante ans après la sortie d'Égypte, un autre recensement a lieu dans la plaine de Moab (Nombres, xxvi, 1, 26 et 51). Le troisième recensement est effectué sous le règne de David ; il se trouve lui aussi relaté, comme le premier, à deux reprises et sous deux formes différentes, dans le deuxième livre de Samuel et dans le deuxième livre des Chroniques.
Le paradoxe vient de ce que les chiffres donnés pour des époques différentes concordent alors qu'ils devraient diverger, et, à l'inverse, que des versions d'un même épisode divergent significativement alors qu'on s'attendrait plutôt à les voir concorder. Pour le premier recensement dans le Sinaï nous avons deux versions nettement divergentes : dans les Nombres, c'est Yahvé qui ordonne à Moïse « le recensement général de toute la communauté des enfants d'Israël... », mais dans l'Exode il est bien précisé en revanche (xxx, 12-15) que, lorsque Moïse fera le recensement de ceux qui doivent être dénombrés, « chacun d'eux paiera à Yahvé le rachat de sa vie, afin que ce dénombrement n'attire pas sur eux une calamité ». Quant au troisième recensement, les deux relations en sont encore plus directement opposées terme à terme, puisque, dans le deuxième livre de Samuel, Dieu lui-même ordonne le recensement, ce qui ne va d'ailleurs pas sans soulever des problèmes (Joab, chef d'état-major de David, s'oppose à l'opération par crainte des représailles de Dieu, qui, finalement, propose à David en contrepartie le choix entre trois ans de famine, trois mois de défaites ou trois jours de peste). Toutefois, dans le premier livre des Chroniques, l'initiative vient de Satan, mais David prend sur lui toute la responsabilité de cet acte et, après avoir offert des sacrifices à Dieu, il est pardonné.
Mais l'essentiel est bien évidemment la valeur symbolique des nombres avancés, valeur éminemment religieuse et sacrée. Il faut être constamment conscient de cette extraordinaire magie du nombre que l'on rencontre sans cesse associée aux prophétismes et aux utopies, de la Bible au pythagoriciens, à Platon, à l'Apocalypse, jusqu'à l'extraordinaire combinatoire des passions de Fourier. De nos jours encore, en France tout au moins, le monopole qu'exercent les agences d'État et surtout l'I.N.S.E.E. (branche du ministère de l'Économie) sur la collecte et la diffusion des données essentielles de la comptabilité nationale conduit au soupçon permanent que si tout ce qui est publié est exact, tout ce qui est exact n'est pas publié. Quoi qu'il en soit, la quantification, opération hautement équivoque, entretient puissamment les rêves et les craintes, les mythes, les anticipations et les utopies. Elle leur confère une très forte crédibilité symbolique. Cette fonction de légitimation durera jusqu'à la Renaissance où elle prendra d'ailleurs une vigueur toute nouvelle.
Inversement, l'idée de malédiction attachée au recensement marquera fortement la chrétienté : saint Ambroise et saint Augustin condamneront le péché d'orgueil commis par David. Les nations chrétiennes occidentales n'en accepteront le principe qu'avec difficulté, comme en témoigne, au xviiie siècle, la résistance acharnée opposée par les diverses Églises protestantes britanniques au principe du census (Cullen, 1975 ; J. Dupâquier, 1977).
La machine à recenser chinoise
L'expression de « machine à recenser » est empruntée à J. Hecht (1977), dont l'exposé s'appuie entre autres sur les travaux de M. Cartier et P. E. Will (1972) et de S. Sterboul (1974). Populationniste comme tous les régimes de la haute Antiquité et singulièrement Israël, l'Empire du Milieu a eu, en outre, très tôt conscience de la nécessité et de l'utilité de se dénombrer. Le plus remarquable ici est moins la précocité somme toute relative (recensement des terres et des gens dès 2238 av. J.-C. après une grande inondation) que l'extraordinaire continuité de l'effort de recensement. Depuis l'époque pré-impériale (ixe siècle av. J.-C.), durant laquelle l'école de Confucius vers le vie siècle avant J.-C. accordait au recensement une extrême importance, à en croire les honneurs rendus à ses agents, jusqu'à la série homogène et continue de 1750 à 1850 de notre ère, à travers des vicissitudes diverses, l'effort de comptabilité sociale n'a pas connu d'interruption. Sans entrer dans les détails subtils distinguant les compétences respectives du grand directeur des multitudes (cartes du royaume et nombre des habitants) et du sous-directeur des multitudes (répartition selon les neuf classes de la population avec ventilation par âge, conditions [ ?] et état de santé), il faut surtout souligner que, compte tenu des sous-déclarations et du fait que les seuls contribuables (estimés à 65 p. 100 de l'effectif total) étaient recensés, les chiffres obtenus s'expriment en dizaines de millions, ce qui supposait une organisation d'une ampleur considérable.
À partir de l'époque impériale (les Han, 200 av. J.-C.), on a pu classer les recensements en quatre types principaux :
– pour la conscription (guerre et travaux publics) sous les Han (200 av. J.-C.-200 apr. J.-C.) ;
– distribution des terres, pour encourager la production agricole et restreindre les grands domaines (221-959 apr. J.-C.) ;
– dans un but purement fiscal, la notion de feu l'emportant sur les autres (960-1368) et permettant aujourd'hui d'évaluer la population de l'Empire à 100 millions vers 1100, 110 à 120 millions vers 1200 (les Mongols auraient imposé, d'après A. Armengaud et al. [1968], des relevés très stricts de population par famille, affichés à l'entrée des maisons, et dont il ne subsiste rien) ;
– de 1368 à 1644 (époque des Ming) fonctionne à plein une « admirable machine » à recensement reposant sur la rédaction de registres décennaux indiquant nom, âge et profession. On ne peut manquer d'être frappé par le contraste avec l'Europe occidentale où, à la fin du Moyen Âge et au début de l'âge classique, déclarations et essais n'aboutissent qu'à des résultats lacunaires. C'est au contraire lors de l'essor de la comptabilité sociale occidentale (vers 1644) que l'Empire du Milieu entre dans une période de flottement.
Enfin, en 1775, à l'époque où l'abbé Terray (1772) ordonne en France aux intendants de faire établir, à partir de l'année 1770 incluse, une statistique du mouvement de la population, on revient au système dit pao-chia qui, outre la tenue des registres décennaux antérieurs à 1644 avec nom, âge et profession, impose l'apposition pratiquée avant 1368 sur toutes les maisons de placards indiquant le nombre des occupants, leur sexe, âge et profession, et le montant de leurs impositions. (Rappelons, à ce propos, que le principe de la publicité des impositions, joint à l'exigence de transparence des revenus, suscite encore aujourd'hui de grandes réserves.) La série démographique chinoise ainsi obtenue est en tout cas homogène et continue de 1750 à 1850, alors que la comptabilité sociale des pays occidentaux traverse simultanément durant ces cent années les secousses économiques et sociales de la révolution industrielle ainsi que les remaniements administratifs continuels dus au renouvellement constant du personnel politique (M. Reinhard, 1950 ; J.-N. Biraben, 1970 et R. Le Mée, 1975, pour la France ; M. J. Cullen, 1975, pour la Grande-Bretagne, et E. Vilquin, 1977, pour l'ensemble des pays occidentaux).
On sait qu'à partir de 1560 la Compagnie de Jésus, grâce à sa mission portugaise en Chine, sert de véritable médiateur culturel entre l'Empire du Milieu et l'Occident, surtout depuis le séjour en Chine proprement dite (et non seulement à Macao) du père Matthieu Ricci de 1582 à 1610. En France circulait depuis 1616 un mémoire du père Trigault, composé à partir des notes du fameux missionnaire. Beaucoup d'autres suivirent. À deux reprises au moins on relève une incidence directe de ces récits sur les recherches sociales quantitatives.
Tout d'abord Vauban, dans son Projet d'une dîme royale... (1707), fait à deux reprises une référence explicite aux recensements chinois en invoquant le témoignage du « Père Le Comte, jésuite », membre du premier groupe de six jésuites français arrivés en Chine au début de 1688, auteur des Nouveaux Mémoires sur l'état présent de la Chine (1696), puis en indiquant comment adapter la technique chinoise en France. C'est ensuite, au xviiie siècle, Quesnay, dont l'engouement pour Le Despotisme de la Chine, aussitôt systématisé par Mercier de la Rivière (1767), trouve son origine dans une juste appréciation de cette comptabilité sociale. Il accordait, en effet, à la collecte des faits empiriques par questionnaires une certaine importance comme le montrent les Questions intéressantes sur la Population, l'Agriculture et le Commerce proposées aux Académies et autres Sociétés Savantes des Provinces, rédigées par lui en 1758 avec Marivelt et précédées d'un avertissement de Victor de Mirabeau. De fait, les sept premiers chapitres du Despotisme de la Chine (mars-juin 1767) consistent en une description de la science, de l'administration, des lois pénales chinoises, extraite principalement des relations des missionnaires et des voyageurs. Le huitième chapitre (seul reproduit par l'I.N.E.D., [1958] montre fort bien cependant que le libéralisme économique requiert pour un fonctionnement harmonieux une « autorité [qui] doit être unique » et de nature « théocratique ». C'est l'amorce de l'école vers la doctrine qu'accentueront Mercier de la Rivière et Dupont de Nemours, et qui annonce à la fois la rupture ultérieure avec Smith (1776) et surtout la transition progressive et inexorable, avec Turgot et Saint-Simon, vers le positivisme de Comte. La filiation est bien établie par Manuel (1962) qui montre de façon éclatante comment la prétendue « rupture épistémologique » entre les xviiie et xixe siècles européens résiste mal à l'examen. Les idéologues de la fin de l'Ancien Régime et de la Révolution attendaient avec impatience un pouvoir « unique », voire « théocratique », pour exercer en pleine liberté le rôle de technocrates qu'ils revendiquaient : leur participation très active au coup d'État du 18 brumaire et du Consulat le prouve suffisamment. Ils n'ont pas renié le despote : c'est ce dernier qui finalement les a rejetés.
L'Inde et le Japon jusqu'aux Tokugawa
Ce panorama de la comptabilité sociale dans les empires asiatiques ne serait pas complet sans l'Inde, et d'abord le Japon, dont le premier recensement avéré date de 86 avant J.-C. À cette date, un registre permettait de suivre les mouvements de la population. Par la suite, certaines analogies avec la Chine permettent de marquer quelques points de repère.
Au début du viie siècle de notre ère, en effet, un dénombrement conduit à estimer la population japonaise à près de 5 millions d'individus. Sans doute ce résultat est-il isolé, mais il précède des relevés plus réguliers et plus complets. En effet, vers le milieu du siècle, la centralisation de l'État consécutive à la réforme de Taika coïncida avec une redistribution des terres qui exigeait une connaissance détaillée de la population. On établit donc un cadastre et des registres d'état civil destinés à être révisés tous les six ans. Les relevés n'étaient pas seulement destinés à l'assiette de l'impôt, mais aussi aux levées militaires. Les familles étaient regroupées par communes et classées selon leurs ressources. L'unité de compte officielle était la « bouche à nourrir », mais on distinguait sexes et groupes d'âge : bébés, enfants, adultes et vieillards.
Au xviie et au xviiie siècle l'organisation sociale gagna en stabilité et en fermeté, tout en gardant son caractère féodal et en continuant de reposer sur la paysannerie. La paix favorisant les échanges, la production et l'artisanat, la population aurait atteint à la fin du xviie siècle 25 millions d'âmes, soit 40 p. 100 d'augmentation en cent ans, proportion remarquable compte tenu des techniques de production. Sous les Tokugawa (xviie-xixe siècle) ont lieu dès 1665 des dénombrements locaux. En 1721 eut lieu le premier dénombrement ; cette opération se renouvela tous les six ans. Mais le premier recensement ne porta pas sur toute la population : il excluait les nobles, les Bushi et les plus pauvres. Les seigneurs pouvaient, en outre, ne pas déclarer les enfants de moins de quinze ans, soit une sous-évaluation du quart d'après l'Europe de 1720, ou du tiers eu égard au Japon dans la suite. Enfin, seule la population figurant sur les registres à la mode chinoise était comptée : certains évaluaient le sous-enregistrement même pour les seuls adultes à au moins 10 p. 100. De 1721 à 1846, la population est restée presque stable. Quant aux registres qui ne comportaient pas la structure de la population par âge et n'enregistraient pas son mouvement, ils prouvent néanmoins l'importance que revêtait pour les Japonais la comptabilité sociale bien avant l'ère Meiji.
C'est dans l'Inde du ive siècle avant notre ère que l'Hindou Kautilya, ministre du roi Chandragupta (313-289), fondateur de la dynastie et du premier empire indien des Maurya (313-326), a rédigé une œuvre extraordinairement originale et en avance sur son temps qui est à la fois un traité de science politique et d'économie, l'Arthaśâstra, c'est-à-dire traité ou science du profit, texte contemporain de la mort d'Alexandre le Grand. Il est à noter que l'empire Maurya, notamment sous Aśoka, vers 250 avant J.-C., réalisa l'unification presque entière des Indes et passa pour avoir été un régime bienfaisant en un temps de prospérité, où l'agriculture fit encore des progrès. Après quoi, la prospérité ne revint qu'au temps de l'empire Gupta, au ive siècle de notre ère.
Pour Kautilya, l'État doit tout diriger, tout contrôler, à l'aide d'un appareil administratif très étendu complété par l'armée et la police secrète. Il lui faut donc une comptabilité sociale extensive, établie à l'aide d'une méthode dont la minutie a été jugée à bon droit remarquable.
Les civilisations grecque et romaine
L'importance de la Grèce et de Rome dans la préhistoire de l'établissement d'une comptabilité sociale et du développement sur cette base des premières recherches sociales proprement dites apparaît clairement dans la filiation du terme moderne de « recensement », qui dérive en droite ligne du terme latin census et lui a emprunté sa particularité romaine de périodicité quinquennale. Cette filiation est même si forte que la cérémonie religieuse qui clôt l'opération longue et complexe du census romain, dénommée lustrum, a laissé jusqu'à nos jours le nom de lustre à une période de cinq ans.
Toutefois, Rome n'est ni la seule ni la première à avoir connu une telle institution jugée fondamentale, d'une part, de dénombrement, d'autre part, d'enregistrement des noms, des fortunes et de toutes les particularités permettant de classer les citoyens selon un ordre logique (ratio) déterminant leur degré de participation à la vie civique. Les comparatistes É. Benveniste et G. Dumézil, notamment, voient dans les aspects militaires, économiques et religieux de la grande machinerie du census un héritage peut-être inhérent à toute l'organisation sociopolitique des Indo-Européens. Dériverait-il, comme le suggère Dumézil, de quelque cérémonie d'après la bataille, sorte de « redistribution de cartes » publique et solennelle liée au partage du butin et à une juste distribution du blâme et de l'éloge ?
Quoi qu'il en soit, les antécédents grecs de telles opérations de recensement et surtout d'estimation des fortunes (estimer : timân, d'où dérive timè : honneur) sont certains tant sur le plan documentaire (constitutions soit archaïques, comme celle de Solon pour Athènes, soit classiques) que sur celui de la philosophie politique ou de la science politique. Sans examiner en détail l'émergence de la science politique grecque considérée en elle-même, on ne peut que souligner ici la convergence de courants de pensée par ailleurs opposés. Qu'il s'agisse, en effet, de constitutions « utopiques » établies a priori par Platon au ive siècle pour sa colonie imaginaire de Magnètes (Les Lois, 744 b), ou qu'il s'agisse, à l'inverse, de l'observation empirique par Aristote, vers 340, des quelque 158 États et constitutions connus de son temps, dont seule a survécu dans la Politique celle qui est consacrée à Athènes (dont on verra plus loin l'influence sur la statistique descriptive dans l'Europe des xvie et xviiie siècles), c'est la démocratie tempérée par le cens (timèma) qui est considérée comme étant le régime le meilleur (Politique, VI, 4, 1318 b, 26). On loue son savant dosage d'éléments aristocratiques et démocratiques, égalitaires et hiérarchiques, qui reflètent un consensus tout en le renforçant, assurant ainsi la cohésion de la cité. Ces arguments sont repris par les auteurs romains du ier siècle avant J.-C., plus particulièrement par Cicéron (cf. notamment De Republica, I, 43). Si différentes que soient les civilisations grecques et romaines quant à la place et au développement des mathématiques pures, de la philosophie et de la science politique, d'une part, des statistiques et de l'administration, d'autre part, il a paru utile de souligner ce trait commun : la place centrale accordée aux institutions de comptabilité et de hiérarchie sociales.
La comptabilité sociale et les dénombrements à Athènes
Outre les données d'ordre fiscal et militaire disponibles en Grèce comme dans les États du Moyen-Orient, Athènes jouit de dispositions lui permettant de mieux connaître sa population que les autres cités grecques. À chaque naissance, rapporte Aristote (Économiques, II), on offrait à la prêtresse d'Athéna une mesure de froment, et à chaque décès une mesure d'orge. Les Athéniens tenaient, en outre, une sorte de registre d'état civil : chaque année, le troisième jour de la fête des Apatouries, on enregistrait les enfants nés au cours de l'année précédente. Dans certains dèmes un double était dressé. À la dix-huitième année s'effectuait l'inscription en qualité de citoyens et l'on dressait le catalogue des hommes en âge de porter les armes. D'autre part, parmi les non-citoyens, les étrangers ou métèques étaient dénombrés par leur impôt particulier, qui se payait par tête. Enfin, à l'occasion, des dénombrements étaient prescrits : ils portent le plus souvent sur les citoyens, autrement dit les hommes de plus de dix-huit ans, donc en âge de porter les armes.
Les seules données sûres et complètes qui nous soient parvenues proviennent du dénombrement relativement tardif de Démétrios de Phalère, qui compte 21 000 citoyens vers 310 avant J.-C. Les chiffres antérieurs permettant d'esquisser une tendance sont plus sujets à caution. D'Hérodote au début du ve siècle à Aristophane et plus tard Platon, on trouve le même chiffre rond et immuable de 40 000, ce qui inspire d'autant moins confiance qu'il apparaît dans des écrits à caractère fort peu démographique. On ne peut donc guère y voir qu'un ordre de grandeur. Une reconstitution historique minutieuse de J. Labarbe, fondée sur les équipages de la marine et la distribution de parts de dix drachmes, d'après le nombre précis des combattants athéniens présents à Salamine, donne une fourchette précise d'estimation pour l'ensemble des citoyens se situant très près de 37 000 en 480. Entre les deux dates le déclin n'est pas douteux. Il s'explique par la peste de 430-427 (dont la nature exacte est discutée), qui aurait emporté le quart de la population d'après Thucydide, par l'émigration de 322 et enfin par la guerre. Le recensement de 310 est seul à mentionner la masse esclave, qu'il fixe globalement, tous sexes confondus, à 400 000, chiffre qu'aucune base sérieuse ne permet de critiquer. L'ensemble de la population libre (citoyens et étrangers ou métèques compris) ne peut être appréhendé que par des moyens comparatifs et rétrospectifs aléatoires qui le situent aux environs de 200 000 pour l'Attique en 460-430, et sans doute moins de 100 000 vers 310. Comme pour les citoyens, c'est un constat de déclin.
Il n'en est que plus intéressant de constater la priorité longtemps accordée dans la pensée grecque à la détermination théorique et au maintien effectif d'un niveau idéal ou optimal de la population. L'attachement signalé plus haut à la démocratie tempérée ou censitaire permet de comprendre que l'idéal ait été la stabilité d'un petit nombre, seul compatible avec le jeu normal et effectif de telles institutions. C'est ainsi que Platon, après avoir affirmé que « ce qu'il faut fixer en premier lieu, c'est le volume numérique de la population, de combien de personnes il est besoin qu'elle se compose. Après quoi, il y a lieu de se mettre d'accord sur la répartition des citoyens et sur le nombre des sections selon lesquelles ils doivent être divisés, ainsi que sur le nombre des individus dans chaque section », fixe pour des raisons pratiques le nombre des chefs de famille à 5 040, soit un total de 60 000 citoyens, et précise les moyens propres à maintenir la population à ce niveau. C'est seulement vers 150-140 avant J.-C. que l'historien grec Polybe mentionne et dénonce le manque d'hommes ou plutôt de population (oliganthropia) qui frappe la Grèce de son temps (Histoires, XXXVIII, 4), appelant de ses vœux un renouvellement des mœurs et une législation appropriée.
Le census romain et la table de mortalité d'Ulpien
Avec les notions bibliques et les pratiques chinoises connues à partir du xviie siècle en Europe occidentale à travers les rapports divers des missionnaires, ce sont les concepts et les usages romains qui ont le plus fortement influencé la naissance en Occident de la comptabilité sociale et des recherches sociales quantifiées. La tradition remontant à Tite-Live (I, 42, 4) attribue au roi Servius Tullius (578 à 534 av. J.-C.) l'institution du cens obligatoire sous peine de prison et de mort. D'après Dumézil, le terme romain de census aurait une acception sociopolitique à la fois plus étendue, plus contraignante et plus explicite que celle du grec timèma : le verbe censere, rapproché d'une racine sanscrite çams, qui renvoie elle-même à un indo-européen cens, prend le sens de « situer un homme ou un acte ou une opinion à sa juste place hiérarchique, avec toutes les conséquences pratiques de cette situation, et cela par une juste estimation publique, par un éloge ou un blâme solennel ». L'adéquation entre le nomen (titre) attribué à chaque citoyen au terme de sa declaratio auprès des magistrats (censores) chargés du census, et sa place effective dans la hiérarchie de la cité (participation aux assemblées, statut fiscal et obligations militaires) est donc très étroite. La régularité du census, son extension hors de Rome par la lex Iulia municipalis promulguée en 89 avant J.-C. et astreignant chaque citoyen à l'enregistrement dans sa ville d'origine, la présence effective à Rome étant encore socialement souhaitable au temps de Cicéron, ainsi qu'à la communication des renseignements demandés sous peine de la confiscation des biens et de la perte de la liberté (Denys, IV, 15, 16) expliquent l'importance croissante de l'institution et, par voie de conséquence, de la charge des deux censeurs. Sous leurs ordres fonctionnait une bureaucratie disposant de locaux permanents et d'archives.
L'arsenal de la comptabilité sociale romaine se complète sous le principat d'Auguste avec les lois Aelia-Sentia de 4, et Papia-Poppaea de 9 après J.-C., qui introduisent une réforme fondamentale : désormais les citoyens, dans l'intervalle des recensements et en leur absence, doivent déclarer soit à Rome auprès des magistrats, soit dans les provinces auprès des gouverneurs, leurs enfants nés libres (y compris par conséquent les enfants nés d'esclaves). Les déclarations étaient consignées dans des registres auxquels il était désormais possible de recourir directement pour l'établissement du census. Ainsi, même si ces registres n'étaient pas destinés explicitement à des récapitulations, le mouvement de la population (et non plus seulement son état comme par le census seul) se trouvait de facto enregistré. Enfin, des copies conformes étaient délivrées comme de nos jours à ceux qui en avaient besoin, et les papyrus d'Égypte en contiennent une demi-douzaine. Les décès eux aussi étaient enregistrés.
La base de toute reconstitution du niveau de la population des citoyens mâles adultes d'après le census repose sur les trois recensements en 28 et 8 avant J.-C., puis en 14 transmis dans les Res Gestae... (8, 2 ; 8, 3 ; 8, 4) d'après l'inscription d'Ancyre (Ankara). Des historiens modernes comme Frank ou Brunt ont rassemblé les données fournies par l'historiographie romaine de langue grecque ou latine et retracé ainsi les étapes de l'extension de la civitas romana de 130 000 en 508 (Denys, V, 20) à 4 937 000 en 14 après J.-C. (Res Gestae, 8, 4). Le contraste avec Athènes est on ne peut plus frappant.
Enfin, c'est évidemment d'après les actes de décès qu'a été construite au iiie siècle après J.-C. la table de mortalité du juriste Ulpien, qui représente à ce jour, historiquement, le premier raisonnement sur la probabilité de la durée de la vie humaine. Transmise par Macer, elle a été incorporée dans le Digeste composé sous Justinien. Le contexte juridique de son apparition permet de penser que, comme quinze siècles plus tard en Angleterre, en France et dans les Provinces-Unies, elle fournissait la base du calcul de diverses pensions alimentaires. On peut faire deux remarques à ce propos. Il est remarquable tout d'abord que la table d'Ulpien, qui donne pour des tranches d'âge choisies la durée de vie probable (calculée sur la médiane), peut être extrapolée par le biais des coefficients de mortalité et que ses paliers se juxtaposent alors de manière très satisfaisante avec les courbes d'un modèle type récent, celui de Lederman, qu'il s'agisse de la courbe de la durée de vie probable ou de celle de l'espérance de vie calculée sur la moyenne. Il n'est pas moins remarquable, en revanche, à l'inverse de ce qui se passe en Europe occidentale aux xviie et xviiie siècles, que malgré sa qualité technique assez comparable à celle de la table dressée par Graunt en 1662 (Natural and Political Observations..., chap. xi, p. 62), la table d'Ulpien, qui aurait pu devenir un instrument d'observation et d'analyse scientifiques, soit demeurée, en l'état actuel de notre information, un simple outil aux seules applications pratiques.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Bernard-Pierre LÉCUYER : ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de l'Université, directeur de recherche au CNRS
Classification
Média
Autres références
-
CONDORCET MARIE JEAN ANTOINE NICOLAS CARITAT marquis de (1743-1794)
- Écrit par Bernard VALADE
- 1 582 mots
- 1 média
Dans la dernière partie de l'Esquisse (neuvième et dixième époques), Condorcet est cependant revenu avec insistance sur ce qui lui paraissait être essentiel : l'application du « calcul des combinaisons et des probabilités » aux sciences politiques et, d'une façon plus générale, l'union des sciences... -
MONTESQUIEU CHARLES DE (1689-1755)
- Écrit par Georges BENREKASSA
- 7 181 mots
- 1 média
...(1734-1743), entre Bordeaux et Paris, Montesquieu progresse dans la phase la plus importante de l'élaboration des principes de L'Esprit des lois : il entreprend d'éclaircir le lien de causalités générales et particulières, ce qui détermine l'esprit, l'humeur, les mœurs des hommes, individuellement... -
PETTY sir WILLIAM (1623-1687)
- Écrit par Bernard DUCROS
- 597 mots
Tour à tour marin, chirurgien, membre du Parlement, homme public et homme d'affaires, sir William Petty est surtout connu pour ses écrits économiques. L'ensemble de son œuvre permet de le situer comme l'un des plus notables auteurs de transition entre les mercantilistes et les libéraux. Sa ...
-
RECENSEMENTS DE POPULATION (HISTOIRE DES)
- Écrit par Fabrice CAHEN
- 7 681 mots
- 4 médias
Depuis lacivilisation mésopotamienne, à l’origine des plus anciens dénombrements connus, jusqu’à la fin de l’Ancien Régime européen, le comptage humain consiste pour l’essentiel en un relevé partiel, et rarement réitéré, des individus ou foyers et des biens. Ces inventaires prennent des formes et...
Voir aussi
- BOTERO GIOVANNI (1543 env.-1617)
- CAUSALITÉ, sciences sociales
- COMPTABILITÉ SOCIALE
- ÉTAT CIVIL
- RECENSEMENT
- SCIENCES SOCIALES
- DÉNOMBREMENT
- CHINE, histoire : l'Empire, des Qin aux Yuan (1280)
- CHINE, histoire : l'Empire, des Yuan à la Révolution de 1911
- ÉGYPTE, histoire : l'Antiquité
- DÉMOGRAPHIE HISTORIQUE, Chine
- GRÈCE, histoire, Antiquité
- JAPON, histoire, des origines à 1192
- JAPON, histoire, période Tokugawa (1603-1868)
- MODÈLE, sciences sociales
- GRANDE-BRETAGNE, histoire, des origines au XIe s.
- GRANDE-BRETAGNE, histoire, les Stuarts (1603-1714)
- HISTOIRE SOCIALE
- CENSUS
- CATASTO
- CONRING HERMANN (1606-1681)
- SCHLÖZER AUGUST LUDWIG VON (1735-1809)
- DAVENANT CHARLES (1656-1714)
- ROME, des origines à la République
- ROME, l'Empire romain
- FRANCE, histoire, du Ve au XVe s.
- FRANCE, histoire, du XVIe s. à 1715
- KAUṬILYA ou KAUTALYA (IVe s.)