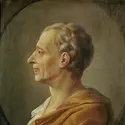- 1. Sciences sociales, recherches sociales et quantification
- 2. Les premières connaissances concrètes et quantifiées du social
- 3. De l'Antiquité à la Renaissance
- 4. Les débuts de la statistique descriptive et quantitative au XVIe siècle
- 5. Les recherches sociales concrètes et quantifiées aux XVIIe et XVIIIe siècles
- 6. Bibliographie
SCIENCES SOCIALES PRÉHISTOIRE DES
Article modifié le
Les débuts de la statistique descriptive et quantitative au XVIe siècle
On voit nettement dès le xvie siècle se dessiner deux des courants de pensée qui domineront la scène européenne jusqu'au début du xixe siècle et se rattachent respectivement à la tradition aristotélicienne de la statistique descriptive et à la pratique latine du recensement. Cette dualité s'accompagne d'une innovation majeure due évidemment à l'imprimerie : la publication des données et des comparaisons et leur discussion publique. Un troisième courant majeur est étroitement lié aux grandes découvertes : ce sont les récits de voyage puis de séjours plus ou moins prolongés parmi des peuples lointains et des civilisations à la fois étranges et étrangères, qui reprennent la tradition d'Hérodote et jettent les fondements de la future géographie humaine tout en constituant une authentique proto-ethnologie. Pour des raisons évidentes de cohérence on a laissé de côté ce matériel proprement ethnographique qui, pour notre période, reste à l'écart de l'effort vers la modélisation.
La statistique qualitative
Une véritable floraison d'ouvrages décrivant les ressources naturelles et les principales caractéristiques de différents pays, qu'ils comparent à l'occasion, se produit au xvie siècle. On peut citer l'ouvrage de Sébastien Munster, moine franciscain passé au protestantisme, professeur à Heidelberg et à Bâle, Cosmographia, Beschreibung aller Länder... in welcher Begriffen aller Völcker, Herrschaften..., Bâle, 1536 et 1544, traduit en français en 1556 sous le titre Cosmographie universelle contenant la situation de toutes les parties du monde avec leurs propriétés et appartenances, Bâle, 1556 et 1565. En 1539 est publiée à Paris La Division du Monde, contenant la déclaration des provinces et régions d'Asie, d'Europe et d'Afrique, de Jacques Signot, qui continue d'ailleurs à perpétuer la légende, pour la France, des dix-sept cent mille clochers. En Italie, F. Sansovino (1521-1586) publie en 1562 à Venise un ouvrage décrivant vingt-deux États, y compris l'« Utopie », Del governo e amministrazione di diversi regni e republiche ; et G. Botero (1540-1617), considéré, par ailleurs, comme l'un des premiers précurseurs de Malthus et l'un des meilleurs théoriciens de la population (Della causa della grandezza e magnificenza della città), publie en 1593 La Relazione universali comprenant, d'une part, la description géographique des États, d'autre part, leur constitution, les causes de leur grandeur et de leur richesse, et leur situation religieuse.
Pour la France, on peut signaler d' Étienne Pasquier, avocat au parlement de Paris, les Recherches de la France (1581) de nature essentiellement juridique et historique, mais écrites d'un point de vue très « national », s'efforçant de comprendre en profondeur les origines de la puissance monarchique, de donner une vue claire de la société et des principales institutions parmi lesquelles la Cour. Peu après, en 1614, Pierre d'Avity (1573-1635), gentilhomme ordinaire de la Chambre du roi, publie les États, Empires, Royaumes, Seigneuries, Duchés et Principautés du Monde, dont le contenu rappelle Sansovino et Botero, quoique avec plus d'importance accordée à la géographie. Il décrit cependant avec quelques détails les mœurs anciennes et contemporaines de chaque pays, la « généalogie » des familles princières et nobles, les « richesses », à savoir la monnaie et les revenus de l'État, ainsi que les questions religieuses et militaires. Dans le même esprit, Pierre Scévole de Sainte-Marthe publie encore en 1670 L'État de la Cour des Rois de l'Europe.
Aux Pays-Bas, Guillaume et Jean Blaeu préparent avec Jean de Laet la série de trente-six volumes parue chez Abraham et Bonnaventure Elzevier de 1624 à 1640 sous l'appellation courante de « Petites Républiques ».
Les débuts de la statistique quantitative
La plupart des auteurs cités plus haut se contentent de décrire, sans faire appel à des données chiffrées. Tout autre est l'optique, à cette même époque, des protagonistes et théoriciens du dénombrement qui, avec Guichardin, invoquent l'exemple romain et ont pour nom Froumenteau, Bodin, Montand, Montchrestien.
L'historien florentin Guichardin, auteur de l'Histoire d'Italie écrite entre 1537 et 1540, traduite en latin en 1587 par son neveu Louis Guichardin, puis popularisée en français, notamment par les Maximes populaires de François Guicciardini, Gentilhomme florentin, traduites nouvellement par le Chevalier de Lescale (Paris, 1634), est probablement l'un des premiers à avoir souhaité que les souverains européens suivent l'exemple d'Auguste (éd. française : livre I, maximexcvi, 88-90) et à proposer dans son Avis un plan détaillé contenant même la mention d'un impôt par tête. Ainsi que l'écrit J. Hecht : « La leçon ne sera pas perdue, de Bodin à Vauban et Fénélon. »
En effet, l'auteur qui a exercé dans ce domaine de son temps comme aux siècles suivants l'influence la plus grande est peut-être Jean Bodin, connu non seulement pour sa Démonomanie des Sorciers (1580) et sa Réponse au paradoxe de M. de Malestroit (1568) où il établit certains fondements de la discussion moderne sur la circulation monétaire, mais aussi par son grand traité de science politique La République, paru en 1576. Tout le premier chapitre du livre VI est consacré à ce qu'il appelle la « censure » par un rappel sans équivoque du census romain : c'est, en effet, « l'estimation des biens de chacun ». Après s'être demandé « s'il est expédient de livrer le nombre des sujets et les contraindre de bailler par déclaration des biens qu'ils ont », Bodin entend démontrer que « les utilités qui reviendront au peuple du dénombrement des sujets seront incroyables et infinies ». D'après lui, le dénombrement fournira une base solide pour les levées de troupes, les réquisitions pour les corvées de travaux publics ou les colonies, l'approvisionnement des villes. Il supprimera un grand nombre de procès en matière de majorité d'âge, pour fait d'impôts ou pour fausse noblesse. Il permettra de constituer les états, corps et collèges selon les biens et âge de chacun, comme cela se faisait en Grèce et à Rome. Il sera indispensable pour recueillir les voix dans les élections. Indispensable aussi pour distinguer la population active des parasites. (« On verra aussi par le dénombrement, de quel métier chacun se mêle, de quoi il gagne sa vie, afin de chasser des républiques... les mouches, guêpes, qui mangent le miel des abeilles, et bannir les vagabonds, les fainéants, les voleurs. ») Le dénombrement des biens enfin est indispensable, « afin qu'on sache les charges que chacun doit porter ». Et de conclure sur cette perspective d'une « politique rationnelle » qui annonce très directement les ambitions ultimes des arithméticiens politiques du xviie siècle et les utopies rationalisatrices du xviiie siècle : en remédiant à la pauvreté extrême des uns et à l'excès de richesse des autres, on pourra peut-être éviter les séditions, troubles et guerres civiles.
Le succès de ce chapitre a été considérable : il a été, ainsi que l'indique encore J. Hecht, « constamment repris, plagié ou démarqué sans que les emprunteurs aient cru utile de citer leur source ». La démonstration des avantages démographiques, économiques, judiciaires, politiques, sociaux et fiscaux des dénombrements développée par Bodin se retrouve intégralement sans mention de leur auteur dans le Miroir des Français signé par N. de Montand. Et ce dernier est à son tour pillé sans vergogne, avec bien d'autres, dans le Traité de l'Économie politique (1615) d'Antoine de Montchrestien.
Montand est toutefois plus et mieux qu'un plagiaire. Il partage avec Nicolas Froumenteau, auteur du Secret des Finances de la France (1581), un souci d'information et de publicité statistique qui les distingue nettement de leurs contemporains. S'ils s'accordent sans mal avec Bodin sur ce qu'on peut appeler les données « de base » (enregistrement du mouvement de la population par les autorités ecclésiastiques et recensement), leur ambition va plus loin et touche à une témérité qui ne le cède en rien à celle des fondateurs britanniques de l'arithmétique politique. Ils cherchent en effet à évaluer l'impact de la guerre civile sur la population du royaume, critiquant au passage la légende des 1 700 000 ou 600 000 clochers, et s'étonnant que personne n'ait encore cherché à établir de tels chiffres avec précision du nombre des clochers, maisons et familles. Froumenteau avance pour sa part les chiffres de 100 000 paroisses ou clochers (132 000 avec les hameaux), alors que les historiens démographes estiment actuellement que 40 000 paroisses est un maximum, et de 3 500 000 à 4 millions de familles, maisons ou feux. Ils n'hésitent pas à risquer des chiffres (étonnamment précis) de maisons brûlées, personnes tuées (765 200 d'après Froumenteau), femmes violées, etc. Montand quant à lui donne de 600 000 à 4 millions de morts, 400 000 femmes et vierges prostituées et violées. Les statistiques économiques aussi leur semblent importantes, et l'on trouve chez eux l'idée, sinon du sondage, du moins de la monographie représentative.
Il n'est pas sans intérêt de noter que ces auteurs appartenaient à un groupe protestant « contestataire ». Peut-être faut-il rapprocher ce fait des déclarations de Sully qui, d'une part, mentionne une bonne douzaine de fois dans ses Économies royales (1611), généralement sujettes à caution, un « Cabinet d'archives » qu'il aurait décidé de créer en 1595 pour centraliser et conserver tous les documents recueillis, et qui n'aurait pas survécu à son départ des affaires en 1611, ainsi que, d'autre part, une instruction qu'il aurait donnée le 1er avril 1607 pour faire dresser un récapitulatif financier depuis 1598. Quelque crédit, limité semble-t-il, qu'il faille accorder à Sully comme mémorialiste, la convergence de ses préoccupations avec celles de Froumenteau et Montand, prolongeant les prises de position de Bodin, semble bien indiquer qu'en France, dès la fin du xvie siècle, les vues au moins doctrinales, voire théoriques sur le caractère irremplaçable des données sociales quantitatives exhaustives étaient fermement établies.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Bernard-Pierre LÉCUYER : ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de l'Université, directeur de recherche au CNRS
Classification
Média
Autres références
-
CONDORCET MARIE JEAN ANTOINE NICOLAS CARITAT marquis de (1743-1794)
- Écrit par Bernard VALADE
- 1 582 mots
- 1 média
Dans la dernière partie de l'Esquisse (neuvième et dixième époques), Condorcet est cependant revenu avec insistance sur ce qui lui paraissait être essentiel : l'application du « calcul des combinaisons et des probabilités » aux sciences politiques et, d'une façon plus générale, l'union des sciences... -
MONTESQUIEU CHARLES DE (1689-1755)
- Écrit par Georges BENREKASSA
- 7 181 mots
- 1 média
...(1734-1743), entre Bordeaux et Paris, Montesquieu progresse dans la phase la plus importante de l'élaboration des principes de L'Esprit des lois : il entreprend d'éclaircir le lien de causalités générales et particulières, ce qui détermine l'esprit, l'humeur, les mœurs des hommes, individuellement... -
PETTY sir WILLIAM (1623-1687)
- Écrit par Bernard DUCROS
- 597 mots
Tour à tour marin, chirurgien, membre du Parlement, homme public et homme d'affaires, sir William Petty est surtout connu pour ses écrits économiques. L'ensemble de son œuvre permet de le situer comme l'un des plus notables auteurs de transition entre les mercantilistes et les libéraux. Sa ...
-
RECENSEMENTS DE POPULATION (HISTOIRE DES)
- Écrit par Fabrice CAHEN
- 7 681 mots
- 4 médias
Depuis lacivilisation mésopotamienne, à l’origine des plus anciens dénombrements connus, jusqu’à la fin de l’Ancien Régime européen, le comptage humain consiste pour l’essentiel en un relevé partiel, et rarement réitéré, des individus ou foyers et des biens. Ces inventaires prennent des formes et...
Voir aussi
- BOTERO GIOVANNI (1543 env.-1617)
- CAUSALITÉ, sciences sociales
- COMPTABILITÉ SOCIALE
- ÉTAT CIVIL
- RECENSEMENT
- SCIENCES SOCIALES
- DÉNOMBREMENT
- CHINE, histoire : l'Empire, des Qin aux Yuan (1280)
- CHINE, histoire : l'Empire, des Yuan à la Révolution de 1911
- ÉGYPTE, histoire : l'Antiquité
- DÉMOGRAPHIE HISTORIQUE, Chine
- GRÈCE, histoire, Antiquité
- JAPON, histoire, des origines à 1192
- JAPON, histoire, période Tokugawa (1603-1868)
- MODÈLE, sciences sociales
- GRANDE-BRETAGNE, histoire, des origines au XIe s.
- GRANDE-BRETAGNE, histoire, les Stuarts (1603-1714)
- HISTOIRE SOCIALE
- CENSUS
- CATASTO
- CONRING HERMANN (1606-1681)
- SCHLÖZER AUGUST LUDWIG VON (1735-1809)
- DAVENANT CHARLES (1656-1714)
- ROME, des origines à la République
- ROME, l'Empire romain
- FRANCE, histoire, du Ve au XVe s.
- FRANCE, histoire, du XVIe s. à 1715
- KAUṬILYA ou KAUTALYA (IVe s.)