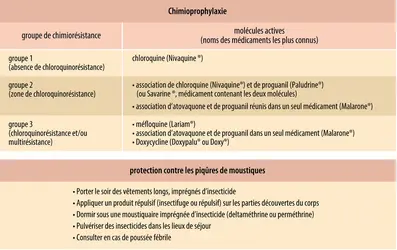- 1. Le paludisme : une maladie liée à un écosystème complexe
- 2. Une logique binaire du contrôle du paludisme
- 3. Se débarrasser des Plasmodiumpour lutter contre le paludisme
- 4. Tuer les anophèlespour se débarrasser du paludisme
- 5. Nécessité d’une approche multipolaire d’un écosystème pathogène
- 6. La vaccination contre le paludisme, la rupture ?
- 7. Bibliographie
- 8. Sites internet
PRÉVENTION DU PALUDISME
Article modifié le
Nécessité d’une approche multipolaire d’un écosystème pathogène
Il semble ainsi encore illusoire de s’appuyer sur une approche unique pour venir à bout d’une maladie liée à un écosystème complexe – à moins, bien sûr, de détruire celui-ci entièrement... Si la lutte contre le paludisme peine à sortir de sa relative stagnation, une approche combinée, nourrie de toutes les connaissances sur la biologie du Plasmodium et de son vecteur, fait cependant reculer la maladie dans des zones de surface quelque peu étendues. L’éradication de la maladie dans le nord de la Palestine (alors sous mandat britannique) et ailleurs sur le pourtour méditerranéen, en moins de cinq ans (1922-1926), sous l’impulsion de la fondation Rockefeller et du comité d’hygiène de la SDN, nous fournit le seul succès notable, bien que fragile, de la lutte contre le paludisme entre les deux guerres mondiales grâce à une approche multipolaire. Cette dernière repose tout d’abord sur une description précise de chaque zone impaludée : faune, flore, salinité, type de vecteurs et leur biologie, type de Plasmodium, habitat humain, mortalité, morbidité... On utilise alors simultanément tous les moyens jugés alors les plus appropriés : drainage, pompage des canaux, insecticides, désherbage des rives, quinine (remplacée au fil du temps par d’autres antipaludéens) et destruction des foyers de ponte des anophèles. Les résultats obtenus sur de telles parcelles, s’ils sont significatifs, ne sont stables que dans les régions où la réinfestation n’est pas possible.
On peut aussi mettre l’accent sur les zones qui entourent immédiatement l’habitat
humain : des actions de moindre envergure que les précédentes, mais chacune partiellement efficace, peuvent donner d’excellents résultats lorsqu’elles sont associées, comme l’écrit déjà, en 1910, Nicolaas Swellengrebel, dans un rapport établi en Indonésie – dont il proposera de nouveau les conclusions à la Société des Nations en 1925. Ces gestes sont simples : éliminer les lieux de ponte des anophèles en supprimant l’eau stagnante autour des abreuvoirs et des puits, vider les récipients, dégager les rives des mares et des rivières, utiliser des moustiquaires, se protéger la nuit (lorsque les moustiques piquent), limiter le travail de nuit sans protection, soigner chaque cas de paludisme dès son apparition... L’amélioration de l’habitat – peinture blanche, pose de grillages fins sur les fenêtres, etc. – fait partie intégrante de la démarche. Pour que cette lutte soit efficace, la population doit impérativement être impliquée dans ces actions. Les mots clés de la lutte antipaludique deviennent alors : étude locale de la maladie et de son écosystème, éducation et sensibilisation des populations dans les zones impaludées, combinaison de méthodes, action quotidienne et prise de conscience que l’on peut venir à bout de la maladie. Les gestes de lutte contre la maladie et son vecteur doivent devenir automatiques dans le cadre de la construction d’une véritable culture antipaludique.
En Afrique de l’Ouest, une initiative forte est venue des mouvements communautaires de lutte antipaludéenne, et l’implication de la population s’est amplifiée. Ces mouvements s’appuient sur l’organisation des villages et non sur un réseau de médecins et d’experts venus « d’en haut ». La prise en charge de la maladie est locale, largement démédicalisée ; les femmes y occupent généralement une place essentielle en ce qui concerne le respect des protections (moustiquaires, élimination des eaux stagnantes…), le diagnostic et le traitement des cas de fièvre en particulier chez les jeunes enfants, le médecin n’intervenant qu’en cas de persistance de la maladie. Faute de moyens, cette initiative s’est développée trop lentement. Depuis 2000, le Fonds mondial de lutte contre la tuberculose, le sida et le paludisme ainsi que la fondation Melinda-and-Bill-Gates puis, depuis 2005, le programme RBM (pour Roll Back Malaria) de l’OMS et d’autres sources de financement comme la Banque islamique de développement contribuent, à côté des programmes nationaux de lutte contre le paludisme, à renforcer ces actions communautaires qui sont les seules à même d’impliquer directement les populations. Il est difficile de connaître les coûts réels d’une telle stratégie, sans doute de l’ordre de quelques milliards de dollars chaque année pour l’ensemble de l’Afrique intertropicale. Ces financements permettent de mettre à disposition des moyens tels que des kits de diagnostic et de traitement initial par les antipaludéens localement appropriés, mais aussi des insecticides à effet retard à usage domiciliaire et des moustiquaires imprégnées d’insecticides à base de dérivés du pyrèthre, qui est une molécule naturelle. Pour ne prendre que l’exemple du Sénégal, les comités de salubrité des villages luttent contre les gîtes larvaires ; les caisses de solidarité viennent en aide aux personnes démunies pour l’achat de médicaments et de moustiquaires imprégnées ; les conseils de village, dirigés par les chefs de village, avec comme autres membres l’imam local, les groupements de femmes, les agents de santé communautaires, les enseignants… impulsent les activités de prévention quotidienne du paludisme à l’échelon de chaque localité. À ces réalisations s’ajoute l’institutionnalisation du « mois du paludisme » pour renforcer les mesures de prévention au moment du développement des larves. Selon l’OMS, le Sénégal est ainsi entré en 2013 dans une situation de prééradication du paludisme, du moins en milieu rural – la situation des villes est en effet plus complexe à gérer. D’autres États africains sont sur la même voie.
On sait l’importance en Occident des associations de malades pour la prise en charge des longues maladies. Il n’est pas inutile de rappeler à ce propos que les premières unions ouvrières dans les mines en Espagne et agricoles dans les rizières en Italie au début du xxe siècle étaient en partie liées à la revendication d’une lutte contre le paludisme.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Gabriel GACHELIN : chercheur en histoire des sciences, université Paris VII-Denis-Diderot, ancien chef de service à l'Institut Pasteur
Classification
Médias
Voir aussi
- ANOPHÈLE
- PLASMODIUM
- INSECTICIDES
- QUINQUINA
- RÉSISTANCE, biologie
- VECTEUR, infectiologie et parasitologie
- SANTÉ DANS LE MONDE
- MALADIES TROPICALES
- ANTIPALUDÉENS MÉDICAMENTS
- MÉDECINE PRÉVENTIVE ET PRÉVENTION MÉDICALE
- PIQÛRES D'INSECTES
- MOUSTIQUAIRE
- ARTÉMISININE
- GAMBUSIA
- GRASSI GIOVANNI BATTISTA (1854-1925)
- CELLI ANGELO (1857-1914)
- SWELLENGREBEL NICOLAAS H. (1885-1970)