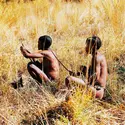- 1. Diagnose
- 2. Classification
- 3. Catégories systématiques (groupes zoologiques)
- 4. Habitat et comportement alimentaire
- 5. Biologie sexuelle et reproduction
- 6. Structures sociales
- 7. Dynamique des groupes sociaux
- 8. Ontogenèse
- 9. Socialisation des jeunes
- 10. Modes de communication
- 11. Processus cognitifs
- 12. La culture chez les primates non humains
- 13. Protection et conservation des Primates
- 14. Bibliographie
PRIMATES
Article modifié le
Modes de communication
Le développement des capacités de communication des Primates est lié à la fois à leur mode de vie (facteurs écologiques) et à la nature et à l'intensité de leurs interactions sociales (facteurs psychiques et phylogénétiques).
Échanges d'informations
Le terme communication recouvre des processus interactifs d'échanges d'information par l'intermédiaire de signaux entre deux individus de la même espèce, tour à tour émetteur et récepteur. La première approche consiste en l'identification de ces signaux, selon les différentes modalités sensorielles. C'est au cours de l'évolution que la nature et la structure de ces signaux ont été élaborées, créant des configurations discrètes, stéréotypées, d'actions, les isolant en les différenciant d'une infinité de configurations possibles qui constituent autant de stimuli potentiels. Chez les Primates, on observe plusieurs niveaux de communication ; on distinguera une « communication différée » (Charles-Dominique, 1976) d'une « communication interactive ».
Dans la communication différée, il n'y a pas à proprement parler d'interactions, l'émission et la réception du signal était séparées dans le temps et/ou dans l'espace ; l'information transite par une seule modalité sensorielle. Le niveau d'individualisation de l'animal émetteur par son congénère récepteur est nul à moins qu'il ne dépende de la dynamique sociale des espèces (c'est-à-dire qu'il y aura eu nécessairement, au préalable, une familiarisation des protagonistes, par exemple avant l'émigration ou l'éviction de l'un des deux).
Dans la communication interactive, il peut, ou non, y avoir un double processus d'échange, une réponse manifeste, mais il y a individualisation de l'émetteur. L'émission et la réception du signal peuvent se faire selon plusieurs modalités : la « multimodalité » est possible.
Mécanismes de communication différée
Ce processus de communication différée intervient lorsque la distance interindividuelle est grande ; il utilise essentiellement le mode olfactif et sonore, et concerne souvent des spécialisations anatomiques particulières. La production de signaux olfactifs est très développée chez les Prosimiens et certains Singes du Nouveau Monde, mais très peu chez ceux de l'Ancien Monde. Les Prosimiens possèdent des glandes spécialisées au niveau de la partie ventrale du cou (Mirza, Phaner, Hapalemur, Varecia, Indriidés), des glandes sternales (Otolemur), épigastriques (Tarsius), mais aussi brachiales et antébrachiales (Lemur et Hapalemur), et au niveau du front (Lemur) et du coude (Tarsius). Chez la plupart des Lorisiformes et chez les lémurs, il existe aussi (ou uniquement) des zones glandulaires circumgénitales, chez le mâle ou chez les deux sexes (Epple, 1986). On retrouve ces mêmes zones, pour les deux sexes, chez tous les Callithricidés (Platyrhiniens), avec en plus la présence de glandes sternales. Seules ces dernières sont présentes chez les Cébidés et les Atélidés. Chez les Catarhiniens, la présence de zones glandulaires sternales, non spécialisées, n'a été signalée que chez quelques espèces du genre Papio, Cercopithecus, Colobus, Hylobates et chez l'orang-outan. Les Panidés possèdent, quant à eux, des zones glandulaires axillaires. La présence de ces glandes n'est associée à des comportements de « marquage » différenciés que chez les Prosimiens et les Platyrhiniens. Parmi les Catarhiniens, équipés de zones glandulaires, seules quelques espèces de Cercopithécidés présentent ces types de comportements (Cercopithecus neglectus, C. hamlyni, C. aethiops, Allenopithecus, Papio leucophaeus, Colobus verus ; Loireau, 1985). Dans de nombreux cas, chez les Prosimiens nocturnes et diurnes, chez les Platyrhiniens, voire chez le cercopithèque de Brazza, l'imprégnation de l'environnement par des marques odorantes facilite l' orientation spatiale et l'individualisation du domaine vital.
Processus interactifs de communication
Ici la communication olfactive à fonction territoriale n'est pas différée et est incluse dans des échanges « multimodaux » ; le marquage olfactif est alors associé à des vocalisations puissantes émises par des adversaires en contact visuel (Propithecus, Mertl-Millhollen, 1979 ; Callicebus, Mason, 1968 ; Saguinus, Dawson, 1979). Au cours des conflits de frontières, mettant en présence deux groupes antagonistes, les Lemur catta passent leur queue entre leurs jambes, l'enduisant d'urine puis l'agitent au-dessus de leur tête tout en vocalisant en direction des adversaires (Jolly, 1966).
La régulation de l'utilisation de l'espace se fait plus généralement, chez les Primates diurnes, par le biais de vocalisations qui constituent une « proclamation », par un groupe social, de l'occupation d'une zone défendue ou non. Il est intéressant de noter que chez les Indriidés (Prosimiens), le propithèque utilise le marquage olfactif aux frontières de son territoire et intensifie ces marquages au cours des rencontres avec d'autres groupes alors que l'indri marque partout de la même manière son territoire, mais émet des vocalisations puissantes qui sont appelées « chants », comme chez les gibbons (Pollock, 1986). Les cris peuvent être émis en duos plus ou moins organisés aussi bien chez les Prosimiens (Indri, cf. supra) que chez des Platyrhiniens (Callicebus, Robinson, 1979) ou les Hylobatidés (Deputte, 1982 ; Mitani, 1985). Les mâles hurleurs (Alouatta), quant à eux, émettent leurs puissants rugissements en chœurs. La puissance des cris est fonction de la taille de l'émetteur, que ce soit chez divers Prosimiens (Otolemur, Tandy, 1976, Galago senegalensis, Zimmermann, 1985), ou chez la plupart des Catarhiniens forestiers, Cercopithécidés (Cercopithecus, Cercocebus, Lophocebus, Colobus guereza, Presbytis entellus, Macaca silenus) et Anthropoïdes (chimpanzé, gorille, orang-outan).
La plupart du temps émises spontanément, le matin ou en réponse à des cris émis par les autres groupes composant la population, ces vocalisations existent, que les espèces soient territoriales ou non, et quels que soient la structure sociale et le niveau phylogénétique. Les cris ont une bonne pénétration en milieu forestier : leur portée atteint ou dépasse 1 km (Lophocebus, Indri, Hylobates, Alouatta), quoique la réverbération sur le feuillage et le bruit de fond (cris d'insectes essentiellement) représentent deux handicaps sérieux. C'est pourquoi l'heure où ils sont émis (le matin dès avant l'aube), le lieu d'émission (à partir de points élevés dans la forêt), une fréquence d'émission inférieure à 1 kHz, une durée importante et/ou une répétitivité confèrent à ces cris une capacité de propagation optimale, un rapport signal/bruit élevé et une atténuation minimale (Waser & Brown, 1986).
Chez de nombreuses espèces, ces cris comportent deux composantes, une vocalisation grave (< 1 kHz) et une vocalisation plus ou moins aiguë et modulée. Chez les Cercopithécidés, la vocalisation la plus grave est émise la première (Gautier & Gautier, 1977), mais, chez Callicebus, c'est la vocalisation aiguë. Chez les espèces territoriales, l'émission de ces cris forts est plus fréquente le long des frontières et/ou sur les points les plus élevés des territoires (Callicebus, Robinson, 1979 b ; Hylobates, Mitani, 1985 ; H. symphalangus, Chivers, 1976). Les cris forts ne sont l'apanage des mâles que chez quelques Prosimiens (Otolemur, Lemur), les Cercopithécinés et les Colobinés, l'orang-outan et le gorille. Chez les autres genres, ils peuvent être émis par les mâles et les femelles. Il existe alors souvent un dimorphisme sexuel de ces cris en ce qui concerne soit leur structure, soit leur puissance d'émission (Hylobatidés, Marler & Tenaza, 1977 ; Callicebus, Robinson, 1979 ; Alouatta, Baldwin & Baldwin, 1976).
Les duos « bisexués » signalent aux autres membres de la population que la zone est occupée par un couple constitué ; les chants « solos » des mâles célibataires sont, quant à eux, plus susceptibles d'attirer les jeunes femelles adultes que de distancier les autres couples (Hylobates, Deputte, 1982 ; Mitani, 1985). Chez les Cercopithécidés, les cris forts apparaissent « brutalement » à la maturité sexuelle des mâles. Ils représentent alors le plus souvent des « acquisitions » nouvelles du répertoire vocal.
Une autre catégorie de cris puissants existe chez les singes forestiers mais aussi chez ceux de savane comme les babouins : Gautier (1975) les nomme « cris forts de deuxième catégorie ». Ce sont des cris d'alarme ou des dérivés de ces cris, organisés en séquences stéréotypées. Ils présentent, dans ce cas, une certaine ou une totale spécificité sexuelle, qui en fait alors l'apanage des mâles (Gautier, 1975 ; Waser, 1982). Contrairement à l'autre type de cri fort, ils n'ont pas subi, au cours de l'évolution, de modifications structurales particulières pour en augmenter la portée. Chez les Cercopithèques, leur association avec des cris de basse fréquence confère à l'ensemble de ces séquences stéréotypées une double fonction d'espacement (ou au moins de proclamation) et de ralliement des partenaires du groupe (Gautier, 1975 ; Gautier & Gautier, 1977). Ces cris possèdent enfin une dernière particularité, celle d'être spécifiques. Leur haute spécificité en fait des indices importants pour la détermination des sous-espèces voire des espèces (Struhsaker, 1970 ; Demars & Goustard, 1978 ; Oates & Trocco, 1983 ; Snowdon et al., 1986 ; Haimoff et al., 1987 ; Gautier, 1988).
Cohésion sociale
Cris de ralliement
Un des traits importants de la communication vocale est qu'elle peut assurer le maintien de contacts, donc la cohésion de l'ensemble d'un groupe, quelle que soit la nature du milieu et/ou la visibilité entre les différents partenaires. Ces types de vocalisations existent chez tous les Primates, y compris chez les Prosimiens nocturnes (Galago, Nycticebus, Euoticus, Galagoïdes, Arctocebus ; Petter & Charles-Dominique, 1979 ; Zimmerman, 1985). Ce sont des cris graves ou aigus, trillés ou non, souvent émis en séquence et qui ont un caractère tonal : c'est-à-dire que ce sont des sons purs dont un nombre variable d'harmoniques est audible. Chez les Cercopithécidés et les Anthropoïdes, ils sont souvent qualifiés de « grognements » (grunts des Anglo-Saxons) en référence à la présence d'une structure « bruyante » plus ou moins marquée, en particulier chez les adultes.
Ils possèdent, comme d'ailleurs la plupart des cris, des caractéristiques individuelles qui permettent une « personnalisation » des échanges vocaux quand ce seul mode (phonation/audition) est mis en jeu. Cette individualisation des signaux sonores est la conséquence de la nature et de la durée de l'ontogenèse. Les contacts étroits initiaux entre les jeunes et les autres partenaires, dont la mère, entraînent une multimodalité des signaux, au niveau de leur émission et de leur perception. Le développement des capacités de « généralisation » assure au jeune une « individualisation multimodale » des partenaires (visuelle, auditive, olfactive), et le développement des capacités de « transposition intersensorielle » lui permet une reconnaissance totale quel que soit le nombre et/ou la nature de la modalité accessible. Les interactions au cours desquelles est assurée la régulation des contacts et des distances interindividuelles permettent périodiquement la récurrence de cette multimodalité d'individualisation.
Communication visuelle et gestualité
À courte distance, le signal sonore devient complémentaire ou redondant des autres signaux, la gestualité et les mimiques faciales représentant le mode communicatif essentiel. Lorsque le contact se réalise, le tact et l'olfaction sont impliqués ou potentiellement impliqués dans ce que Goldfoot (1982) nomme une multimodalité séquentielle. C'est à partir de cette richesse signalétique potentiellement disponible en permanence que se construit l'expérience sociale du jeune. Lorsque, lors d'interactions, plusieurs modalités d'expression et/ou de perception sont disponibles, l'interprétation des messages par les protagonistes dépasse alors souvent le décodage des seuls « signaux » émis.
La gestualité est généralement très peu stéréotypée, c'est-à-dire très peu « signalétique » : l'un des signaux posturaux les plus répandus chez les Cercopithécidés est la « présentation », qui consiste pour un individu à se tourner devant un congénère et à lui « exposer » sa région ano-génitale. La signification sexuelle de ce geste n'est évidente que lorsqu'elle est manifestée par une femelle adulte à l'égard d'un mâle. Or cette posture apparaît dans de nombreuses autres combinaisons (mâle-mâle, jeune-femelle, femelle-femelle, etc.) ; sa causalité et sa fonction dépassent alors le cadre de la seule sexualité (Hausfater & Takacs, 1987).
Les mimiques faciales ne sont particulièrement développées que chez les espèces de milieu ouvert et/ou à partir d'un certain niveau phylogénétique (babouins, macaques, chimpanzé, orang-outan). Elles représentent alors des combinaisons complexes entre la fixation du regard, les mouvements des sourcils, de paupières, des oreilles, plus ou moins plaquées contre les tempes, du scalp, des lèvres (Angst, 1974). Chez la plupart des espèces, des Prosimiens aux Anthropoïdes, la bouche et les yeux représentent les deux composantes de base, donc « universelles », des mimiques faciales. En particulier, la fixation visuelle et l'ouverture de la bouche représentent, isolément pour la première, ou en association, une « menace », signal de distanciation interindividuelle. Le caractère universel de cette mimique est renforcé par son association avec une posture « prêt à bondir » et avec une association très spécifique avec un type vocal particulier (ici différent selon les espèces). Pour un jeune, le « décodage » de ce signal ne s'établit que progressivement au cours de l'ontogenèse et il est souvent facilité par des signaux tactiles d'agrippement brutal ou de morsures.
Formes de contacts interindividuels
La réalisation de contacts, durables, mettant en jeu plus que la main, seule, traduit le caractère « affiliatif » d'une interaction. Chez les Lophocèbes, ces contacts corporels peuvent revêtir des formes extrêmement variées, impliquant pour leur réalisation de nombreux réajustements posturaux de la part des deux partenaires (comportements « posturo-tactiles », Deputte, 1986 et 1987). Ils sont aussi souvent associés à des vocalisations émises en chœur, qui confèrent à l'ensemble de l'interaction un caractère notoire de renforcement « généralisé » des liens sociaux. Mais le contact tactile commun à la quasi-totalité des Primates est le toilettage social ou « épouillage » ; ce contact est très généralement asymétrique, un individu épouillant un partenaire qui, quant à lui, se détend, s'expose à l'épouillage. Ainsi la fonction de ce comportement dépasse le simple déparasitage externe et maintient ou renforce la cohésion entre les individus.
Les Prosimiens effectuent cet épouillage, en écartant la fourrure du partenaire avec les mains puis en prélevant les particules de peau desquamée ou les parasites avec les dents, grâce au « peigne dentaire » formé par les incisives et les canines modifiées. Les autres singes utilisent également la bouche (lèvres, dents, langue) pour nettoyer la peau et/ou la fourrure du partenaire. Il s'est ainsi développé un signal à la fois visuel et sonore, dérivé de la motricité de succion du nouveau-né, le « claquement de lèvres » (Chevalier-Skolnikoff, 1974). Ce signal s'est « émancipé » d'une liaison absolue avec l'épouillage : manifesté lors d'un contact visuel, précédant ou accompagnant une approche, il la qualifie en indiquant la nature affiliative de l'interaction subséquente.
Attractivité interindividuelle
Le comportement olfactif ne joue plus chez les Cercopithécidés de rôle dans le comportement territorial, mais chez l'ensemble des Primates il est impliqué dans la sexualité et constitue de plus l'un des premiers indices stables d'individualisation. En fait, si les structures réceptrices ont perdu chez les Simiens de leur importance anatomique, les structures d'intégration de l'information n'ont que très peu régressé. Le jeune, chez les Catarhiniens, est manipulé dès sa naissance par sa mère et par d'autres membres du groupe. Au cours de ces manipulations, les parties génitales sont particulièrement flairées ; les partenaires se constituent ainsi très précocement une véritable « carte d'identité olfactive » du jeune (Gautier-Hion, 1971). Il a été montré, chez les saimiris, que les enfants étaient capables de discriminer olfactivement leur mère dès un mois (Kaplan et al., 1977). À cet âge, l'odeur de la mère constitue la base essentielle d'identification de l'objet d'attachement. Les comportements posturo-tactiles des lophocèbes s'accompagnent souvent du flairage des parties génitales, renforçant ainsi à la fois le lien social et sa « personnalisation ». L'olfaction, en ce qui concerne la sexualité, est impliquée dans une multimodalité séquentielle au cours de laquelle sont successivement échangés des signaux visuels, voire sonores, des informations tactiles et olfactives. L'état de réceptivité des femelles est ainsi perçu par les mâles selon plusieurs canaux et les informations olfactives, en particulier, stimulent leur comportement sexuel (érection) ou restaurent l'attractivité des femelles (Keverne, 1982).
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Bertrand L. DEPUTTE : docteur en éthologie, docteur ès sciences, professeur à l'École nationale vétérinaire d'Alfort
Classification
Médias
Autres références
-
BABOUIN
- Écrit par Marie-Claude BOMSEL
- 414 mots
- 2 médias
Singe au corps puissant, caractérisé par un museau allongé et nu comme celui du chien, d'où leur autre nom commun de cynocéphale (signifiant « tête de chien »). Répartition géographique : Afrique centrale, Afrique du Sud et Arabie. Habitat : savanes, collines rocheuses et forêts. Classe : Mammifères...
-
CERCOPITHÈQUE
- Écrit par Marie-Claude BOMSEL
- 436 mots
Singe de taille moyenne, au corps svelte et à longue queue non préhensile, vivant dans les forêts africaines, au sud du Sahara. Classe : Mammifères ; ordre : Primates ; famille : Cercopithécidés.
Autrefois appelés « guenons », les cercopithèques, représentés par plus de vingt espèces,...
-
CHASSEURS-CUEILLEURS (archéologie)
- Écrit par Jean-Paul DEMOULE
- 4 728 mots
- 3 médias
-
CHIMPANZÉ
- Écrit par Marie-Claude BOMSEL
- 639 mots
- 1 média
- Afficher les 28 références
Voir aussi
- MIMIQUE
- FÉCONDITÉ
- MONOGAMIE ANIMALE
- DÉVELOPPEMENT ANIMAL ou ONTOGENÈSE ANIMALE
- ESPRIT THÉORIE DE L'
- GLANDES
- PLACENTAIRES ou EUTHÉRIENS
- NEUROCRÂNE
- CYCLE ŒSTRAL
- SEXUEL COMPORTEMENT
- PLANTIGRADES
- PROSIMIENS
- LEMURIDAE ou LÉMURIDÉS
- INDRIDAE ou INDRIIDAE
- DAUBENTONIIDAE
- LORISIDÉS
- TARSIERS
- SINGES
- PLATYRHINIENS ou PLATYRRHINII
- CATARHINIENS ou CATARRHINII
- ANIMAL LANGAGE
- RÉPARTITION DES FLORES & DES FAUNES
- SIMIENS ou ANTHROPOIDEA
- ŒSTRUS
- EXTINCTION ou DISPARITION DES ESPÈCES
- CHEIROGALEIDAE
- GALAGIDAE
- ATÉLINÉS
- COLOBINÉS
- GROUPEMENTS ANIMAUX
- ANIMAL RÈGNE
- ANATOMIE ANIMALE
- POIL
- ONGLE
- PONGIDÉS ou PONGIDAE
- ODORANTES GLANDES
- ACCOUPLEMENT
- ANTHROPOMORPHES
- HYLOBATIDÉS ou HYLOBATIDAE
- ENVIRONNEMENT, droit et politique
- ATTACHEMENT THÉORIE DE L'
- ANTHROPISATION
- MÈRE-ENFANT RELATION
- POPULATIONS ANIMALES & VÉGÉTALES
- GESTATION
- HERBIVORES
- DOIGTS, zoologie
- CHANT, éthologie
- COMMUNICATION ANIMALE
- BIODÉMOGRAPHIE
- STÉRÉOTYPES COMPORTEMENTAUX
- MARQUAGE DU TERRITOIRE, éthologie
- ALARME, éthologie
- ATTRACTION, éthologie
- LÉMURIFORMES
- STREPSIRHINES
- HAPLORHINES
- CERCOPITHÉCOÏDES
- CERCOPITHÉCINÉS ou CERCOPITHÉCIDÉS
- GELADAS
- HOMINOÏDES
- PITHÉCINÉS
- RHINARIUM
- ATÉLIDÉS
- LORISIFORMES
- MEGALAPIDAE
- AYE-AYE
- ATÈLES
- CALLIMICO
- CALLITHRICIDÉS
- CÉBIDÉS
- MURIQUIS
- SAQUIS
- OUAKARIS
- MANGABEY
- NASIQUE
- PROTECTION ou CONSERVATION DES ESPÈCES
- ANIMAUX SAUVAGES EXPLOITATION DES