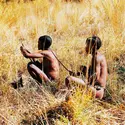- 1. Diagnose
- 2. Classification
- 3. Catégories systématiques (groupes zoologiques)
- 4. Habitat et comportement alimentaire
- 5. Biologie sexuelle et reproduction
- 6. Structures sociales
- 7. Dynamique des groupes sociaux
- 8. Ontogenèse
- 9. Socialisation des jeunes
- 10. Modes de communication
- 11. Processus cognitifs
- 12. La culture chez les primates non humains
- 13. Protection et conservation des Primates
- 14. Bibliographie
PRIMATES
Article modifié le
Protection et conservation des Primates
L'étude des Primates actuels promet encore de nombreux étonnements et l'ancienne « voie royale des Prosimiens à l'Homme » paraît aujourd'hui, plus que jamais, buissonnante. Les adaptations les plus complexes, les solutions les plus surprenantes qu'ils donnent aux mêmes problèmes ne doivent pas faire oublier que la première caractéristique des Primates, et des Simiens en particulier, est l'absence, ou le faible niveau, de spécialisation comportementale liée à la grande plasticité que leur confère une ontogenèse lente au sein d'un environnement social qui constitue le réservoir des acquisitions antérieures.
Cette fascinante « plongée » vers nos origines risque de tourner court du fait de nos propres facultés d'adaptation. L'Homme, le plus évolué d'entre les Primates, a le pouvoir paradoxal à la fois de se connaître et de supprimer toutes les traces de sa propre histoire.
Quelque 75 espèces de Primates sur 188 sont menacées : le tamarin-lion (Leontopithecus), de l'est du Brésil, ne compte plus que 300 à 400 individus, le muriqui (Brachyteles arachnoides), du sud-est du Brésil, ne compte plus que quelques troupes dispersées, et maintes autres espèces deviennent ainsi trop résiduelles pour survivre.
Dégradation des habitats
Le phénomène s'amplifie de jour en jour aussi bien en Amérique du Sud qu'en Afrique (et Madagascar) et en Asie (Chine et Asie du Sud-Est) : de nombreux habitats composés autrefois de forêts continues sont réduits de plus en plus à des îlots conditionnant dramatiquement la densité potentielle des espèces qu'ils abritent. De plus, l'exploitation des forêts est généralisée et constitue souvent la principale richesse économique du pays. La conversion des forêts en terres agricoles ou en zones d'élevage, la construction de vastes projets hydroélectriques ou de voies de communications sont d'autres raisons de destruction des habitats des Primates et de l'isolement des populations. Kalimantan (partie indonésienne de l'île de Bornéo) abrite plusieurs espèces de primates non humains et notamment l'orang-outan. Cette région a vu ses habitats forestiers réduits de 50 p. 100 de 1960 à 1990, et le phénomène s'est accéléré depuis lors. La forêt recule du fait de déboisements légaux et illégaux, de feux de forêts, et est remplacée par des plantations de palmiers à huile (Rijksen et Meijaard, 1999). Partout dans le monde, les forêts tropicales disparaissent à raison de 10 à 20 millions d'hectares par an. Tous ces bouleversements sont liés directement ou indirectement à l'explosion démographique humaine.
Destruction des populations
Si en Amazonie et en Afrique les Primates sont chassés pour leur viande, qui représente une source de protéines non négligeable, une autre menace majeure pour les Primates est la capture d'individus vivants à des fins commerciales directes ou indirectes, pour des particuliers ou pour la recherche biomédicale. Or, quels que soient l'intérêt et l'émerveillement qu'il suscite, le Primate ne peut être un animal de compagnie. Les jeunes sujets doivent effectuer leur ontogenèse dans un environnement social spécifique, et leur grande longévité est un facteur rarement pris en compte par les acquéreurs illégaux de ces animaux.
Sauvegarde des espèces
La convention C.I.T.E.S. (Convention of Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna), de même que le dynamisme et la compétence de grands organismes internationaux tels que l'U.I.C.N. (Union internationale pour la conservation de la nature, devenue Union mondiale pour la nature) ont permis un effort essentiel contre les trafics et pour une utilisation rationnelle des milieux naturels. En Ouganda, il a été montré qu'un abattage sélectif des arbres pouvait représenter un compromis acceptable entre une nécessité économique et la conservation des populations de Primates (Skorupa, 1986).
La disparition des habitats, le commerce de la viande de brousse et d'autres trafics affectent particulièrement les populations d'anthropoïdes, plus sensibles que les autres espèces en raison des caractéristiques de leurs « traits d'histoire de vie » (longue ontogenèse, faible fertilité, long intervalle entre les naissances, etc.). Ces phénomènes s'accompagnent de l'augmentation croissante d'orphelins. Ceux-ci, récupérés par les populations locales, sont alors confiés à des orphelinats créés par des personnes particulièrement sensibilisées à la disparition de ces espèces (par exemple, pour la République démocratique du Congo, les associations H.E.L.P. Congo, pour les Chimpanzés communs – Pan troglodytes –, et Lolaya Bonobo, pour les Pan paniscus). Le dévouement de ces personnes se heurte à la grande difficulté de réhabiliter puis, éventuellement, de réintroduire les individus dans le milieu naturel réduit et où survivent des groupes sauvages.
Le moyen le plus sûr de conserver les espèces de primates non humains passe par la conservation de leurs habitats (pour Kalimantan, projet Kalaweit pour la sauvegarde des gibbons ; projet Hutan – encore appelé Kinabatangan Orang-Utan Conservation Project – à Bornéo dans l'État de Sabah, pour les orang-outans). Cette conservation doit s'accompagner de la compréhension de la dynamique des populations qui doivent être protégées. Ces études, qui ont progressivement remplacées celles qui étaient de nature écologique, permettent de comprendre la structure des populations et le sort des individus arrivés à maturité sexuelle. Elles s'accompagnent souvent d'un suivi génétique des populations. De tels travaux sont notamment menés sur le gorille de plaine (Gorilla gorilla gorilla) en République démocratique du Congo, aux confins du Gabon, sur des sites particuliers que sont des clairières salifères (Gatti et al., 2004 ; Levréro et al., 2006). Ils ont permis de mettre en évidence la complexité des structures sociales de ces populations pour lesquelles un grand nombre de groupes (37) peut être identifié. À cet aspect fondamental s'est ajouté un aspect épidémiologique. Cette population a en effet été touchée, en 2004, par une épidémie à virus hémorragique de type Ebola. La structure sociale de ces populations – petits groupes comportant un mâle, plusieurs femelles adultes et leurs jeunes immatures – a conduit à une transmission rapide du virus, les individus périphériques étant les plus épargnés (Caillaud et al., 2006).
Les magots, ou macaques de Berbérie (Macaca sylvanus), vivent dans des milieux méditerranéens relativement sensibles et soumis depuis très longtemps à des pressions humaines variées. La dégradation et le morcellement des forêts ont conduit à la réduction et au fractionnement des populations de cette espèce typiquement forestière, qui ne sont plus que résiduelles en Algérie et au Maroc. Le principal réservoir de l'espèce, environ les trois quarts des effectifs, est localisé au Moyen Atlas au Maroc, dans des cédraies-chênaies sempervirentes (Ménard & Quarro, 1999). Cette population pose cependant de gros problèmes aux gestionnaires du cèdre qui considèrent les singes comme nuisibles, puisque, depuis les années 1980, ces animaux écorcent les arbres de manière assez intensive. Cette dérive du comportement alimentaire, conséquence du morcellement des populations, est antagoniste avec les activités de production de bois de cèdre, économiquement importante pour le Maroc. L'écorçage par les singes peut être considéré comme un indicateur d'un déséquilibre profond de l'écosystème dû au surpâturage et aux modifications des pratiques de sylviculture.
Les anthropoïdes sont l'objet d'une attention particulière de la part des médias, mais aussi d'un nombre croissant de scientifiques. Le philosophe australien Peter Singer va jusqu'à vouloir leur accorder un droit. La continuité d'états mentaux évoquée précédemment ne doit pas conduire à nier le fait que Homo sapiens a acquis, au cours de son évolution, des capacités adaptatives particulières, le conduisant à se pencher sur les espèces avec lesquelles il possède l'ancêtre commun le plus récent. Budiansky (1998) souligne cet « antropomorphisme de la pire espèce que pour être vraiment merveilleuse, une [intelligence] doit être la même que la nôtre ». Toutes les espèces de primates non humains méritent le même respect et l'homme doit avoir les mêmes devoirs envers elles. Il reste que les caratéristiques biologiques des anthropoïdes nécessitent des mesures particulières. Le Great Apes Survival Project (Grasp) de l'U.N.E.S.C.O. a pour objectif de mettre en œuvre tous les moyens possibles pour maintenir ces populations particulièrement sensibles. La déclaration de Kinshasa, en septembre 2005, a souligné que les racines du braconnage et de la déforestation sont à rechercher dans la pauvreté des populations locales. Une telle analyse pragmatique est probablement en mesure de déboucher sur des réalisations plus concrètes que l'attribution de droits aux anthropoïdes ou de nier, tout en reconnaissant le contexte d'une continuité évolutive, les différences évidentes entre Homo sapiens et toutes les autres espèces de primates non humains quelles qu'elles soient.
L'International Primatological Society (I.P.S.) est une société scientifique qui regroupe tous les chercheurs ayant des Primates comme sujets de recherches écologiques, éthologiques, physiologiques et biomédicales. En son sein, les actions de conservation se développent de même que l'éthique nécessaire lors de l'utilisation de Primates. De nombreuses sociétés nationales de primatologie se sont créées au sein de l'I.P.S., de manière à renforcer son impact auprès des organismes gouvernementaux. En France, la Société francophone de primatologie (S.F.D.P.) a été créée en 1987. Ses buts sont ceux de l'I.P.S. à laquelle elle est affiliée, et en particulier elle souhaite faire prendre conscience à tous les chercheurs, mais aussi à tous les organismes possédant des Primates (parcs zoologiques publics et privés), de la rareté et du caractère exceptionnel des sujets qu'ils détiennent. Il doit s'établir un nécessaire dialogue entre ceux qui ne font qu'observer les singes et ceux qui, pour les besoins de la connaissance ou du soulagement des souffrances humaines, expérimentent sur l'animal. Ce dialogue ouvert, sans arrière-pensées, peut seul permettre que les Primates maintenus en captivité le soient dans les meilleures conditions possibles et ne le soient ni à des fins trop restreintes dans l'espace, c'est-à-dire n'intéressant qu'un petit groupe de personnes (ou des personnes abordant un thème de recherche très « pointu »), ni dans le temps, c'est-à-dire pour la durée d'une seule expérience.
Les primates non humains constituent des modèles biologiques pertinents pour la compréhension de certains domaines de la biologie de l'homme de par leur proximité phylogénétique. Même s'ils ne représentent qu'un pourcentage extrêmement faible en nombre d'individus utilisés en recherche biomédicale, leur utilisation pose des problèmes éthiques particuliers. La Convention STE 123 du Conseil de l'Europe a été entièrement remodelée au cours des années 1990 dans le cadre des « trois R » (remplacer, réduire, raffiner), de Russel et Burch (1959). Cette convention rassemble des représentants des États membres du Conseil de l'Europe et des organisations non gouvernementales européennes (O.N.G.) intervenant comme observateurs experts, que ce soient des organisations de protection, comme Eurogroup for Animal Welfare, ou des sociétés savantes, comme l'European Federation for Primatology (E.F.P.). La révision des annexes techniques de la Convention STE 123 propose l'arrêt complet de l'utilisation des chimpanzés, le recours quasi exclusif à des animaux d'élevages agréés et a insisté sur le strict respect des caractéristiques éthologiques des espèces, notamment la vie sociale et la possibilité d'exprimer leurs capacités cognitives dans un contexte social ou non social.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Bertrand L. DEPUTTE : docteur en éthologie, docteur ès sciences, professeur à l'École nationale vétérinaire d'Alfort
Classification
Médias
Autres références
-
BABOUIN
- Écrit par Marie-Claude BOMSEL
- 414 mots
- 2 médias
Singe au corps puissant, caractérisé par un museau allongé et nu comme celui du chien, d'où leur autre nom commun de cynocéphale (signifiant « tête de chien »). Répartition géographique : Afrique centrale, Afrique du Sud et Arabie. Habitat : savanes, collines rocheuses et forêts. Classe : Mammifères...
-
CERCOPITHÈQUE
- Écrit par Marie-Claude BOMSEL
- 436 mots
Singe de taille moyenne, au corps svelte et à longue queue non préhensile, vivant dans les forêts africaines, au sud du Sahara. Classe : Mammifères ; ordre : Primates ; famille : Cercopithécidés.
Autrefois appelés « guenons », les cercopithèques, représentés par plus de vingt espèces,...
-
CHASSEURS-CUEILLEURS (archéologie)
- Écrit par Jean-Paul DEMOULE
- 4 728 mots
- 3 médias
-
CHIMPANZÉ
- Écrit par Marie-Claude BOMSEL
- 639 mots
- 1 média
- Afficher les 28 références
Voir aussi
- MIMIQUE
- FÉCONDITÉ
- MONOGAMIE ANIMALE
- DÉVELOPPEMENT ANIMAL ou ONTOGENÈSE ANIMALE
- ESPRIT THÉORIE DE L'
- GLANDES
- PLACENTAIRES ou EUTHÉRIENS
- NEUROCRÂNE
- CYCLE ŒSTRAL
- SEXUEL COMPORTEMENT
- PLANTIGRADES
- PROSIMIENS
- LEMURIDAE ou LÉMURIDÉS
- INDRIDAE ou INDRIIDAE
- DAUBENTONIIDAE
- LORISIDÉS
- TARSIERS
- SINGES
- PLATYRHINIENS ou PLATYRRHINII
- CATARHINIENS ou CATARRHINII
- ANIMAL LANGAGE
- RÉPARTITION DES FLORES & DES FAUNES
- SIMIENS ou ANTHROPOIDEA
- ŒSTRUS
- EXTINCTION ou DISPARITION DES ESPÈCES
- CHEIROGALEIDAE
- GALAGIDAE
- ATÉLINÉS
- COLOBINÉS
- GROUPEMENTS ANIMAUX
- ANIMAL RÈGNE
- ANATOMIE ANIMALE
- POIL
- ONGLE
- PONGIDÉS ou PONGIDAE
- ODORANTES GLANDES
- ACCOUPLEMENT
- ANTHROPOMORPHES
- HYLOBATIDÉS ou HYLOBATIDAE
- ENVIRONNEMENT, droit et politique
- ATTACHEMENT THÉORIE DE L'
- ANTHROPISATION
- MÈRE-ENFANT RELATION
- POPULATIONS ANIMALES & VÉGÉTALES
- GESTATION
- HERBIVORES
- DOIGTS, zoologie
- CHANT, éthologie
- COMMUNICATION ANIMALE
- BIODÉMOGRAPHIE
- STÉRÉOTYPES COMPORTEMENTAUX
- MARQUAGE DU TERRITOIRE, éthologie
- ALARME, éthologie
- ATTRACTION, éthologie
- LÉMURIFORMES
- STREPSIRHINES
- HAPLORHINES
- CERCOPITHÉCOÏDES
- CERCOPITHÉCINÉS ou CERCOPITHÉCIDÉS
- GELADAS
- HOMINOÏDES
- PITHÉCINÉS
- RHINARIUM
- ATÉLIDÉS
- LORISIFORMES
- MEGALAPIDAE
- AYE-AYE
- ATÈLES
- CALLIMICO
- CALLITHRICIDÉS
- CÉBIDÉS
- MURIQUIS
- SAQUIS
- OUAKARIS
- MANGABEY
- NASIQUE
- PROTECTION ou CONSERVATION DES ESPÈCES
- ANIMAUX SAUVAGES EXPLOITATION DES