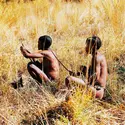- 1. Diagnose
- 2. Classification
- 3. Catégories systématiques (groupes zoologiques)
- 4. Habitat et comportement alimentaire
- 5. Biologie sexuelle et reproduction
- 6. Structures sociales
- 7. Dynamique des groupes sociaux
- 8. Ontogenèse
- 9. Socialisation des jeunes
- 10. Modes de communication
- 11. Processus cognitifs
- 12. La culture chez les primates non humains
- 13. Protection et conservation des Primates
- 14. Bibliographie
PRIMATES
Article modifié le
Ontogenèse
Dans quarante genres sur les cinquante que contient l'ordre des Primates, les femelles ne mettent au monde qu'un jeune à la fois. Toutefois, les naissances gémellaires voire celles de triplés sont la règle chez des Prosimiens (Tarsius spectrum, les Cheirogaleidés, les Galagidés, à l'exception de Phaner et Euoticus, les Mégaladapidés et un Lémuridé, Varecia) et chez les Callithricidés sud-américains (à l'exception de Callimico).
La durée de la gestation, chez les Mammifères placentaires, est considérée comme représentant un compromis entre le volume du cerveau du nouveau-né (donc de sa tête) et la taille du bassin (canal pelvien) de la mère ou encore entre le poids du cerveau du nouveau-né et le poids de la mère (Passingham, 1985). Le rapport poids du nouveau-né/poids de la mère est d'environ 5 p. 100 chez les Prosimiens et les Anthropoïdes (2,4 à 9 p. 100), 6 p. 100 chez les Colobinés, 8 p. 100 chez les Cercopithécinés et chez l'Homme et 9 p. 100 chez les Platyrhiniens (7 à 11,5 p. 100). Plusieurs exceptions sont notables : elles concernent les tarsiers chez lesquels le poids du jeune atteint environ 16 p. 100 du poids de la mère et surtout le saimiri (Platyrhinien-Cébidé) et le talapoin (Catarhinien-Cercopithéciné) chez lesquels ce rapport atteint 20 p. 100.
En ce qui concerne la précocité du jeune à la naissance, les Primates ont des petits (relativement) précoces dans la mesure où, à leur naissance, ils sont couverts de poils, capables de certaines potentialités de perception et de motricité, comme s'accrocher à la fourrure de la mère et redresser la tête en direction de la mamelle. La précocité dépend essentiellement de la croissance cérébrale fœtale. Le poids du cerveau des Prosimiens à leur naissance représente entre 21,1 et 48 p. 100 du poids du cerveau adulte. Ce rapport varie de 36,6 à 58 p. 100 chez les Platyrhiniens, de 43 à 60 p. 100 chez les Catarhiniens et de 31,2 à 50,7 p. 100 chez les Anthropoïdes, l'Homme possédant le plus faible rapport parmi les Primates supérieurs avec 30,7 p. 100.
Mais la précocité à la naissance est aussi associée à une lenteur du développement postnatal : les Prosimiens, les moins précoces à la naissance, présentent le développement le plus rapide de l'ensemble des capacités sensorimotrices, l'Homme ayant le plus lent.
Prise en charge des jeunes
À la naissance, les jeunes Cercopithécidés (macaque) présentent des réflexes bien développés (réflexe de Babinski, de Moro, de succion, de saut, de marche quadrupède, etc., Taylor et al., 1980). Néanmoins, au cours des premières semaines, ils sont incapables de se mouvoir seuls et doivent être transportés par la mère (ou un autre congénère).
Chez les Galagidés, ce transport ne s'effectue que lors de perturbations ; le reste du temps, les jeunes restent dans le nid ou sont « parqués », par la mère, à proximité des zones où elle « fourrage » (aussi chez Perodicticus et Arctocebus). Pour transporter le jeune, celle-ci saisit dans sa bouche un pli abdominal du jeune. Ce mode de transport se rencontre aussi chez un tarsier, chez Varecia et chez Lepilemur, autres espèces utilisant des nids pour leurs jeunes.
Mais chez les Lorisidés et chez tous les autres Primates, dès sa naissance, le jeune est capable de s'accrocher à sa mère, le plus généralement sur le ventre. À leur naissance, les jeunes saimiris sont capables de se tenir quelque temps suspendus par la queue, capacité qui disparaît chez l'adulte. À l'opposé, chez les hurleurs (Alouatta), la queue ne devient préhensile que vers un mois. Chez la plupart des espèces possédant une queue et chez lesquelles le jeune est, dès sa naissance, au contact permanent de sa mère, sa queue s'enroule autour du corps de cette dernière.
Modification de l'aspect du jeune
Le jeune naît couvert d'une fourrure plus ou moins éparse mais, de plus, chez de nombreuses espèces, la peau nue n'est pas mélanisée (pigmentée en sombre) et la couleur du pelage du jeune contraste avec celui de l'adulte (Alley, 1980 ; Moore, 1984). Il est soit plus clair, blanc crème, jaune ou orangé chez des espèces où les adultes ont le pelage noir ou plus ou moins sombre (la plupart des espèces du genre Presbytis et Colobus, une espèce du genre Macaca – Macaca arctoides, et Cercopithecus neglectus), soit plus foncé (deux espèces du genre Presbytis, plusieurs espèces du genre Papio et du genre Macaca). La modification du pelage s'opère au cours des premiers mois, voire tout au long de la première année. Dans le genre Presbytis, les jeunes nés avec un pelage clair mettent entre trois et dix mois, selon les espèces, pour présenter le pelage adulte, les colobes de deux à sept mois. Chez les babouins Papio anubis et P. cynocephalus, le passage du pelage noir du nouveau-né au pelage gris doré de l'adulte est terminé vers le sixième et le neuvième mois respectivement (Ransom & Rowell, 1972 ; Altmann et al., 1982). Ce type de transition est plus rapide chez les macaques (trois mois chez le magot, Burton, 1972). La mélanisation de la peau du jeune s'effectue plus ou moins rapidement selon les régions du corps et selon les espèces : chez le mangabey à joues blanches, dont les adultes ont la peau totalement noire, la face du jeune, d'abord rose, devient grise vers cinq mois, mais n'est complètement noire qu'au-delà de un an. Chez les gibbons concolor, le pelage du jeune passe de la couleur crème à la couleur noire au cours de la première année, puis les femelles connaissent à nouveau un changement graduel de la couleur de leur fourrure vers leur maturité sexuelle (Deputte & Leclerc-Cassan, 1982). L'iris de l'œil change aussi de couleur au cours du développement, passant du sombre au clair et à la teinte marron définitive vers trois mois chez Macaca sylvanus et M. fascicularis et Lophocebus albigena (Burton, 1972 ; Thommen, 1982 ; Deputte, 1986).
Dentition
L'éruption des dents peut commencer dès avant la naissance (Hill, 1966), mais ne s'achève qu'au cours des premiers mois, vers trois mois chez les cercopithèques (Cercopithecus aethiops), vers quatre mois et demi chez les macaques, entre trois mois et demi et six mois chez le saimiri (Cébidé), entre six mois et un an chez le babouin et vers un an chez l'orang-outan. L'éruption de la dentition lactéale est en particulier trois fois plus précoce chez le babouin que chez l'homme. La séquence d'éruption des dents décidues et/ou définitives est une constante du genre et/ou de l'espèce (Swindler, 1976). La dentition permanente se met progressivement en place chez les Simiens en commençant par la première molaire qui apparaît dès cinq mois chez Saimiri (Cébidé), mais au-delà de un an chez de nombreux autres genres et au-delà de trois ans et demi chez l'orang-outan. La dentition permanente n'est complète qu'après l'éruption des canines chez les Platyrhiniens (Saimiri, deux ans, Cebus et Lagothrix quatre ans et demi) et après l'éruption de la troisième molaire chez les Catarhiniens (Papio, six ans, Macaca, six ans et demi, Pongo, neuf-dix ans), comme chez l'homme. Toutefois, contrairement à l'homme, chez les Catarhiniens, les canines définitives apparaissent tardivement juste avant les troisièmes molaires.
Psychomotricité
Le développement des capacités motrices est très variable selon le niveau phylogénétique et est partiellement une fonction inverse de la précocité à la naissance (cf. supra). L'ensemble du développement sensori-moteur est réalisé vers six mois chez le macaque, ce qui représente un développement quatre fois plus rapide que chez l'enfant humain (Parker, 1977). Ce coefficient est aussi mis en évidence en ce qui concerne le développement des capacités perceptives visuelles (Boothe et al., 1980) : les capacités d'acuité visuelle, de sensibilité aux contrastes sont en place vers le quatrième mois chez les Catarhiniens (Macaca).
Vitesse du développement postnatal
La période d'immaturité, sur le plan des développements somatique, psychologique et physiologique présente une durée croissante, en valeur absolue et relative, des Prosimiens jusqu'aux Anthropoïdes. Deux critères permettent d'évaluer la vitesse du développement postnatal : ce sont la croissance pondérale et l'âge de la maturité sexuelle qui en est plus ou moins dépendante.
En ce qui concerne la croissance pondérale, le galago double son poids de naissance en une semaine, les lémurs en moins de un mois, le singe rouge – patas –, Cercopithéciné de savane, en un mois et demi, les lophocèbes en deux mois et les macaques et les babouins en trois mois. Parmi les Anthropoïdes, si le jeune gorille atteint ce seuil en deux mois, le jeune orang ne l'atteint qu'à six mois. Quel que soit le gain de poids nécessaire pour atteindre le poids adulte, les Prosimiens l'atteignent dans un délai de deux à trente fois plus court que chez les Simiens.
Chez tous les Catarhiniens et chez les Anthropoïdes, l'adolescence est marquée, comme chez l'homme, par la présence d'une « crise de croissance » ; mais sa relation avec la puberté est controversée (Watts & Gavan, 1982). Chez les mâles de Cercopithécinés, l'accélération de la croissance pondérale est concomitante de celle des canines, au cours de la troisième ou de la quatrième année (Gautier-Hion & Gautier, 1976 ; Glassman et al., 1984 ; Spiegel, 1984 ; Brizzee & Dunlap, 1986 ; Deputte, 1986), précédant la maturité sexuelle proprement dite. Les femelles de babouins, de chimpanzés et de certaines espèces de macaques (Macaca mulatta) connaissent, elles aussi, une accélération de la croissance qui, dans les deux premiers cas, est corrélée à l'apparition des premiers cycles œstriens (ménarche), mais qui lui est postérieure dans le dernier cas (Watts & Gavan, 1982 ; Glassman et al., 1984 ; Brizzee & Dunlap, 1986). Chez d'autres espèces de macaques et chez les mangabeys, la croissance pondérale des femelles se ralentit constamment depuis la première enfance (Spiegel, 1984 ; Deputte, 1986), mais, comme chez les autres espèces et plus encore que chez les mâles, elle se prolonge au-delà de la maturité sexuelle.
La maturité sexuelle des Catarhiniens est clairement marquée, chez les femelles, contrairement à celle des mâles, par un seul événement : la première intumescence de la « peau sexuelle » ou les premières menstruations. Chez les Callithricidés et certains Cébidés, où il n'y a pas de flux menstruels, les manifestations des premiers œstrus ne sont que de nature comportementale. Chez les mangabeys, la première intumescence apparaît à des âges variables (trois ou quatre ans), mais pour des poids peu variables (4,9 + 0,2 kg). La ménarche chez les Cercopithecoidea et les Hominoidea est généralement suivie par une période de « stérilité d'adolescence » qui peut être liée au fait que la croissance pondérale n'a pas atteint un seuil suffisant. La différence des modes de croissance, chez les Simiens, entre mâles et femelles conduit à un dimorphisme sexuel pondéral plus ou moins marqué (Shea, 1986). Parmi les Cercopithécinés, le singe de Brazza (Cercopithecus neglectus), le cercocèbe agile (Cercocebus galeritus) et le singe rouge (Erythrocebus patas) présentent le dimorphisme le plus élevé, le poids de la femelle ne représentant qu'environ 55 p. 100 du poids du mâle. À l'opposé, le talapoin (Miopithecus talapoin), le magabey à joues blanches (Lophocebus albigena) et le moustac (Cercopithecus cephus) présentent de faibles dimorphismes pondéraux (poids des femelles/poids des mâles entre 71 et 81 p. 100 ; Gautier-Hion, 1975). Entre les espèces, ces différences proviennent soit d'une différence de taux de croissance lorsque les adultes sont matures à des âges analogues, soit de la précocité de la maturité sexuelle chez les femelles (cas du patas où les femelles sont matures dès deux ans et demi). Les mâles de Cercopithécinés atteignent généralement leur maturité sexuelle deux, trois ou cinq ans plus tardivement que les femelles. Le dimorphisme plus grand des gorilles par rapport aux chimpanzés provient à la fois d'un taux de croissance plus élevé chez les gorilles, mais aussi d'une augmentation du « bimaturisme sexuel », c'est-à-dire de la maturation plus précoce d'un sexe par rapport à l'autre : les femelles gorilles sont plus précoces que les femelles chimpanzés, mais la maturité des mâles gorilles est atteinte seulement deux ans après celle des mâles chimpanzés (Shea, 1986).
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Bertrand L. DEPUTTE : docteur en éthologie, docteur ès sciences, professeur à l'École nationale vétérinaire d'Alfort
Classification
Médias
Autres références
-
BABOUIN
- Écrit par Marie-Claude BOMSEL
- 414 mots
- 2 médias
Singe au corps puissant, caractérisé par un museau allongé et nu comme celui du chien, d'où leur autre nom commun de cynocéphale (signifiant « tête de chien »). Répartition géographique : Afrique centrale, Afrique du Sud et Arabie. Habitat : savanes, collines rocheuses et forêts. Classe : Mammifères...
-
CERCOPITHÈQUE
- Écrit par Marie-Claude BOMSEL
- 436 mots
Singe de taille moyenne, au corps svelte et à longue queue non préhensile, vivant dans les forêts africaines, au sud du Sahara. Classe : Mammifères ; ordre : Primates ; famille : Cercopithécidés.
Autrefois appelés « guenons », les cercopithèques, représentés par plus de vingt espèces,...
-
CHASSEURS-CUEILLEURS (archéologie)
- Écrit par Jean-Paul DEMOULE
- 4 728 mots
- 3 médias
-
CHIMPANZÉ
- Écrit par Marie-Claude BOMSEL
- 639 mots
- 1 média
- Afficher les 28 références
Voir aussi
- MIMIQUE
- FÉCONDITÉ
- MONOGAMIE ANIMALE
- DÉVELOPPEMENT ANIMAL ou ONTOGENÈSE ANIMALE
- ESPRIT THÉORIE DE L'
- GLANDES
- PLACENTAIRES ou EUTHÉRIENS
- NEUROCRÂNE
- CYCLE ŒSTRAL
- SEXUEL COMPORTEMENT
- PLANTIGRADES
- PROSIMIENS
- LEMURIDAE ou LÉMURIDÉS
- INDRIDAE ou INDRIIDAE
- DAUBENTONIIDAE
- LORISIDÉS
- TARSIERS
- SINGES
- PLATYRHINIENS ou PLATYRRHINII
- CATARHINIENS ou CATARRHINII
- ANIMAL LANGAGE
- RÉPARTITION DES FLORES & DES FAUNES
- SIMIENS ou ANTHROPOIDEA
- ŒSTRUS
- EXTINCTION ou DISPARITION DES ESPÈCES
- CHEIROGALEIDAE
- GALAGIDAE
- ATÉLINÉS
- COLOBINÉS
- GROUPEMENTS ANIMAUX
- ANIMAL RÈGNE
- ANATOMIE ANIMALE
- POIL
- ONGLE
- PONGIDÉS ou PONGIDAE
- ODORANTES GLANDES
- ACCOUPLEMENT
- ANTHROPOMORPHES
- HYLOBATIDÉS ou HYLOBATIDAE
- ENVIRONNEMENT, droit et politique
- ATTACHEMENT THÉORIE DE L'
- ANTHROPISATION
- MÈRE-ENFANT RELATION
- POPULATIONS ANIMALES & VÉGÉTALES
- GESTATION
- HERBIVORES
- DOIGTS, zoologie
- CHANT, éthologie
- COMMUNICATION ANIMALE
- BIODÉMOGRAPHIE
- STÉRÉOTYPES COMPORTEMENTAUX
- MARQUAGE DU TERRITOIRE, éthologie
- ALARME, éthologie
- ATTRACTION, éthologie
- LÉMURIFORMES
- STREPSIRHINES
- HAPLORHINES
- CERCOPITHÉCOÏDES
- CERCOPITHÉCINÉS ou CERCOPITHÉCIDÉS
- GELADAS
- HOMINOÏDES
- PITHÉCINÉS
- RHINARIUM
- ATÉLIDÉS
- LORISIFORMES
- MEGALAPIDAE
- AYE-AYE
- ATÈLES
- CALLIMICO
- CALLITHRICIDÉS
- CÉBIDÉS
- MURIQUIS
- SAQUIS
- OUAKARIS
- MANGABEY
- NASIQUE
- PROTECTION ou CONSERVATION DES ESPÈCES
- ANIMAUX SAUVAGES EXPLOITATION DES