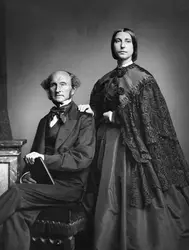PROGRÈS
Article modifié le
Notion complexe indéfiniment différenciable, le progrès a été le plus souvent traité comme s'il était global et simple, univoque et linéaire. Ainsi réduite à un schéma grossier, l'idée de progrès s'est trouvée dérivée en une idéologie qui a connu son apogée en Europe, au xixe siècle. Mythe aujourd'hui dénoncé après avoir été cette idéologie triomphante, le progrès n'a en fait jamais cessé d'être rapporté à une séquence temporelle à laquelle différentes philosophies de l'histoire se sont, en Occident, appliquées à donner sens, jusqu'à ce que le principe de la relativité, étendu aux réalités culturelles, ait vraiment mis en évidence la grande variété des processus d'évolution.
La formation de l'idée de progrès
La nature et le temps
Sans doute fallait-il qu'un sens positif soit donné au temps pour que s'affirme la croyance au progrès, véritable eschatologie graduelle, comme l'écrit Louis Dumont. Ce dernier a fortement marqué combien l'Inde est demeurée étrangère à l'idée d'un âge d'or situé dans l'avenir et peu à peu réalisé par l'effort de l'homme, conjugué aux effets du temps valorisé comme complice de sa volonté. Il a également souligné que, dans le système de références propre à la civilisation occidentale qui légitime le temps comme dimension de l'humanité, l'idée de changement est chargée de significations tandis que celle de permanence en est totalement dépouillée. Dans ces conditions, l'histoire n'est pas seulement une chronologie, absolue ou relative, elle est aussi une chaîne causale, un ensemble de changements significatifs, un développement dont l'origine se situe dans la Grèce classique où s'est effectuée une réforme de la conscience.
On sait, en effet, que le progrès ne pouvait qu'occuper une place très secondaire dans les premières spéculations cosmogoniques : les mythes ont d'abord rendu compte de la régularité des phénomènes naturels et sociaux, non de leurs transformations, qui ont très tôt inspiré un sentiment de désenchantement, comme en témoigne la socio-génie régressive d'Hésiode. S'il est vrai que la pensée mythique, pensée synthétique, assimile la durée à une dégradation ontologique, échoue à restreindre les qualités perceptives dans les limites de leur domaine propre et condamne la nature, immense sémiologie, à vivre éternellement le drame humain, le « miracle grec » ne peut être qu'issu d'un mouvement d'extraversion qui a délivré l'homme de la transcendance illusoire de la pensée magique, étendu l'ordre de la conscience à l'espace de la cité et abouti à la déshumanisation de la nature. Il résulte donc d'une rupture avec l'anthropocentrisme spontané, le surdéterminisme, la pensée introvertie.
Cependant, l'homme grec n'a pas osé revendiquer devant la nature omniprésente une destinée autonome. Le monde physique comme le monde social ont certes été atomisés par Épicure qui, radicalisant l'extraversion socratique, a éparpillé le donné pour s'affranchir de tout lien : son nominalisme ruine l'idée d'une légalité de la nature et d'un cosmos organisé, son matérialisme est au principe d'une conception générale de l'Univers, où l'homme et son cycle cosmique font figure de cas particuliers. L'unité, l'éternité, l'immutabilité de l'Univers ont été ainsi affirmées par les penseurs grecs qui ont considéré que les changements qu'il présente ne troublent en rien la permanence réelle de sa substance.
Repris par Platon, le mythe orphique de la « grande année » a triomphé avec le stoïcisme. Il serait néanmoins inexact d'opposer le devenir cyclique des Anciens au temps historique des Modernes, car l'idée d'éternel retour, au sens où Nietzsche l'a entendue, n'a guère été soutenue dans le monde antique. La croyance en un développement historique, effectivement absente des conceptions platonicienne et aristotélicienne d'une hiérarchie des idées, d'une gradation des formes, d'une sorte de progrès logique qui s'achève dans l'idée du Bien, de l'Acte immobile ou de l'Un ineffable, est même manifeste chez Lucrèce, auquel on a attribué la première théorie du progrès.
Infléchissant la doctrine d'Épicure, Lucrèce a réintroduit dans sa représentation du monde les idées de loi, d'ordre, d'ensemble, d'espèce, d'essence, de plan, et suggéré que l'historicité de l'homme est liée à celle de la nature. Mais est-il, pour avoir énoncé les découvertes successives des premiers hommes, le précurseur de Condorcet qu'ont voulu voir en lui tous les historiens de l'idée de progrès, de Jules Delvaille à Carl Van Doren ? Et rompt-il vraiment, comme l'assure Robert Lenoble, avec le mythe classique de l'âge d'or ? Pierre Boyancé, après Léon Robin, a remarqué que la constatation de la variation et de la multiplication des effets ne s'identifie pas à la reconnaissance d'une amélioration véritable. Chez Lucrèce, les inventions trouvent leur origine dans un affaiblissement des aptitudes naturelles. Le progrès n'a donc qu'une fonction de compensation. Il multiplie en outre les faux biens. Or, la vie la plus simple étant celle où l'on a le moins de besoins, le vrai progrès consiste en une régression vers la stabilité. Le clinamen des épicuriens conduit ainsi à l'ataraxie qui est un bonheur exténué et figé, le seul que l'on peut atteindre en cet univers où la contingence est mise au service de la nécessité.
Il est remarquable que les thèmes dont traite le livre V du De natura rerum – la vie des premiers hommes, les débuts de la vie en commun, les origines du langage, de la propriété, de la richesse – sont ceux-là mêmes que Jean-Jacques Rousseau, théoricien de la décadence, a développés dans le Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. C'est donc Rousseau – qui a écrit : « La société est naturelle à l'espèce humaine comme la décrépitude à l'individu. Il faut des arts, des lois, des gouvernements aux peuples, comme il faut des béquilles aux vieillards » (Lettre à M. Philopolis) – et non Turgot qu'annonce Lucrèce. Mais entre ce dernier et les penseurs du xviiie siècle s'est opérée une mutation de la conscience historique, mutation à laquelle le christianisme a contribué d'une manière décisive.
Sens et histoire
Raymond Aron a souligné, à plusieurs reprises, qu'il n'était plus possible, au xxe siècle, de penser à la manière des Grecs et de ne voir dans les événements que les reflets déformés des idées ou du cosmos. Thucydide, en effet, interprétait la guerre du Péloponnèse en se référant aux passions éternelles qui définissent la nature humaine. Il n'assignait pas de sens à l'histoire. « C'est notre expérience elle-même, précise Raymond Aron, qui nous impose pour ainsi dire d'attribuer importance et signification aux alternances de guerres et de révolutions, de grandeur et d'abaissement. » Serait-elle, cependant, aussi contraignante « même si », comme il le pense, « nous n'appartenions pas à une civilisation que le christianisme a formée » ? La conception d'un sens de l'histoire – trajectoire unique, marche ascendante de l'humanité, réalisation d'un dessein voulu par Dieu – est spécifiquement chrétienne. Le rejet de la physique hellénique du « grand retour » et l'ouverture du monde vers un développement linéaire ont été l'œuvre des théologiens qui ne pouvaient pas soumettre l'histoire sainte à des recommencements périodiques.
Il revient à Henri Irénée Marrou d'avoir dégagé, en même temps que les conséquences de cette dissociation, le rôle que saint Augustin a joué dans la constitution d'une philosophie de l'histoire centrée sur l'idée de progrès. La comparaison de toute la suite des générations à un seul homme qui « de l'enfance à la vieillesse poursuit sa carrière dans le temps en passant par tous les âges » a été formulée pour la première fois par le docteur de l'Église. Sous la conduite de la providence divine, l'humanité passe de la jeunesse, caractérisée par l'absence de loi, à l'âge viril, qui est l'époque de la loi, pour accéder enfin à celle de la grâce – la croissance spirituelle du genre humain correspondant à la lente maturation du corps mystique du Christ.
Mais le temps historique n'est pas un facteur de progrès au regard de l'Être qui ne peut être qu'affranchi du temps. Il est corruption, effritement, dégradation. Le péché est sa face négative. Si l'histoire acquiert une valeur positive, ce caractère relève de l'ordre de la grâce et non de celui de la nature. Le progrès temporel est donc ordonné, comme le moyen à sa fin, à la cité de Dieu. Il existe un rapport entre les civilisations et la société des saints : « L'architecte utilise des échafaudages provisoires pour construire une demeure destinée à durer » (Serm., CCCLXII, 7). Il n'en reste pas moins que la méconnaissance de l'« ambivalence du temps de l'histoire chez saint Augustin » est, pour Marrou, à l'origine d'un contresens qui a conduit les Modernes à assimiler le progrès spirituel au progrès des connaissances.
Un processus de profanation, de dépossession, de sécularisation a transformé l'idée d'une croissance spirituelle de l'humanité en celle d'un développement de ses techniques ; et à chaque étape de ce mouvement, qui l'a déplacée du plan de la théologie à celui de l'économie, l'idée de progrès a perdu quelque chose de son contenu originel, de sa cohérence première, de son intelligibilité. La philosophie moderne de l'histoire à laquelle il aboutit réfère à des schèmes de pensée que le Moyen Âge tenait de saint Augustin et qui la fait en partie apparaître comme une transposition des concepts fondamentaux hérités de la théologie chrétienne. À bien des égards, cependant, c'est contre la représentation chrétienne, nettement pessimiste, de l'histoire que s'est édifiée, surtout en France, cette philosophie optimiste.
Trop soumis à leurs préjugés antireligieux, les philosophes du siècle des Lumières n'ont pu admettre la contribution du christianisme à la formation de l'idée de progrès : elle leur semblait contredite par celle de la chute qui a dominé tout le Moyen Âge au cours duquel la topique humaine s'est trouvée constamment déplacée de l'ici-bas à l'au-delà. L'ambiguïté du Discours sur l'histoire universelle, qui consacre la projection de l'absolu dans le relatif, du transcendant dans l'empirique, a fait disparaître l'ambivalence du temps inscrite dans La Cité de Dieu ; et c'est contre Bossuet qu'ils se sont dressés.
Souvent reprise, l'image augustinienne d'un homme unique qui, répandu sur l'ensemble de la Terre, irait progressant à travers le déroulement des siècles, ne doit donc pas être considérée du seul point de vue qui donne sens à la succession des événements de l'histoire visible. Il en est de même, comme l'a remarqué Édouard Jeauneau, pour ces nains juchés sur les épaules des géants – Nanus positus super humeros gigantis – dans lesquels, au xiie siècle, le chanoine B. de Troyes a vu les Apôtres portés par les Prophètes. Originellement, la comparaison (attribuée à Bernard de Chartres), que rapporte Jean de Salisbury dans son Metalogicon, écrit vers 1159, n'avait nullement pour but d'illustrer une philosophie de l'histoire ou une théorie de la culture : elle était une manière imagée de faire comprendre à l'élève que le métier d'écrivain s'apprend par la fréquentation des modèles antiques. S'il y a progrès, il ne peut s'exprimer que dans le cadre de la foi, dans la perspective de l'accroissement de la cité de Dieu, qu'à partir de la révélation. Sa conséquence inéluctable est l'approche de la fin des temps, car le progrès d'un monde fini ne peut être indéfini, et, dans le Prologue du livre V de sa Chronique, Othon de Freising annonce cette proximité : c'est parce qu'elle est près de mourir que la culture jette un si brillant éclat. Née à l'Orient, la Sagesse meurt à l'Occident. Nous assistons, écrit-il, « au dernier râle du monde ».
Ainsi, conclut ironiquement Jeauneau après avoir démontré qu'il n'y a pas au xiie siècle de querelle des Anciens et des Modernes, si l'idée de progrès évoque souvent la fin du monde chez un homme du Moyen Âge, « il n'en va pas nécessairement de même pour un homme du xxe siècle ».
Des Anciens aux Modernes
L'idée d'un progrès cumulatif, celle d'une loi de perfectionnement ainsi que la théorie des âges du monde ont été appliquées, à partir de la Renaissance, non plus à la croissance de l'Église mais à l'avancement des sciences. Ce changement de plan est à rapporter au glissement, qui ne pouvait pas ne pas se produire, dans une chrétienté déféodalisée, du sens chrétien au sens profane de l'histoire. Pour Hugues de Saint-Victor, sensible aux novations d'un monde émancipé de l'économie terrienne où une intense circulation des biens et des personnes engendrait un nouveau type de relations humaines, la loi de perfectionnement était déjà une loi universelle. Tout se développe lentement ; l'esprit humain progresse, et ira en se perfectionnant jusqu'à participer plus tard de l'immutabilité divine. La confiance dans la raison s'insinuait dans la contemplation de la nature.
Bien que la référence au transcendant interdise de donner une valeur absolue à la suite des événements, la conception chrétienne de l'histoire a, d'autre part, toujours été exposée à une interprétation immanentiste. La philosophie de l'histoire développée par Joachim de Flore l'atteste bien : après l'âge de la crainte (l'Ancien Testament) et celui de la foi (Nouveau Testament), l'Évangile éternel devra être le règne de l'amour.
Un autre moine, Roger Bacon, aurait voulu, lui aussi, parvenir à un gouvernement spirituel du monde. Mais l'idéal politique et social de ce franciscain importe moins que son idéal scientifique. C'est l'expérience, nous dit-il dans l'Opus Majus, qui nous fait découvrir les secrets de la nature ; c'est grâce à la science expérimentale que l'esprit se repose dans l'éclat de la vérité. « Négliger la science, c'est négliger la vertu. » Roger Bacon a été, en outre, le premier à avoir repris l'opinion exprimée par Sénèque (lettre 64) : « C'est pour moi qu'on amasse, c'est pour moi qu'on travaille [...], mais il restera beaucoup à faire » pour affirmer que tous les âges contribuent à constituer la science.
Les réserves exprimées par Bacon à l'endroit d'une vénération excessive des Anciens se sont accentuées après la Renaissance qui a réhabilité, en les légitimant, les fins temporelles de l'activité. De multiples découvertes ont alors rendu manifeste la manière dont s'accumulent et s'accroissent les connaissances. Bodin, Le Roy, Bacon, avant que Descartes, Pascal et Malebranche déclarent qu'il n'y a pas lieu de s'incliner devant les Anciens à cause de leur antiquité, ont posé « qu'il convient par propres inventions augmenter la doctrine des Anciens, sans s'arrêter seulement aux versions, expositions, corrections et abrégez de leurs écrits ». Le présent était joué contre le passé bientôt ressenti comme un fardeau, et le parti des grands morts abandonné, dans la seconde moitié du xviie siècle, par Perrault, Quinault, Saint-Evremond, Fontenelle...
Ce revirement s'explique par une mise en question de la vérité historique, de l'histoire profane comme de l'histoire sainte. En raison même des efforts de Bossuet pour établir des concordances fixes, l'idée s'accréditait que dans le passé rien n'est sûr. La chronologie, « doctrine des temps et des époques », infirmait la Tradition, la Providence, l'Autorité ; et Fontenelle, démythifiant l'Antiquité, dénonçait les fables des Grecs, ces « amas de chimères, de rêveries, d'absurdités ». Sa Digression sur les Anciens et les Modernes (1688) reprend l'image de l'humanité qui a eu son enfance et sa jeunesse. « Il est fâcheux, écrit-il, de ne pouvoir pas pousser jusqu'au bout une comparaison qui est en si beau train ; mais je suis obligé d'avouer que cet homme-là n'aura point de vieillesse. » L'idée d'un progrès illimité était ainsi affirmée en même temps que celle d'un enchaînement des connaissances et de leur succession nécessaire : « Il y a un ordre qui règle nos progrès ». Et c'est un hymne à la science que Fontenelle entonne dans la Préface à l'Histoire du renouvellement de l'Académie royale des sciences (1702).
Lorsque s'ouvre le siècle des Lumières, l'idée de progrès demeure néanmoins chargée d'ambiguïtés. Le progrès est-il également d'ordre matériel et moral ? Est-il unilinéaire et continu ou présente-t-il des directions multiples et des discontinuités ? Est-il indéfini ou limité ? En France, il a signifié réformes. Une paix perpétuelle et un système de gouvernement rénové sont pour l'abbé de Saint-Pierre, « solliciteur pour le bien public », les conditions premières d'un état futur de bonheur. Comme Fontenelle, l'abbé a cru à la marche ascensionnelle de l'humanité. Mais Vico, dans La Scienza nuova (1725-1730), a montré que la variété infinie des faits humains présente toujours les mêmes traits, les mêmes caractères, et que les nations suivent une marche analogue déterminée par la Providence.
Enseveli « dans la profonde et vaste bibliothèque du sens universel de l'humanité », il a reconnu que les nations passent de l'âge divin à l'âge héroïque et enfin à l'âge humain. Après avoir décrit le cours que suit l'histoire des nations (Lib. IV, « Del corso che fanno le nazioni »), il a constaté (Lib. V, « Del ricorso delle cose umane nel risurgere che fanno le nazioni ») le retour des mêmes révolutions lorsque les sociétés détruites se relèvent de leurs ruines, et perçu dans ces recommencements la loi même de l'histoire. Une « merveilleuse correspondance » s'établit entre les divers états des sociétés et s'il y a eu une barbarie antique il y a aussi une barbarie moderne. Il faudra certes trois quarts de siècle pour que ce livre, ainsi que l'écrit Paul Hazard dans La Crise de la conscience européenne, « projette enfin son éclat sur l'horizon de l'Europe ». Mais La Scienza nuova a clairement fait apparaître la dimension plurale et le caractère complexe de la notion de progrès.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Bernard VALADE
: professeur à l'université de Paris-V-Sorbonne, secrétaire général de
L'Année sociologique
Classification
Médias
Autres références
-
ANCIENS ET MODERNES
- Écrit par Milovan STANIC et François TRÉMOLIÈRES
- 5 025 mots
- 4 médias
...Pourtant, l'assimilation du modèle antique comme forme et comme règle, qui est l'un des fondements de la pensée renaissante, n'excluait pas une certaine idée du progrès, voire celle d'un dépassement possible des modèles, au point que même ceux qui ne doutaient pas de la prééminence des artistes antiques... -
BACON chancelier FRANCIS (1560 ou 1561-1626)
- Écrit par Michèle LE DŒUFF
- 2 171 mots
- 1 média
Né à Londres dans une famille qui a déjà fourni à la Couronne anglaise quelques grands serviteurs mais qui n'appartient pas à la noblesse terrienne, Bacon fut élève de Trinity College (Cambridge) et étudia le droit à Gray's Inn (Londres). Il séjourna en France de 1576 à 1578 (ou 1579) auprès de l'ambassadeur...
-
CIVILISATION
- Écrit par Jean CAZENEUVE
- 7 139 mots
- 1 média
-
COLONISATION, notion de
- Écrit par Myriam COTTIAS
- 1 619 mots
On ne saurait cependant associer le siècle des Lumières à l'établissement d'un anticolonialisme radical. Bien au contraire,au nom de la raison universelle, qui permet d'accéder en même temps à la vérité et au bonheur, les philosophes construisent un paradigme européocentrique du progrès... - Afficher les 50 références
Voir aussi