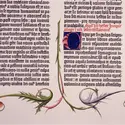PROPHÉTISME
Article modifié le
Le prophétisme manifeste à travers les siècles la croyance en une révélation et la permanence du type de connaissance obtenue par cette voie, soit sous la forme de l'annonce d'une révélation nouvelle qui donne naissance à une autre religion, à l'exemple de l'islam ou plus récemment du mormonisme ; soit sous celle d'une réinterprétation d'une révélation ancienne ou existante, avec pour conséquence la plus fréquente l'apparition de sectes au sein, mais en marge des religions constituées ; soit encore sous la forme de la rénovation d'une attitude ou d'une spiritualité tombée en désuétude, mais dans l'esprit de la religion existante, tel le prophétisme biblique par exemple. Le prophétisme atteste ainsi qu'une révélation reste la source vivante d'un comportement religieux, qu'elle ne saurait être définie une fois pour toutes dans le message originel, qu'elle participe du temps de l'histoire et qu'elle continue d'animer l'expérience humaine en général ainsi que l'expérience religieuse en particulier. Le prophétisme se rencontre toutefois le plus fréquemment dans les religions sotériologiques (qui attendent un sauveur ou le retour de ce sauveur), dans les religions salvatrices (qui enseignent les moyens du salut, même en l'absence d'un sauveur personnifié) et dans les religions eschatologiques (qui prédisent la fin de l'homme et du monde). Aussi constitue-t-il un élément essentiel de presque toutes les grandes religions de l'histoire. Comme tel, il affirme l'irréductibilité de l'aspiration religieuse et de la connaissance intuitive du surnaturel à la connaissance positive et scientifique. Sans doute est-il d'inspiration fondamentalement religieuse, mais, en raison du charisme que le prophète exerce sur ses disciples, il déborde souvent la sphère purement religieuse et se charge de significations politiques ou économiques, qui peuvent, le cas échéant, supplanter l'orientation primitive. Il arrive aussi que des philosophies, principalement les philosophies de l'histoire qui prétendent déterminer la fin présumée de l'humanité, prennent les apparences du prophétisme.
L'essence du prophétisme
Suivant l'acceptation qui semble prévaloir de nos jours, le prophète ne ferait que prédire ou annoncer l'avenir. En fait, ce sens n'est pas premier et il n'a pas toujours été historiquement le plus important. On entendait également par prophète l'interprète, inspiré ou non, des dieux, celui qui transmettait et expliquait leur volonté. Aussi, pour comprendre le prophétisme, faut-il tenir compte de cette double signification que l'on rencontre dans la littérature grecque aussi bien qu'ailleurs. D'une façon générale, on peut dire que le prophète est le porte-parole de la divinité, un intermédiaire ou médiateur entre Dieu et les hommes, dont le rôle est de révéler et de communiquer la parole divine ; celle-ci peut consister aussi bien en un ordre qu'en un message doctrinal, une menace, une promesse ou une prédiction. Par essence, le prophétisme repose donc sur une élection, à savoir le choix par lequel la divinité investit un homme de la capacité de révéler le dessin surnaturel.
Spécificité du prophétisme
Dans son sens plein, et en deçà des déformations et corruptions que la notion a pu subir au cours de l'histoire, le prophétisme se reconnaît à quatre caractéristiques principales.
En premier lieu, il est à remarquer qu'on devient prophète non point par décision personnelle mais par obéissance à une volonté contraignante de nature transcendante, comme en témoignent la scène du buisson ardent dans l'histoire de Moïse, ou bien les plaintes de Jérémie, qui ne voulait plus parler afin d'échapper à l'opprobre et aux railleries mais reprit sa mission, « vaincu par Yaveh », ou encore la résistance de Mahomet, qui ne céda qu'après que l'ange Gabriel lui eut appliqué de force le visage sur le texte écrit en lui ordonnant de lire. D'ailleurs, le don de prophétie n'est pas accordé en permanence à l'élu. Ainsi, le mormon Cowdery retrouva et perdit le don de traduction ; Barbara Heinemann, de la secte germano-américaine des inspirationnistes (première moitié du xixe s.), perdit le don de prophétie en se mariant, mais le retrouva quelques années plus tard.
Le prophétisme, en deuxième lieu, est une vocation purement personnelle. Selon Max Weber, il s'agirait même là de la caractéristique fondamentale. À quelques exceptions près, par exemple celle de l'aisymnète grec, le charisme est donné au prophète à titre individuel et exclusif, et non en tant qu'il est membre d'une organisation sacerdotale ou autre. Ainsi s'expliquent les oppositions entre les prêtres et les prophètes, ceux-ci fustigeant les pratiques formalistes des premiers. Le plus souvent d'ailleurs, les prophètes se recrutent parmi les laïcs. Peut-être la conjoncture sociale favorise-t-elle l'apparition des prophètes laïcs, mais il n'en reste pas moins vrai qu'ils ont le sentiment de se soumettre à une voix intérieure et non point de répondre à une sollicitation externe.
Le prophétisme a pour troisième caractéristique d'être une forme d'aliénation, en ce sens que l'appelé se sent devenir un autre, comme s'il était possédé par celui au nom duquel il parle. Cette communion avec l'autre peut même prendre l'aspect d'une sorte de dédoublement de la personnalité. À la différence du fidèle, qui croit au surnaturel, le prophète a de celui-ci une expérience vécue ; il est le témoin vivant de sa présence, surtout si, en plus, il possède le don de la thaumaturgie. La transformation qui s'opère en lui se manifeste le plus souvent par l'abandon de son ancien style de vie pour une aventure qui lui apparaît comme irrésistible. Fréquemment, cette aliénation s'exprime dans des termes empruntés au langage sexuel, ce qu'André Neher appelle le « symbolisme conjugal » : ainsi, on rencontre assez souvent dans la littérature prophétique les termes d'époux, de fiancé, d'amant, etc. ; parfois même on attribue le don à une relation sexuelle ; ainsi des prophétesses de l'île Bourou en Indonésie qui considèrent être devenues telles pour s'être accouplées avec un esprit chtonien.
Enfin, le prophétisme implique que, si l'élection est personnelle, le message ne l'est pas : il s'adresse à une communauté déterminée ou même au genre humain. Aussi ne saurait-on séparer le prophète de la masse des fidèles qui entendent sa voix. Il en résulte souvent des tensions avec le pouvoir établi, en particulier lorsque le prophète apparaît comme le législateur d'un nouvel ordre, tels Moïse, Mahomet ou, de nos jours, certains prophètes des pays jadis opprimés. Du reste, il arrive fréquemment que le prophétisme passe du terrain religieux à celui de la politique, lorsque, par exemple, il se développe en mouvement millénariste, comme en Europe à l'époque médiévale ou du temps de la Renaissance et, actuellement, dans divers pays du Tiers Monde.
Ainsi compris, le prophétisme est une manifestation religieuse typique qu'il faut distinguer, en dépit de certaines transitions et confusions possibles, de la mantique et du sacerdoce, celle-là surtout se rapprochant, par exemple la divination de la pythie, de l'art du sorcier en raison de certains procédés magiques communs. Certes, des formes de prophétisme ont existé qui n'étaient pas étrangères à la magie, par exemple dans la Mésopotamie d'autrefois, mais il s'agit là d'un aspect contingent. Le prophétisme se caractérise avant tout par le fait qu'il est au service d'une idée que l'élu propage à ses risques et périls, sans dédommagement et indépendamment des institutions, tandis que le plus souvent la fonction du devin est intégrée dans l'ensemble social, comme celle du sorcier dans les sociétés archaïques ; il en est de même de celle du prêtre, qui est le serviteur rémunéré, sous une forme ou une autre, d'un culte. La figure du prophète, au contraire, évoque la spontanéité et la liberté de la parole, en dehors des normes communes. Aussi sa position est-elle fragile et vulnérable, sa seule sécurité résidant dans la force de sa parole ou éventuellement dans la détermination des fidèles à la protéger. Alors que le sacerdoce est lié à un statut et constitue une carrière (en tant que le prêtre est le fonctionnaire d'un culte), le prophétisme appartient à l'ordre de l'imprévisible. Il est intransmissible, puisqu'il repose sur l'élection charismatique. Aussi constitue-t-il une manifestation exceptionnelle, erratique et irrégulière dans le temps, qui échappe aux conventions, aux formalités et à l'ordre de succession. Le comportement du prophète est chaque fois original par le style et, le plus souvent aussi, par le contenu, mais le phénomène est éphémère puisqu'il s'éteint avec la mort de l'appelé. Une fois celui-ci disparu, sa doctrine devient prétexte à institutions, rites et cérémonies : elle devient pour les fidèles une régulation du quotidien.
Rupture et continuité
Dans la mesure où le prophétisme cherche à rendre manifeste une vérité jusqu'alors cachée ou altérée, ou à redresser et redonner vigueur à un comportement qui s'est perverti avec le temps, il ne prétend pas constituer un commencement absolu. En effet, même lorsqu'il donne naissance à une nouvelle religion, il se réfère explicitement ou implicitement à une révélation antérieure, soit pour la perfectionner, soit pour y faire des emprunts, soit pour s'y opposer. On rencontre à ce propos les modalités les plus diverses : Moïse se considérait comme l'envoyé du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ; Jésus voulait accomplir l'ancienne loi au nom d'une nouvelle alliance ; Buddha est à l'origine d'une véritable dissidence à l'égard de l'hindouisme classique ; d'autres prophètes ont constitué des religions syncrétiques, comme l'orunmbaïsme au Nigeria, le mouvement koreri en Mélanésie ou le caodaïsme en Indochine ; plus nombreux encore sont les prophètes fondateurs de sectes ou d'hérésies, telles que le çivaïsme ou le vishnouisme en Inde, le shī‘isme ou le kharidjisme dans l'islam, les vaudois ou les shakers dans la sphère chrétienne ; certains prophètes, enfin, imitent une religion existante, mais en inversant certaines orientations, comme dans les Églises africaines qui se proposent d'envoyer des missionnaires chez les Blancs ou inventent un Christ noir. L'innovation se présente donc comme une continuité, à cela près qu'elle prétend mettre fin à une dégradation ou à une carence de la révélation antérieure dont elle se réclame. En général, le processus se fonde sur un mythe originel, dont il s'agit de retrouver la pureté primitive, plus rarement sur une projection utopique dans l'avenir.
Paradoxalement, c'est au nom de la continuité que le prophétisme introduit la rupture. Le prophète, en effet, entre inévitablement en conflit avec la religion traditionnelle et, s'il parvient à rassembler une masse importante de fidèles, avec l'ordre politique. S'il suscite au départ la méfiance, le développement du mouvement peut provoquer de véritables crises sociales qui s'accompagnent éventuellement de persécutions, et même d'interventions judiciaires et militaires. Le prosélytisme d'un mouvement atteint généralement sa plus grande virulence durant la vie du prophète et s'apaise après la mort de ce dernier, quand son message s'institutionnalise sous la forme d'une Église ou d'une secte, lesquelles peuvent à leur tour être secouées plus tard par un nouveau prophétisme, en quête de la vérité originelle perdue. Si le prophétisme provoque des troubles, c'est que le plus souvent il est, sociologiquement, le signe d'une crise latente dans la société. Ainsi s'expliquent les fréquentes collusions qu'il entretient avec la politique. Le conflit peut prendre des aspects très divers : d'abord, celui de la protestation, à l'exemple de Buddha, qui renie son enfance heureuse à la vue de la souffrance lors de ses quatre sorties pour se rendre sur son char au parc d'agrément. Il peut s'agir également d'une conduite d'évasion (escapisme) dans le cas d'une attente plus ou moins passive d'une épiphanie de caractère eschatologique (adventisme ; pacifisme de Wovoka, l'initiateur de la danse de l'Esprit chez les Indiens ; quête du « pays sans mal » chez les Tupi-Guarani du Brésil). Le prophétisme peut, enfin, se transformer en un mouvement de libération, tels la plupart des prophétismes du Tiers Monde, qu'ils soient anciens comme le mouvement des antoniens de la prophétesse Kimpa Vita au Congo durant la première moitié du xviiie siècle, ou récents comme les cultes du Cargo en Nouvelle-Guinée et les différentes Native Churches de l'Afrique du Sud, ou encore qu'ils soient des résurgences d'une ancienne religiosité populaire comme le saminisme de Java, le mahdisme du Soudan fondé sur les prophéties hadīth, ou le peyotisme indien. Quoi qu'il en soit, l'idée du retour aux origines pour affirmer la continuité est aussi caractéristique du prophétisme en général que l'innovation qu'il introduit de manière à provoquer la rupture avec l'état de fait.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Julien FREUND : professeur émérite à l'université des sciences humaines de Strasbourg.
Classification
Autres références
-
ABRABANEL (1437-1509)
- Écrit par Colette SIRAT
- 912 mots
Le conflit entre les théories philosophiques universalistes et un attachement plus proprement religieux à la tradition existait depuis plus de deux siècles chez les penseurs juifs. La philosophie sous sa forme averroïste admettait généralement que la vérité philosophique ne différait de la vérité...
-
AFRIQUE NOIRE (Culture et société) - Religions
- Écrit par Marc PIAULT
- 9 622 mots
- 1 média
...l'hégémonie blanche, restent assez proches du protestantisme et du christianisme auxquels elles demeurent explicitement attachées. Il n'en est pas de même des mouvements prophétiques qui se sont développés depuis le début du siècle et ont joué un très grand rôle dans les mouvements de lutte pour l'indépendance.... -
BAHĀ'ISME
- Écrit par Jean CALMARD
- 662 mots
Le bahā'isme est la religion fondée par Mirzā Hoseyn ‘Ali Nuri, connu sous le nom de Bahā Allāh (Gloire ou Splendeur de Dieu, 1817-1892). Originaire d'une famille noble du Māzandarān, il fut parmi les premiers disciples de ‘Ali Mohammad, dit le Bāb (exécuté en 1850). Tourné très tôt vers la vie...
-
BIBLE - Les livres de la Bible
- Écrit par Jean-Pierre SANDOZ
- 7 687 mots
- 4 médias
Un esprit similaireanime la prédication des deux premiers « prophètes écrivains ». Si celle d'Amos, le Judéen (750 av. J.-C.), n'a pas de lien direct avec le Nord, où cependant il exerça sa prédication rude et populaire, au point que son influence se retrouvera seulement quelques décennies... - Afficher les 22 références
Voir aussi