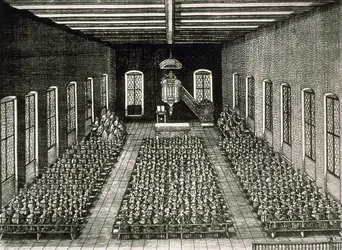PROTESTANTISME Les Églises protestantes de la fin de la Réforme au début du XXe s.
Article modifié le
Les mutations du XIXe siècle
Le xixe siècle a été marqué par des mutations considérables qui étaient liées aux changements politiques ou territoriaux (de 1815) et à l'industrialisation, et qui ont eu pour caractéristiques la contestation des liens avec l'État, un puissant Réveil, une diversification considérable des tendances théologiques, la vitalité diaconale et missionnaire, une pensée théologique enfin qui a mis l'accent sur l'histoire et qui a donné lieu à de grands traités, tels ceux de Ritschl et de Harnack.
Après la Révolution, la Restauration a encouragé les États à redéfinir leurs relations avec les Églises en vue de mieux les contrôler. En Allemagne, le redécoupage territorial a incité plusieurs princes, suivant l'exemple de la Prusse, à réunir luthériens et réformés dans une Église unie. En Scandinavie, on assiste à une adaptation des structures à la situation nouvelle. Les contestations débouchent assez souvent, notamment en France et aux Pays-Bas, à la formation d'Églises libres.
Dans la diversité théologique, s'affirment trois courants principaux. Le rationalisme se mue en un libéralisme, qui est parfois proche de la maçonnerie et qui est très répandu chez les intellectuels et chez les notables ayant une influence politique et économique. Ce libéralisme affaiblit la vitalité religieuse (recul de la pratique) et la spiritualité par un enseignement axé sur la morale et le progrès économique. Certains de ses représentants en viennent à nier même l'existence historique de Jésus.
Dans le sillage du romantisme est apparu le Réveil, qui a pris des modalités diverses et qui fut favorisé par Schleiermacher (1768-1834). Ce dernier a ramené le fait religieux sur le terrain du sentiment ; sa religion est une grandeur qui est autonome à l'intérieur du sentiment et sa théologie tente une médiation entre l'esprit libre et les éléments chrétiens. Le Réveil, qui affecte toute l'Europe protestante entre 1800 et 1850, consiste en un renouveau religieux, accompagné, dans les pays anglo-saxons, de conversions en masse, le plus souvent dans un cadre d'excitation émotionnelle. Il a été illustré notamment par Alexandre Vinet (1797-1847), professeur à Lausanne et apôtre de l'individualisme chrétien, et par le pasteur danois Grundtvig (1783-1872).
Face à ces deux mouvements, se dessina une réaction conservatrice. En Allemagne, elle s'exprima dans le néo-luthéranisme, qui privilégie l'orthodoxie doctrinale et le ritualisme et qui demeure souvent favorable à une réglementation hiérarchique et patriarcale. Un courant parallèle s'affirma en Angleterre sous la forme du sacramentalisme et du ritualisme.
Le développement de la tolérance, la diffusion de la culture dans des milieux sociaux plus étendus et l'insatisfaction face à certains pasteurs de l'Église officielle provoquent la diffusion d'idées hétérodoxes qui donnent naissance à un foisonnement de sectes à travers tout l'espace protestant. Les courants principaux sont les adventistes (chiliastes), les pentecôtistes (glossolalie, guérison de malades) et les mennonites.
La prise de conscience de l'éparpillement des groupes religieux, mais aussi des solidarités qui les unissent, incite, vers la fin du xixe siècle, les responsables des grandes dénominations à opérer un regroupement à l'échelle mondiale. Sont ainsi constituées : en 1875, l'Alliance réformée mondiale ; en 1881, la Conférence œcuménique méthodiste ; en 1891, l'Union internationale des congrégationalistes ; en 1905, l'Alliance mondiale baptiste et, en 1923, l'Alliance luthérienne mondiale.
La grande richesse du xixe siècle protestant est sa vitalité diaconale. Depuis la Réforme, aucune époque n'avait produit autant d'œuvres qui préfigurent l'assistance par l'État : œuvres en faveur des enfants, des handicapés, des malades, en particulier avec des maisons de diaconesses ; Armée du salut ; œuvres de bienfaisance et de prévoyance diverses, auxquelles s'ajoutent, après 1850, de multiples associations ayant une vocation paroissiale, sociale et missionnaire.
En revanche, les protestants n'ont réagi qu'assez tardivement aux problèmes posés par l'industrialisation. En Allemagne, la « mission intérieure » a exercé une activité multiforme et bienfaisante sur le plan local, alors que les Églises n'ont guère accordé de priorité au problème social. En Angleterre, la Christian Social Union a joué un rôle non négligeable et l'Église anglicane a su donner une impulsion nouvelle au christianisme social.
Le protestantisme, qui, au xvie siècle, était confiné à l'Europe et qui s'est ensuite étendu à l'Amérique du Nord, connaît une expansion mondiale, liée en partie aux migrations des émigrants européens en Amérique du Nord – où il s'affirme sous une forme vigoureuse et originale (libre face à l'État) –, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud, en partie aux missions. Celles-ci sont entretenues par de multiples sociétés, notamment la London Missionary Society (fondée en 1795), la Société des missions de Bâle (1815), la Société des missions évangéliques de Paris (1824), la Société des missions de Berlin (1824), la Société suédoise des missions (1835) et la Mission évangélique luthérienne de Leipzig (1836). Alors qu'au début elles étaient assez souvent liées à la colonisation, les missions, tournées désormais vers l'ensemble des pays aujourd'hui en voie de développement, ont su, par une œuvre scolaire et sanitaire, prendre assez vite leurs distances par rapport aux pouvoirs coloniaux. Elles ont, par là, obtenu des succès, certes inégaux, mais réels, en particulier en Afrique et en Océanie. Cet effort s'accompagne en Europe d'un grand souci pour la mission intérieure et la diffusion de la Bible, ainsi qu'en témoigne la British and Foreign Bible Society.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Bernard VOGLER : docteur ès lettres, professeur d'histoire de l'Alsace à l'université de Strasbourg-II
Classification
Média
Autres références
-
ADVENTISME
- Écrit par Jean SÉGUY
- 1 094 mots
Le terme « adventisme » vient du latin adventus, venue. Il désigne une doctrine centrée sur l'attente du retour du Christ à la fin des temps. En lui-même, le vocable adventisme pourrait s'appliquer à tous les mouvements du genre eschatologique de l'histoire du christianisme...
-
ALLEMAGNE (Politique et économie depuis 1949) - République fédérale d'Allemagne jusqu'à la réunification
- Écrit par Alfred GROSSER et Henri MÉNUDIER
- 16 395 mots
- 10 médias
...structures après la guerre. En août 1945, à la conférence de Treysa, un changement de nom fut décidé, qui avait une signification profonde. Désormais, il n'y avait plus une Église évangélique allemande incarnant un type de protestantisme spécifiquement allemand, mais une Église évangélique en Allemagne,... -
ALSACE
- Écrit par Encyclopædia Universalis , Françoise LÉVY-COBLENTZ et Raymond WOESSNER
- 6 484 mots
- 2 médias
...dix-huit mille d'entre eux, et le rétablissement de l'ordre ancien. Calme très relatif, car la Réforme entraîne de profonds bouleversements politiques. Voici Strasbourg devenue une sorte de capitale du protestantisme et portée, de ce fait, à se rallier à la ligue protestante conclue à Smalkalde (1532),... -
AMBOISE CONJURATION D' (1560)
- Écrit par Jean MEYER
- 530 mots
Les protestants français ont accueilli avec soulagement la mort d'Henri II en 1559. Mais les Guise conservent la suprématie politique, et la situation ne s'améliore pas, comme le prouvent l'exécution du conseiller Anne Du Bourg en 1559 et, la même année, la déclaration de Villers-Cotterêts. Or...
- Afficher les 103 références
Voir aussi