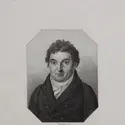- 1. Le traitement des contraires dans le travail du rêve
- 2. Du sens opposé des mots primitifs
- 3. Principe de contraste et représentation indirecte
- 4. Les formes classiques du dualisme freudien
- 5. La polarité du jugement
- 6. Les couples opposés de pulsions partielles
- 7. Couples d'opposés et polarités dans la genèse du moi
- 8. De la psychanalyse du jeune enfant à Lacan
- 9. Bibliographie
PSYCHANALYSE & CONCEPT D'OPPOSITION
Article modifié le
Les couples opposés de pulsions partielles
En fait, le terme de Gegensatzpaar est quasi exclusivement réservé par Freud à la description des couples de pulsions partielles ou perverses : le sadisme et le masochisme, le voyeurisme et l' exhibitionnisme. Une première analyse en est donnée dans les Trois Essais sur la théorie de la sexualité (1905), qui comporte d'ailleurs des modifications datées de 1915. La structure de couple d'opposés, d'appariement (Paarung), selon laquelle s'organisent et fonctionnent ces pulsions prégénitales paraît être pour Freud « d'une grande importance théorique », probablement en rapport, dans son esprit, avec les deux notions cardinales d' ambivalence et de bisexualité. Le but sexuel s'y manifeste sous une double forme, en l'occurrence selon « l'opposition fondamentale entre l'activité et la passivité ». Les deux formes, la forme active, et son « adversaire » passive, toujours agissantes dans l'inconscient, coexistent chez le même individu en proportions variables – bien que soit postulé aussi le principe d'une « égale force » des pulsions opposées par couples, en raison même de leur rapport fondé sur l'ambivalence. Par ailleurs, la névrose représentant le « négatif » dont la perversion constitue le versant positif d'expression, la présence simultanée des deux termes du couple pulsionnel s'établit en parallèle dans les névroses avec les perversions « positives » correspondantes (1905, 1915). Le couple sadisme-masochisme occupe une place à part, d'une importance plus marquée, dans l'ensemble des perversions, en raison, est-il précisé, de son origine passionnelle. Parfois, Freud décrit une autre forme de couple où l'agression sadique, la motion hostile, s'oppose non au masochisme proprement dit, mais à la motion tendre, à la tendresse, comme lorsqu'il reprend la description des conduites du petit Hans (1909, 1926). Malgré leur connexion essentielle, les pulsions perverses organisées en couples d'opposés « aspirent à se satisfaire dans une indépendance réciproque et trouvent pour la plupart leur objet dans le corps du sujet » (1925). Dans le même texte, Freud réfère la source génétique des couples sadisme-masochisme et voyeurisme-exhibitionnisme au régime du fonctionnement auto-érotique, c'est-à-dire à un mode très primitif d'organisation du sujet. L'émergence des formations réactionnelles, qui donnent l'apparence d'un changement du contenu pulsionnel, est favorisée par cette organisation des pulsions perverses en couples d'opposés, dont résulte leur ambivalence affective (1915). Une autre forme de perversion, le fétichisme, est décrite en tant que déterminée par un processus de clivage, comme « doublement nouée à des opposés » – ainsi la tendresse et l'hostilité avec lesquelles on traite le fétiche et qui correspondent respectivement au déni et à la reconnaissance de la castration féminine (1927).
Dans « Pulsions et destins des pulsions », Freud reprend l'analyse des couples sadisme-masochisme et voyeurisme-exhibitionnisme, non plus seulement dans une perspective phénoménologique, comme dans les Trois Essais, mais dans le cadre de ce que Jean Laplanche a proposé d'appeler une « genèse idéale », sous la forme d'une « dialectique interne », des deux couples de pulsions perverses. Cette dialectique met en jeu quatre temps – un temps préliminaire et trois temps principaux – qui concernent la mise en place de l'organisation primitive du sujet, dans son rapport de différenciation originelle avec l'objet, en l'occurrence le partenaire humain. Le temps préliminaire se situe au seul plan du fonctionnement des pulsions d'autoconservation. Il concerne le sujet purement biologique, par opposition au sujet libidinal proprement dit, dont l'émergence est décrite dans la succession des trois moments ultérieurs. Bien que Freud n'ait indiqué que de manière allusive ce raccord, la dialectique des pulsions perverses doit être conçue comme venant s'ajuster à la description, un peu plus loin dans le texte, de la genèse des figures du moi, que nous avons déjà évoquée à propos de « La Négation » et dont « Pulsions et destins des pulsions » fournit, à la suite d'un texte de 1911, un premier modèle. Cette genèse – moi-réalité du début et moi-plaisir originel – s'ordonne elle-même au cadre d'ensemble d'une « genèse de la haine et de l'amour ». La dialectique des pulsions perverses est commandée par un couple fondamental de mécanismes. Freud présente tout d'abord le « renversement » ou parfois la « transformation », dans le contraire (Verkehrung, Verwandlung ins Gegenteil), que nous avons rencontré comme constituant le second mécanisme du traitement des contraires dans le travail du rêve. Mais ici, il en spécifie deux variétés différentes : d'une part, le « renversement de l'activité en passivité », ou « retournement[Wendung]d'une pulsion de l'activité à la passivité », ou encore « transformation[Verwandlung]du but pulsionnel actif en but passif », d'autre part, le « renversement du contenu »[inhaltliche Verkehrung], ou encore la « transformation d'une pulsion dans son contraire », spécifiquement de l'amour en haine. Seule la première variété du mécanisme de renversement intéresse directement la dialectique des pulsions perverses. Un second mécanisme d'importance centrale dans cette dialectique est le « retournement sur la personne propre » ou, parfois, « le moi propre » (Wendung gegen die eigene Person [...] das eigene Ich), qu'il y a lieu de considérer également, à côté du renversement dans le contraire, comme une espèce de mécanisme général de l'inversion (du sens, des personnes, des situations, de la séquence temporelle) qui intervient dans l'élaboration du rêve. Par ailleurs, dans « Pulsions et destins des pulsions », le mécanisme de retournement sur la personne propre apparaît aussi comme une espèce d'un genre plus général, que Freud qualifie au passage comme « changement de l' objet » (Wechsel des Objektes), lequel peut fonctionner aussi comme « changement du sujet » et joue un rôle d'ensemble majeur dans l'économie du double processus d'instauration et de dissolution de l'organisation narcissique. En dehors de ces mécanismes indiqués, les deux catégories cardinales de cette double analyse sont, d'une part, celle de « couple d'opposés » dans la dialectique des pulsions perverses aussi bien que dans la genèse des formes du moi, d'autre part, celle de « polarité » dans le seul cadre de cette dernière.
Le temps préliminaire de la dialectique des pulsions perverses met en jeu le sadisme, mais sous une forme encore non sexuelle, à laquelle conviendrait mieux, selon J. Laplanche, le terme d'« hétéro-agression », voire d' agressivité en général. Il s'agit de l'ingrédient de violence, de la composante agressive propre à l'exercice de la « pulsion d'emprise » en tant que tendance à se rendre maître de l'autre objet, par le moyen de l'activité musculaire, sans considération de sa souffrance éventuelle et sans gain d'aucun plaisir sexuel. Dans la dialectique du voyeurisme-exhibitionnisme, le temps préliminaire est décrit comme l'activité de regarder, distincte du voyeurisme en tant que perversion sexuelle. Ce temps préliminaire, bien qu'il mette en jeu le dynamisme originel de l'organisme sous la double forme des activités musculaire et visuelle, ne suppose encore aucune différenciation explicite du sujet et de l'objet.
L'étape qui lui succède, et qui est le premier temps de la dialectique des pulsions, est marquée par l'émergence de l'organisation narcissique primordiale, sous la forme d'un sujet-objet prédifférencié. Cependant que l'objet véritablement externe n'existe pas encore, le sujet s'y rapporte déjà à un objet particulier, sous l'espèce de son propre corps. Ce temps est caractérisé, en ce qui concerne le sadisme, par l'auto-agression ou masochisme « réfléchi » (Laplanche), dans lequel le sujet se fait à la fois son propre bourreau et sa propre victime. La dynamique de ce processus repose sur l'action conjointe du mécanisme de retournement sur la personne propre, concernant l'objet, et de celui de renversement dans le contraire, concernant le but, de la pulsion. Le régime de celle-ci passe alors de la voix active du verbe (tourmenter) non pas encore à la voix passive (être tourmenté), mais à la « voix moyenne réfléchie » (se tourmenter soi-même). Le tourment infligé à soi-même, dans lequel par ailleurs Freud voit un des symptômes caractéristiques de la névrose obsessionnelle, n'est pas encore le masochisme véritable. Pour le couple voyeurisme-exhibitionnisme, la pulsion trouve à ce niveau à la fois son but et son objet dans le plaisir de regarder le corps propre, situation que l'on peut caractériser comme voyeurisme réfléchi. À ce propos, Henri Wallon surtout et Jean Piaget ont signalé l'intérêt passionné de l'enfant, au cours du second semestre, pour le mouvement de ses mains. On peut songer aussi à la description lacanienne du stade du miroir, dès l'âge de six mois mais bien au-delà aussi, où la conduite de l'enfant s'exprime par « une intuition illuminative, un gaspillage jubilatoire d'énergie et un ludisme de repérage », dont Lacan met l'ensemble en rapport avec l'émergence du narcissisme. Effectivement, ce premier temps « réfléchi » de la dialectique des pulsions perverses marque l'apparition, par retournement sur soi ou procès d'intériorisation, d'un moi narcissique originaire organisé selon une prédifférenciation, un clivage interne sujet-objet. J. Laplanche caractérise par « le repli auto-érotique et le rebroussement dans le fantasme » cette formation narcissique primordiale dans laquelle il convient d'inclure une double composante sadomasochique (D. Lagache) et autoscopique (J. Lacan). La satisfaction sexuelle y fait son apparition, produite par plusieurs voies : tout d'abord par étayage direct sur la satisfaction élémentaire, puis par les diverses activités auto-érotiques, dont le suçotement, enfin peut-être par double étayage sur les pulsions perverses – le plaisir de regarder les parties accessibles du corps et le déplaisir lié aux sensations désagréables, à la fois subies comme tensions internes et infligées activement à soi-même. Henri Wallon a signalé la tendance du tout jeune enfant à s'infliger des sévices à soi-même, par exemple, à l'âge d'un an environ, à se cogner la tête. Les deux mécanismes de renversement dans le contraire et de renversement de l'activité en passivité sont des « destins pulsionnels », précise Freud, qui caractérisent « l'organisation narcissique du moi ». En outre, ils représenteraient des mécanismes primitifs de défense, précédant l'installation du refoulement. Le repli narcissique, corrélatif à l'émergence d'un moi, constituerait un processus défensif à l'égard, par exemple, de l'incohérence et de l'incoordination fonctionnelles propres à l'état de détresse néo-natale. Ce temps de la voix moyenne réfléchie correspond, en ce qui concerne la genèse du moi, à l'étape du moi-réalité initial, dans la mesure où celle-ci se définit explicitement par le narcissisme. Le monde extérieur y est indifférent, c'est-à-dire qu'il n'existe pas encore, tandis que le sujet-objet narcissique satisfait ses pulsions sur lui-même, en l'occurrence sur son corps-objet. Cependant, un processus se fait jour dans son organisation monadique, qui se développera de manière encore plus marquée avec l'étape ultérieure, dite du moi-plaisir originel. Dans la boule de plaisir auto-érotique, constituée par la monade narcissique, surgissent des excitations désagréables, de provenance aussi bien endogène qu'exogène – mais cela seulement du point de vue de l'analyse, car la différenciation entre le dedans et le dehors n'est pas encore structurée. En fait, bien que Freud n'indique pas explicitement cette équivalence, ce moi-réalité, qui cumule en lui les sensations plaisantes tout en éprouvant, à terme, des sensations déplaisantes, est en définitive de structure tout à fait homologue à celle de ce sujet de la voix moyenne réfléchie, lequel s'affecte lui-même dans le double registre ambivalent du sadomasochisme et du ludisme spéculaire.
Alors que le temps primitif de la dialectique des pulsions perverses représente le processus d'autoconstitution de la monade narcissique, les deux temps ultérieurs représentent son éclatement, sa dissolution sous la forme de deux figures à la fois ordonnées et complémentaires. Effectivement, ces deux temps coordonnés comportent pour la pulsion d'abord convertie en auto-agression (temps « réfléchi » premier) une « double dérivation symétrique », une bifurcation vers deux destins différents, l'un de forme active, l'autre de forme passive. Il s'agit du sadisme et du masochisme vrais, c'est-à-dire comme perversions comportant le plaisir sexuel. L'unité bipolaire du sujet-objet narcissique initial se trouve dissociée selon ses deux composantes, qui sont alors éjectées à distance sous forme d'un couple de partenaires. À partir du double but actif-passif propre au masochisme et au voyeurisme réfléchis, le destin de la pulsion comporterait une disjonction de ce but composite de la « voix moyenne ». Toutefois, dans ce mouvement, précise Freud, l'émergence du but actif se produit avant celle du but passif. En premier lieu, à partir de l'auto-agression, c'est-à-dire du masochisme réfléchi, un premier type de « renversement du but », d'actif-passif en actif, joint à une première forme de « retournement » de la personne – retournement du sujet-objet réfléchi sous forme d'objet masochiste –, conduirait au sadisme. En second lieu, toujours à partir de l'auto-agression, un autre type de « renversement du but », d'actif-passif en passif, joint à une seconde forme de « retournement » de la personne – retournement du sujet-objet réfléchi sous forme de sujet sadique –, conduirait au masochisme. La figure du sadisme suppose un changement (Wechsel) de l'objet narcissique initial contre un « objet étranger » : la victime. Et la figure ultérieure du masochisme suppose le changement du sujet narcissique contre un « sujet étranger » : le bourreau. Par rapport à la constitution de la monade narcissique, l'émergence des deux figures du sadisme et du masochisme met en jeu de nouvelles formes de renversement du but pulsionnel et de retournement à l'égard de la personne. Étant supposé que ces mécanismes ont une fonction défensive dans le premier temps, ils doivent la comporter aussi dans les deux temps ultérieurs. On peut supposer que les deux rôles complémentaires du sadomasochisme, dans la mesure où ils supposent une certaine indépendance du sujet due à l'émergence de l' objet, aménagent de façon plus différenciée le sujet-objet de la voix moyenne réfléchie qui définit le narcissisme et qu'ils permettent ainsi un meilleur contrôle de la vie pulsionnelle.
Il y aurait, selon l'interprétation que Laplanche donne du texte difficile de Freud, deux genèses différentes du masochisme, soit à partir du masochisme réfléchi, soit à partir du sadisme retourné. Dans ce cas, le passage du sadisme au masochisme supposerait un renversement du but pulsionnel actif en but passif, en même temps qu'un retournement sur la personne lié à un changement d'objet : l'objet masochiste du sadique est abandonné par celui-ci et remplacé par sa personne propre, cependant qu'il cherche un partenaire pour le situer à la place du sujet qu'il vient d'abandonner. Cette deuxième solution s'accorderait d'ailleurs mieux avec ce que déclare Freud dans le texte de 1915, en postulant la primauté génétique du sadisme par rapport au masochisme. Or, en 1924, Freud a abandonné ce point de vue pour faire l'hypothèse d'un masochisme, ou plutôt même d'un sadomasochisme originaire, qui paraît bien dans une grande mesure correspondre au masochisme réfléchi de 1915, quitte à faire l'abandon du temps préliminaire de l'hétéro-agression. C'est pourquoi Laplanche, compte tenu de la position ultérieure de Freud, tend à forcer le texte de 1915, pour faire dériver le masochisme secondaire, aussi bien que le sadisme, de la source commune de l'auto-agression. Il faut reconnaître que cette solution correspondrait mieux à la pensée de Freud telle qu'elle se formule en 1924. En tout état de cause, il n'y a pas de raison, du point de vue clinique, de ne pas retenir les deux solutions.
La dialectique décrite sur le cas du couple sadisme-masochisme s'applique également, et dans les mêmes termes, au couple voyeurisme-exhibitionnisme. D'après Freud, un double processus d'identifications symétriques et croisées relie les deux partenaires de chaque couple, malgré le mouvement d'éjection réciproque qui les a posés à distance l'un de l'autre. Le sujet sadique, tout en occupant sa place, se transporte par identification à celle de l'objet, pour jouir de façon masochiste de la souffrance qu'il lui inflige. De même, l'objet masochiste, préservant sa propre place, se transfère par identification à celle du sujet sadique, pour jouir sur un mode sadique du plaisir de celui-ci. Autrement dit, le masochiste souffre, mais en jouissant, identifié à lui, de la jouissance du sadique, alors que le sadique jouit, mais en souffrant, identifié à lui, de la souffrance du masochiste. Une structure d'identification en miroir relie donc l'une à l'autre, en une forme de cercle, la jouissance-souffrance du sadique et la souffrance-jouissance du masochiste. Ainsi s'explique la possibilité incessante d'une substitution des rôles des deux partenaires.
Le temps de la voix moyenne réfléchie correspondait, dans la genèse du moi, à l'étape du moi-réalité initial. Or les deux figures complémentaires et finales de la dialectique des pulsions perverses correspondent elles-mêmes, de manière isomorphe, à l'étape du moi-plaisir originel. Cette étape est celle où apparaît la limite entre le dedans et le dehors, en rapport avec le double processus d'introjection du bon et d'expulsion du mauvais, sous le régime du principe de plaisir. Comme Freud l'indique expressément, l'évolution du moi-réalité initial vers le moi-plaisir originel représente le passage d'un « stade purement narcissique » au « stade de l'objet ». En outre, ce premier objet se présente au sujet, qui vient de s'en détacher, avec un caractère hostile, sous le visage de la haine : « L'objet coïncide avec l'étranger et le haï ; la haine, en tant que relation à l'objet, est plus ancienne que l' amour. » De toute évidence, le caractère de ce premier objet, de ce « dehors étranger et menaçant », évoque directement les dispositions agressives du partenaire actif à l'égard de la personne-objet dans les couples de pulsions perverses. Cet objet menaçant est d'abord un partenaire humain, rencontré comme sadique ou comme voyeur. Daniel Lagache a bien identifié (1960), à la suite d'ailleurs de J. Lacan (1938, 1949), la relation originaire qui noue dans un système complexe de transformations le narcissisme et les figures du sadomasochisme. Lacan a tout spécialement insisté sur l'importance primordiale de la pulsion scopique, qui commande en particulier le régime « réfléchi » de la perversion, propre à l'organisation narcissique. D'après Lagache, la dialectique sadomasochiste jouerait primitivement dans les rapports entre enfants et parents. Entre les uns et les autres se noueraient des relations perverses du type domination-soumission, qui mettent en jeu des conflits de pouvoir entre demandeur et demandé et qui rompent la relative convergence des désirs, propre au narcissisme primaire.
L'organisation des pulsions perverses selon des couples d'opposés implique donc une dialectique dont le ressort consiste en deux mécanismes particuliers, qui consistent en deux espèces du mécanisme général de l'« inversion » (Umkehrung), dont nous avons vu le rôle dans le travail du rêve, le mot d'esprit et d'autres formations psychiques.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Émile JALLEY : ancien élève de l'École normale supérieure, professeur de psychologie et d'épistémologie à l'université de Paris-Nord
Classification
Autres références
-
INCONSCIENT
- Écrit par Christian DEROUESNE , Hélène OPPENHEIM-GLUCKMAN et François ROUSTANG
- 8 284 mots
- 2 médias
...négation. Mais l'exclusion est-elle le seul mode de relation exprimé par la négation ? La plus élémentaire réflexion logique amène à considérer qu'un terme qui s'oppose à un autre le suppose et même l'inclut avant de l'exclure, et c'est bien cela que formule l'inconscient en utilisant un seul élément à ... -
LIBIDO
- Écrit par Pierre KAUFMANN
- 11 339 mots
- 1 média
...est-ce précisément sur la fonction de cette ligne de partage qu'interviendront les développements essentiels de la notion. Pour en résumer le principe, l'opposition de l'organisme au psychisme se doublera de l'opposition de l' inconscient au conscient, le processus organique ne se... -
LINGUISTIQUE ET PSYCHANALYSE
- Écrit par Jean-Claude MILNER
- 7 215 mots
On sait combienl'opposition actif/passif joue un rôle important dans la construction freudienne. En dehors même des exemples que nous avons cités, elle fonde un très grand nombre de concepts essentiels de la théorie. Or cette opposition ne se laisse bien définir que dans certaines traditions grammaticales.... -
OPPOSITION CONCEPT D'
- Écrit par Émile JALLEY
- 18 863 mots
- 4 médias
Freud distingue deux mécanismes du traitement des contraires dans le rêve : l'un est l'identification des contraires, l'autre est la transformation dans le contraire. Or, dans le texte intitulé Des sens opposés dans les mots primitifs (1910), il rapproche le premier des vues du...
Voir aussi
- BISEXUALITÉ
- OBSESSION ET NÉVROSE OBSESSIONNELLE
- PERVERSIONS
- CONTRADICTION
- HYSTÉRIE
- PSYCHIQUE APPAREIL
- NÉVROSE
- REPRÉSENTATION & CONNAISSANCE
- AUTOÉROTISME
- SATISFACTION
- HAINE
- LANGUES ÉVOLUTION DES
- SPALTUNG ou CLIVAGE, psychanalyse
- SADISME ET MASOCHISME
- PULSION DE MORT
- PRÉCONSCIENT
- MOT D'ESPRIT
- PÉNIS
- ANAL STADE
- ÉROS, psychanalyse
- ATTACHEMENT THÉORIE DE L'
- BOWLBY JOHN (1907-1990)
- PSYCHOLOGIE GÉNÉTIQUE
- NEURASTHÉNIE
- MÈRE-ENFANT RELATION
- CURE, psychanalyse
- SIGNIFIANT
- SEXUALITÉ INFANTILE
- ENFANCE, psychanalyse
- FREUDIENNE THÉORIE
- ANTITHÈSE, rhétorique
- VOYEURISME
- EXHIBITIONNISME
- PERCEPTION-CONSCIENCE, psychanalyse
- DUALISME DES PULSIONS
- ÉTAYAGE, psychanalyse