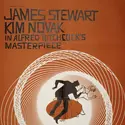- 1. Une forme d'expression liée à l'écriture
- 2. La publicité « à la remorque » de l'art ?
- 3. La publicité utilisée par les Beaux-Arts
- 4. Le surréalisme comme élément perturbateur dans la peinture et la publicité
- 5. La publicité comme moyen d'échapper à la censure
- 6. Le publicitaire et l'art
- 7. Fondements de l'art et publicité infondée
- 8. Art et publicité : avant, pendant, où et après
- 9. Bibliographie
PUBLICITÉ ET ART
Article modifié le
Le publicitaire et l'art
L'artiste qui fait de la publicité uniquement « pour gagner sa vie » ressent souvent son activité professionnelle comme une indignité. En effet, le dédain dans lequel la publicité est tenue par l'historien et le critique d'art – même s'ils s'en défendent – porte préjudice à l' œuvre d'art « pure » lorsqu'elle est réalisée par un publicitaire, à telle enseigne que certains préfèrent œuvrer dans ces domaines séparés sous des noms différents. Bien sûr, Toulouse-Lautrec, Bonnard, Vuillard réalisèrent des affiches qui ont fait date ; mais l'idée selon laquelle, de leur temps, existait encore une affiche « artiste » ne persiste que pour permettre de mieux déplorer ce qui s'est passé après. Pour un Roland Sirletti qui fait volontiers état de sa formation et de son activité publicitaires, combien de publicitaires qui, à l'image de Cassandre, se désolent de ne pas être reconnus comme des artistes à part entière, dont l'œuvre graphique est pourtant supérieure à bien des œuvres d'art. L'artiste lutte pour être exposé sous son nom, le publicitaire, lui, voit ses réalisations présentées comme des œuvres anonymes, d'autant plus qu'aujourd'hui il appartient souvent à une agence où directeur artistique, concepteur, graphiste, photographe réalisent un produit graphique qui s'inscrit dans l'ensemble d'une campagne publicitaire. Pour un Vittorio Fiorucci qui maintient une indépendance constamment menacée, combien d'agences se forment pour faire front et dialoguer d'égal à égal, c'est-à-dire d'entreprise à entreprise, avec des groupes puissants ! L'artiste est censé placer l'essence de l'art au-dessus de son existence alors que le publicitaire est voué avant tout au contingent. A priori, on accorde au fresquiste, qui exécute une scène de caractère religieux ou politique – bien qu'il vise, tout comme le publicitaire, à convaincre –, une qualité d'essence qui, à défaut d'être celle de l'œuvre elle-même, passe pour être celle de la peinture. Le publicitaire est lié à un présent qui, par avance, le disqualifie aux yeux de l'amateur d'art. Son activité, ouvertement commerciale, est démonétisée sur le plan esthétique, toujours au nom de l'essence. Un critique d'art n'est-il pas allé jusqu'à qualifier l'image publicitaire de « prostituée » ? Mais l'art lié à une cause, à un certain type de mécénat n'est-il pas prostitué ? Que penser des portraitistes obligés de flatter leurs modèles et qui n'en ont pas moins réalisé des tableaux tenus pour des chefs-d'œuvre ?
La valeur « artistique » conférée à une œuvre tient également à son caractère unique. L'artiste qui utilise la lithographie ou la gravure travaille pour le nombre, tout en limitant la quantité d'exemplaires mise sur le marché. Les techniques employées sont alors considérées comme des prolongements de la peinture et ne sont pas considérées comme de simples reproductions, dans la mesure où le nombre d'exemplaires en circulation reste plus près de l'exemplaire unique que du grand nombre. Or la publicité, elle, est placée sous le signe de la quantité. L'œuvre d'art est une par rapport au zéro de l'origine – le zéro est ici comme une frontière entre l'infini et le un – et chaque exemplaire d'un tirage limité constitue une unité supplémentaire, le numéro l'atteste, la signature l'authentifie. L'affiche, l'objet publicitaire sont privés de ce rapport étroit à l'origine, de cette identité à la rareté liée encore à l'artiste par le fil sacré de la signature. Alors qu'importe que de très nombreuses œuvres publicitaires soient esthétiquement supérieures à des œuvres considérées a priori comme artistiques simplement parce que l'on sait qu'elles sont produites à de rares exemplaires. Quand l'artiste pop utilise un emballage ou une bande dessinée comme sujet de son œuvre – même s'il copie servilement son modèle – ou quand un peintre fait ouvertement état de préoccupations mercantiles, l'œuvre produite sera néanmoins tenue pour de l'art en fonction d'une vision globale en dépit du modèle imité ou du cynisme affiché. Le peintre de génie et celui qui n'a pas de talent, malgré leur inégalité sur le plan de la création, sont dans l'esprit de la critique et du public plus près l'un de l'autre que le premier ne l'est de graphistes comme Milton Glaser ou Ikko Tanaka et cela en raison de leur appartenance à une même sphère d'activité qui les rend égaux. C'est respectivement – c'est-à-dire chacun selon son appartenance – que sont reconnus les talents d'un Klee ou d'un Cassandre, et non en fonction de critères de jugement qui seraient communs à l'un et à l'autre. Le grand public lui-même reconnaît pour de l'art ce qu'il ne comprend pas ou ce qui l'ennuie, mais il refuse cette qualité à ce qui le séduit ou l'amuse.
L'affiche et l'annonce ne sont maintenant que des maillons dans la chaîne d'actions d'une campagne publicitaire. Flashes radiophoniques et films publicitaires existent depuis longtemps. Mais, alors que l'affiche a bénéficié dès le départ d'une assistance artistique importante, flashes et écrans ont été pendant des décennies considérés comme des produits purement techniques de la radio et du cinéma. Grâce au développement de la télévision, les flashes font maintenant l'objet d'un soin particulier. Des metteurs en scène, connus par ailleurs comme des réalisateurs de longs métrages (Annaud, Beneix...), créent des films très courts, certes, mais dans lesquels ils utilisent toutes les techniques et tous les talents afin d'offrir en un bref instant un véritable feu d'artifice visuel. La vidéo permet d'obtenir des effets plus spectaculaires que ceux du cinéma et élimine peu à peu la notion de « trucage ». L'invention visuelle peut aboutir à des productions d'une rare efficacité : le film de Jean-Paul Goude réalisé en 1987 pour le Crédit lyonnais est, à cet égard, une grande réussite : à une suite de « non » articulés par des personnages et des machines succède un « oui » qui signifie bon accueil et services efficaces. Là encore, les conditions mêmes de l'apparition du spot publicitaire, entre deux émissions ou pour marquer la coupure d'un film ou d'un téléfilm, le placent « hors la loi » par rapport à la critique d'art. De même qu'un téléfilm de grande valeur ne laisse guère de traces dans l'esprit du spectateur et aucune dans les fiches de l'historien de cinéma, de même le film publicitaire restera, en dernier ressort, un document d'archives pour publicitaires. D'ailleurs, le publicitaire lui-même, interrogé sur la valeur artistique de sa production répond : « Non, la publicité n'est pas un art. C'est un moyen de communication qui peut permettre à un artiste de s'exprimer. Mais certaines publicités sont si belles qu'on peut les considérer comme des œuvres d'art » (Jean-Paul Goude, Le Monde, 8 juin 1988).
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Marc THIVOLET : écrivain
Classification
Média
Autres références
-
AFFICHE
- Écrit par Michel WLASSIKOFF
- 6 818 mots
- 12 médias
...Sarah Bernhardt (Médée, 1898), créant également pour elle des costumes de scène et des bijoux, œuvre ainsi, dans le même temps, à l'imagerie publicitaire des biscuits Lefèvre-Utile ou du papier à cigarettes Job. Fernand Louis Gottlob, Manuel Orazi, Maurice Réalier-Dumas, autres figures de l'Art... -
BAYER HERBERT (1900-1985)
- Écrit par Yve-Alain BOIS et Encyclopædia Universalis
- 1 672 mots
...Bayer, bien que les principes qu'ils mettent en œuvre aient déjà été énoncés (mais non pleinement appliqués) par Moholy-Nagy. La transformation du mot en slogan (par des variations de taille dans les caractères, l'utilisation de la couleur rouge, de lignes grasses ou de couleur pour souligner, de caractères... -
BOURDIN GUY (1928-1991)
- Écrit par Christian CAUJOLLE
- 821 mots
Unanimement reconnu comme l'un des plus grands photographes du demi-siècle et comme le plus brillant inventeur d'images de mode et de publicité, Guy Bourdin reste une personnalité à la biographie mystérieuse. De même qu'il a toujours refusé les rétrospectives, les expositions, les monographies ou les...
-
CARLU JEAN (1900-1997)
- Écrit par Nelly FEUERHAHN
- 850 mots
Né le 30 mai 1900 à Bonnières-sur-Seine dans une famille passionnée d'architecture (il est le frère cadet de Jacques Carlu), Jean Carlu s'engage dans cette voie à l'École des beaux-arts de Paris. Alors qu'il vient d'être primé au concours d'affiches du dentifrice Glycodont, le 28 octobre 1918, le jeune...
- Afficher les 40 références
Voir aussi