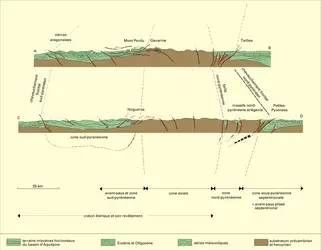PYRÉNÉES
Article modifié le
Géographie humaine
Sur 450 kilomètres de longueur entre Atlantique et Méditerranée, les Pyrénées ont souvent été présentées comme l'archétype de la montagne barrière, compacte et homogène. Barrant l'isthme sur toute sa largeur, elles reléguaient la péninsule Ibérique en périphérie de l'Europe. Or cette vision doit être révisée, tant les Pyrénées apparaissent diverses et tant elles fonctionnent aujourd'hui comme un trait d'union vital entre la France et l' Espagne.
Les grilles de lecture de l'espace pyrénéen
L'opposition entre les versants nord et sud
C'est l'opposition la plus évidente, soulignée à petite échelle par l'unification politique de chacun des versants et par la frontière, inchangée depuis le traité des Pyrénées (1659), même si, dans le détail, celle-ci s'affranchit souvent de la ligne de crêtes (forêt d'Iraty, Val d'Aran, Cerdagne). Le versant nord, plus étroit, est aux trois quarts tourné vers l'Atlantique, par la Garonne et l'Adour, alors que le versant sud, large de plus de 80 kilomètres dans l'ouest catalan, est presque tout entier drainé vers la Méditerranée par les affluents de l'Èbre. La dissymétrie entre les Pyrénées françaises et espagnoles traduit bien une position de périphérie à l'échelle européenne : en effet, tandis que, dans les quatre régions pyrénéennes espagnoles, le P.I.B. par habitant est supérieur à la moyenne nationale, le P.I.B. par habitant des trois régions pyrénéennes françaises est inférieur à la moyenne française.
La diversité longitudinale
L'opposition des deux versants ne doit pas masquer la grande diversité qui se déploie longitudinalement entre Atlantique et Méditerranée. Sur le plan administratif se succèdent ainsi en Espagne quatre autonomies régionales (Pays basque, Navarre, Aragon et Catalogne) auxquelles répondent en France trois régions (Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon). Mais cette diversité se lit aussi sur le plan linguistique et culturel, avec l'aire bascophone et la Catalogne qui chevauchent les deux versants, l'Aragon de langue castillane, et l'Occitanie dans ses variantes gasconne et languedocienne. Certains sommets marquent les limites entre ces différents domaines, comme le pic d'Anie (2 501 m) entre le Pays basque et le Béarn, ou le pic d'Aneto, point culminant de la chaîne (3 404 m), entre l'Aragon et la Catalogne
L'opposition entre les extrémités et la partie centrale de la chaîne
Si, aux deux extrémités de la chaîne, les aires culturelles chevauchent la ligne de crêtes, tel n'est pas le cas dans la partie centrale des Pyrénées, plus enclavée : entre le col du Pourtalet (1 794 m, à l'amont de la vallée d'Ossau) et le col de Puymorens (1 915 m, à l'amont de la vallée de l'Ariège), aucun point de franchissement ne s'abaisse au-dessous de 2 000 mètres. C'est là, derrière le port d'Envalira (2 408 m), que se niche la coprincipauté d'Andorre, survivance médiévale. Cette partie centrale n'a d'ailleurs pas été fortifiée, contrairement aux vallées du Roussillon, du Béarn et du Pays basque. Mis à part quelques îlots présentant une forte activité touristique comme le val d'Aran, les densités de population ou la densité du réseau routier sont nettement plus faibles dans la partie centrale de la chaîne.
L'organisation des réseaux urbains
Celle-ci fait bien apparaître la hiérarchisation des espaces pyrénéens. À l'intérieur de la chaîne ou juste en bordure, les anciennes capitales valléennes sont de petites villes, souvent spécialisées, qui comptent en général moins de 20 000 habitants (Lourdes, Saint-Gaudens, Foix, Andorre-la-Vieille, La Seu d'Urgel, avec l'exception notable de Huesca, 45 000 hab.). Les pôles régionaux sont installés sur le piémont (Pau : 194 000 hab., Tarbes : 103 000 hab.) ou dans des bassins intérieurs (Pampelune : 195 000 hab.), et s'affirment comme des centres de services à l'échelle d'un département français ou d'une province espagnole. Enfin, les grandes métropoles sont situées nettement en avant de la chaîne et rayonnent sur des espaces beaucoup plus vastes (Saragosse : 650 000 hab., Toulouse, 760 000 hab. en 1999 et surtout Barcelone).
L'actualité d'une montagne barrière
Le contexte issu de 1986
Le développement du tourisme dans la péninsule Ibérique à partir des années 1960 induisit une première augmentation des contacts entre les deux versants des Pyrénées. Mais c'est surtout l'entrée de l'Espagne et du Portugal dans la Communauté économique européenne, en 1986, qui transforma radicalement le statut des Pyrénées, désormais tout entières incluses dans l'espace communautaire et passage obligé entre la péninsule Ibérique (et le Maroc) et le reste de l'Europe. Cette nouvelle situation se traduisit par une très forte augmentation du trafic transpyrénéen et par l'aménagement de nouveaux axes (tunnels routiers de la Sierra de Cadi ouvert en 1987 ou du Somport ouvert en 2003).
La question des transports
Si vingt-sept points de passage routiers sont ouverts entre France et Espagne, plus des deux tiers du trafic passent aux deux extrémités de la chaîne, avec une légère prééminence pour le franchissement au Pays basque (36,5 p. 100 entre Irun et Hendaye, contre 30,6 p. 100 côté méditerranéen entre Le Perthus et La Jonquera, en 2004). Cette concentration ne cesse d'ailleurs de se renforcer : entre 1985 et 2005, le trafic au péage de Biriatou (Pyrénées-Atlantiques) a été multiplié par plus de cinq. La Cerdagne et l'Andorre concentrent 18,6 p. 100 du trafic, si bien que les quinze routes de la partie centrale de la chaîne, entre la vallée de la Garonne et le littoral basque, n'écoulent que 13,6 p. 100 du trafic : le tunnel de Bielsa par exemple, ouvert en 1976 entre les Hautes-Pyrénées et l'Aragon, ne voit passer qu'un peu plus de mille véhicules par jour dans chaque sens. De même, le tunnel de Vielha (1948, doublé par un nouveau tunnel en 2007) dessert surtout le Val d'Aran en tant que destination touristique pour les Espagnols.
Quant au réseau ferré, qui n'assure que 4 p. 100 du trafic marchandises transpyrénéen en 2004, il se concentre également sur les itinéraires littoraux, surtout depuis la fermeture en 1970 de la voie ferrée Pau-Canfranc-Saragosse sous le Somport. La construction d'une ligne à grande vitesse par le col du Perthus renforcera encore cette littoralisation du trafic.
Toutefois, le prolongement de l'autoroute A 66 et le passage à 2 fois 2 voies de la RN 20 dans la vallée de l'Ariège préfigurent le renforcement d'un grand axe Toulouse-Barcelone par la Cerdagne et peuvent à terme modifier la géographie du trafic transpyrénéen en reliant directement les deux métropoles régionales.
Ancienneté et renouveau de la coopération transfrontalière
Les sociétés agro-pastorales des Pyrénées se sont depuis longtemps caractérisées par des accords entre communautés des versants français et espagnols. À l'échelle locale, le caractère de montagne frontière était donc atténué par ces accords de « lies et passeries », renouvelés à l'occasion de cérémonies annuelles. Plus récemment, des jumelages entre communes sont venus s'ajouter (par exemple au Pays basque entre Sare dans les Pyrénées-Atlantiques, Urdax et Zugarramurdi en Navarre).
À l'échelle des États et des régions, les parcs nationaux s'affirment aussi comme des lieux de coopération : en 1997, l'U.N.E.S.C.O. a inscrit sur la liste du patrimoine mondial plus de 30 000 hectares de part et d'autre du cirque de Gavarnie et du mont Perdu, correspondant au parc national d'Ordesa, en Aragon, créé en 1918, et à une partie du parc national des Pyrénées.
Héritages et nouvelles dynamiques
Les héritages démographiques
De nombreuses vallées pyrénéennes de l'Aragon, de la Navarre ou de l'Ariège ont connu à partir du xixe siècle un dépeuplement qui les marque encore. Dans le Haut-Couserans (Ariège), des bourgs comme Bethmale ou Le Port, qui comptaient, au recensement de 1876, entre 1 500 et 2 500 habitants, ont vu leur population divisée par dix ou par vingt. La population des montagnes du Pays basque français (Basse-Navarre et Soule) est passée de 23 700 habitants en 1936 à 15 100 en 1999 (cantons de Tardets, Saint-Étienne-de-Baïgorry et Saint-Jean-Pied-de-Port). De même, les arrondissements de Saint-Girons (Ariège) et de Limoux (Aude) continuent à perdre de la population. Seuls quelques secteurs plus touristiques enregistrent une reprise démographique (vallée du Louron, Cerdagne française et espagnole...).
L'agro-pastoralisme
La vitalité de l'activité agricole est très variable selon les secteurs de la chaîne. Aux régions très dépeuplées de la Haute-Ariège, largement couvertes de forêts, s'opposent des régions rurales où les paysages restent ouverts et bien entretenus. Dans les Pyrénées-Atlantiques par exemple, les A.O.C. fromagères (Ossau-Iraty et zone de collecte du lait pour le roquefort) et viticoles (Irouléguy, Jurançon) témoignent d'une agriculture et d'un tissu rural dynamiques. L'élevage de races locales, l'entretien des chemins de transhumance en Aragon ou en Navarre, les cultures spécialisées (arbres fruitiers dans les vallées du Roussillon, piments d'Espelette...) pérennisent aussi les spécificités de l'agriculture pyrénéenne. De même, du côté méditerranéen, les vignobles de Collioure descendent les pentes des Albères jusqu'à la mer.
Le tourisme
Historiquement, c'est avec le thermalisme à Cauterets, aux Eaux-Chaudes ou à Panticosa que commença la fréquentation touristique des Pyrénées. Côté français, c'est pour relier entre elles les stations thermales que fut construite sous le second Empire la route des grands cols (Marie Blanque, Aubisque, Tourmalet, Aspin, Peyresourde) auxquels les courses cyclistes allaient donner une grande notoriété. Les pèlerinages de Lourdes renforcent la fréquentation de la partie occidentale des Pyrénées françaises, de Gavarnie à la côte basque. Enfin, tout au long de la chaîne et sur les deux versants s'égrènent de nombreuses stations de sports d'hiver (Gourette, Saint-Lary-Soulan, Envalira...), autour desquelles s'organisent des bassins d'activité de plus en plus tournés vers le tourisme (Andorre, Val d'Aran, vallées des Hautes-Pyrénées) mais souvent isolés les uns des autres.
De nombreux traits de la géographie actuelle des Pyrénées s'expliquent donc par la trajectoire historique singulière de cette chaîne : la frontière gelée depuis le xviie siècle, la position de lointaine périphérie et parfois d'angle mort à l'échelle de la France et de l'Espagne ont laissé aux sociétés locales une grande latitude d'auto-organisation qui se retrouve aujourd'hui encore dans la culture des particularismes valléens et régionaux.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Christophe GAUCHON : maître de conférences en géographie
- Raymond MIROUSE : professeur à l'université Paul-Sabatier, Toulouse
- Georges VIERS : professeur honoraire des Universités, université de Toulouse-Le Mirail
Classification
Médias
Autres références
-
ANDORRE
- Écrit par Encyclopædia Universalis , Pierre RATON et Philippe WOLFF
- 2 154 mots
- 2 médias
La principauté d'Andorre, située sur le versant méditerranéen de la partie orientale de la chaîne des Pyrénées, s'étend sur 468 kilomètres carrés. Limitée au nord par les départements français de l'Ariège et des Pyrénées-Orientales et au sud par la province catalane de Lérida, l'Andorre...
-
ARAGON
- Écrit par Roland COURTOT , Marcel DURLIAT et Philippe WOLFF
- 8 656 mots
- 6 médias
...et de Teruel, l'Aragon (1 250 000 habitants en 2004) est caractérisé par une personnalité historique incontestable et de fortes contraintes naturelles. Les Pyrénées aragonaises (Pyrénées centrales ou hautes en France), du pic d'Anie (ouest) au massif de la Maladetta (est), sont composées de la couverture... -
BASQUE PAYS
- Écrit par Roland COURTOT
- 1 024 mots
- 2 médias
Traversé par une frontière politique et orographique, le Pays basque possède une forte unité ethnique, culturelle et linguistique, qui compense l'hétérogénéité du milieu physique. Sans jamais avoir formé un ensemble politique, les provinces basques espagnoles (Vizcaya ou Biscaye,...
-
BRASSEMPOUY, archéologie
- Écrit par Dominique HENRY-GAMBIER
- 334 mots
Le village de Brassempouy en Chalosse appartient à une région de l'avant-pays pyrénéen, limitée au nord par l'Adour et au sud par le Gave de Pau. Le gisement étudié est situé à 2 kilomètres.
La grotte du Pape, découverte en 1880 et fouillée par Pierre-Eudoxe Dubalen puis par...
- Afficher les 28 références
Voir aussi
- EUROPE, géographie et géologie
- GLACIATIONS QUATERNAIRES
- ANTÉCAMBRIEN ou PRÉCAMBRIEN
- PARC NATUREL
- COMMUNICATION VOIES DE
- DÉPEUPLEMENT
- THERMALISME
- MÉTAMORPHISME
- MODÈLE, géologie et géophysique
- VARISQUE OROGENÈSE
- ESPAGNE, géographie
- FRANCE, géographie physique
- FRANCE, géologie
- FRANCE, géographie humaine et économique
- RÉSEAU URBAIN
- CHAÎNES DE MONTAGNES