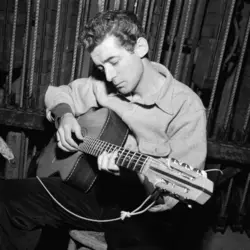- 1. Écrire québécois
- 2. L'écrivain et la langue
- 3. Une poésie de résistance
- 4. Privilège de l'oralité
- 5. Naissance d'un théâtre
- 6. Vitalité du roman
- 7. Une littérature en fusion
- 8. Le roman : des écritures migrantes à la question des territoires
- 9. Le théâtre, en quête de nouvelles origines
- 10. La poésie, éternellement à réinventer
- 11. Bibliographie
QUÉBEC Littérature
Article modifié le
Naissance d'un théâtre
Le théâtre n'a longtemps tenu qu'une place marginale dans la vie du Canada français : divertissement mondain ou spectacle de collège. Néanmoins, plusieurs théâtres sont construits à Montréal au début du xxe siècle, où l'on joue, avec un léger décalage, les succès du Boulevard parisien.
Après la Seconde Guerre mondiale apparaît un théâtre plus spécifiquement québécois, qui trouve ses origines dans le succès populaire du théâtre radiophonique, du burlesque américain, mais aussi dans le théâtre religieux à la manière d'Henri Ghéon, que les Compagnons du Saint-Laurent, troupe fondée en 1937 par Émile Legault (1906-1983), ont introduit au Canada.
Le public fait un triomphe, en 1948, à la première pièce de Gratien Gélinas (1909-1999), Tit-Coq, qui met en scène un personnage sorti des classes populaires, s'exprimant dans une langue très directe. Bousille et les justes (1959) prolonge ce succès. Cependant, les auteurs qui écrivent pour le théâtre dans les années 1950 (Yves Thériault, André Langevin, Anne Hébert, Pierre Perrault...) restent prioritairement poètes ou romanciers et se soucient peu de la dramaturgie : c'est de la « mise en ondes » radiophonique de leurs textes, très littéraires, qu'ils attendent une véritable audience.
À partir de 1955, le théâtre est l'objet d'une attention particulière de la part des autorités politiques et administratives. On finance la construction de salles de spectacles modernes, on aide à la formation des dramaturges et des comédiens. C'est sans doute ce qui facilite l'éclosion, dans les années 1960, d'un théâtre davantage enraciné dans la réalité québécoise. Marcel Dubé (1930-2016) connaît le succès en mettant sur la scène les petits délinquants de la grande ville (Zone, 1955), les drames familiaux et sociaux des soldats démobilisés (Un simple soldat, 1958), les insatisfactions des employées de bureau et de la petite bourgeoisie urbaine (Le Temps des lilas, 1958 ; Au retour des oies blanches, 1969, etc.). Pourtant, sa dramaturgie demeure tributaire de la représentation classique et du drame bourgeois.
En 1965, Michel Tremblay se voit refuser sa pièce Les Belles-Sœurs par le comité de lecture du festival d'art dramatique canadien. Manifestement, le joual qu'il fait parler à ses personnages est la cause de cette éviction. C'est en 1968 seulement que la pièce peut être présentée au public. Elle rencontre alors un succès éclatant et devient le symbole du théâtre de rupture qui triomphe sur les scènes québécoises. Les Belles-Sœurs, dont l'action réunit quinze femmes des milieux populaires montréalais, rassemblées dans la cuisine de l'une d'elles pour coller les timbres-primes d'un concours publicitaire, donne au joual une étonnante vigueur dramatique, tout en dénonçant l'aliénation tranquille de la famille québécoise.
L'usage du joual perturbe en profondeur les habitudes de la dramaturgie traditionnelle. De jeunes auteurs s'engouffrent dans la voie ouverte par Michel Tremblay, comme Michel Garneau (1939-2021), avec Quatre à quatre (1974), Marie Laberge, qui propose C'était avant la guerre à l'Anse-à-Gilles (1981) et L'Homme gris (1986), ou Antonine Maillet (1929-2025), dont La Sagouine (1971), femme de pêcheur et femme de ménage, prête son invention langagière à la voix étouffée de sa communauté. La dramaturge Françoise Loranger (1913-1995), qui avait commencé par un théâtre essentiellement psychologique, s'oriente vers une forme dramatique qui demande l'intervention directe des spectateurs dans le spectacle (Double Jeu, 1969). La remise en question générale s'en prend aussi aux chefs-d'œuvre du répertoire, avec Le Cid maghané (1968) de Réjean Ducharme (1941-2017) ou Hamlet, prince du Québec (1968) de Robert Gurik.
L'exaltation des années 1970 est sans doute progressivement retombée. On est revenu à des formes où le joual tient une place moins prépondérante. Les effets de scandale se font moins sentir. Né en 1942, Michel Tremblay s'est imposé comme le dramaturge majeur – c'est en tout cas le plus joué et le plus connu en dehors du Québec –, et son œuvre dramatique, peuplée de marginaux et de travestis, renvoie une image très forte des contraintes morales, religieuses, familiales qui pèsent sur la société québécoise (La Duchesse de Langeais, 1970 ; À toi, pour toujours, ta Marie-Lou, 1971 ; Hosanna, 1973 ; Sainte Carmen de la Main, 1976, etc.). Chez Tremblay comme chez la plupart des dramaturges québécois s'affirme la préférence donnée à la forme du monologue, peut-être mieux à même de signifier la force des parlures, le jeu des langues en conflit, l'expressivité du joual.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean-Louis JOUBERT : professeur à l'université de Paris-XIII
- Antony SORON : maître de conférences, habilité à diriger des recherches, formateur agrégé de lettres à l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, Sorbonne université
- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis
Classification
Médias
Voir aussi
- BORDUAS PAUL-ÉMILE (1905-1960)
- VADEBONCOEUR PIERRE (1920-2010)
- GIGUÈRE ROLAND (1929- )
- CHAMBERLAND PAUL (1939- )
- BRAULT JACQUES (1933- )
- GAUVREAU CLAUDE (1925-1971)
- DUBÉ MARCEL (1930-2016)
- POTVIN DAMASE (1879-1964)
- BESSETTE GÉRARD (1920-2005)
- FERRON JACQUES (1921-1985)
- THÉRIAULT YVES (1915-1983)
- LINGUISTIQUE QUESTION
- THÉÂTRE POPULAIRE
- DRAMATURGIE
- NELLIGAN ÉMILE (1879-1941)
- ROY GABRIELLE (1909-1983)
- LEMELIN ROGER (1919-1992)
- CANADIEN THÉÂTRE
- ORALE LITTÉRATURE
- THÉÂTRE POLITIQUE
- GRÈVE GÉNÉRALE
- QUÉBEC, littérature et théâtre
- MAILLET ANTONINE (1929-2025)
- GÉLINAS GRATIEN (1909-1999)
- CANADIENNE DE LANGUE FRANÇAISE LITTÉRATURE
- AQUIN HUBERT (1929-1977)
- GODBOUT JACQUES (1933- )
- JOUAL, langue
- PLAMONDON ÉRIC (1969- )
- LEFEBVRE ANNICK (1980- )
- ARCHAMBAULT FRANÇOIS (1968- )
- FILTEAU-CHIBA GABRIELLE (1987- )
- GUAY-POLIQUIN CHRISTIAN (1982- )