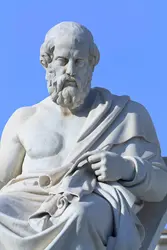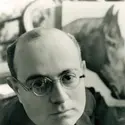RAISON
Article modifié le
La raison constructive et ses critiques
Raison et antiraison, souvent raisonnante, entrent ainsi en conflit. Foisonnement des sectes, affaiblissement, sinon du dogme, du moins de son rôle, concentration sur un domaine qui est considéré comme propre à la religion, tout cela exprime un antirationalisme tantôt inconscient ou larvé, tantôt hautement proclamé. De l'autre côté, s'affirme le pouvoir de la raison, mais d'une raison qui, comme la religion, a son domaine à elle, dont elle ne sort que pour s'égarer. C'est à cette situation que la grande métaphysique des xvie et xviie siècles veut répondre.
Le discours métaphysique
Elle le fait, à partir de Descartes, en essayant de déterminer les limites à l'intérieur desquelles elle peut être sûre d'elle-même et de ses résultats. Elle peut douter, elle doit le faire si elle veut s'assurer des fondements sur lesquels elle se propose de bâtir. Ce qu'elle découvre alors comme fondement, c'est la raison même : le doute raisonnable implique déjà la raison. À partir de là, tout devient possible. La raison se découvre finie, mais aussi capable de penser l'infini : preuve de l'existence d'un infini qui l'éclaire. Elle remarque sa différence fondamentale avec tout ce qui est matériel, donnée des sens : preuve qu'elle est une substance à part, indépendante en son essence du périssement qui caractérise tout ce qui est étendue. Elle sait qu'un être infini ne peut pas être menteur : les décrets divins, à découvrir dans la création, donnent solidité et consistance aux principes de la science. Les contenus du christianisme en tant que religion historique ne sont ni critiqués ni affirmés (Descartes se contente de la religion de sa nourrice), mais les principes absolus (ce que certains appelleront la religion naturelle, celle qui peut être développée par la raison humaine sans l'aide de la Révélation et qui sera naturelle parce qu'elle est, en droit, acceptable pour tout homme) peuvent être atteints par la pensée rationnelle, à tel point qu'un schéma du monde tel qu'il est en lui-même, c'est-à-dire dans l'esprit divin, peut être tracé.
Ce qui donne à la raison tant de confiance en elle-même c'est la série ininterrompue des succès que, en tant que calculatrice, elle remporte en physique et en cosmologie. Le monde naturel n'est pas seulement rationnel en soi en tant qu'œuvre d'une sagesse absolue ; sa rationalité peut être montrée et démontrée dans tous les détails, et, si certains domaines restent encore obscurs, ils ne sauraient résister à l'effort de la recherche, devenue consciente de sa méthode et se sachant en progrès constant. Peu importe ici (pour important que cela soit dans d'autres perspectives) que les successeurs de Descartes se séparent de lui, en particulier en soulevant le problème du rapport entre substance pensante et substance étendue, qu'un retour à la philosophie antique conduise Spinoza à affirmer l'identité de la raison cosmique et de la raison en l'homme (éliminant ainsi tout Dieu personnel en faveur d'une piété « cosmique »), que Leibniz veuille préserver à la fois l'unité entre monde de la physique et monde de la pensée tout en sauvegardant la conscience individualisée, que Malebranche et, à sa suite, Berkeley veuillent libérer la philosophie de tout matérialisme substantialiste : ce qui est commun à tous, c'est la confiance inébranlable en la force de la raison, suffisante pour découvrir le fond des choses dans un discours cohérent, puisque guidée par l'idéal d'une méthode qui, après avoir analysé, saura à présent construire un système qui soit en même temps système du discours mettant à nu le système du monde, fondement et canevas de toutes les connaissances.
Or la science moderne se distingue par le caractère vérifiable de ses thèses. Des systèmes du monde et des discours cohérents avaient existé depuis longtemps, depuis toujours. Ce qui est nouveau, c'est qu'on exige de toute affirmation qu'elle soit vérifiée par expérience, dans une expérience arrangée (expérimentation) ou par la simple observation. Le discours métaphysique, inspiré de celui de la physique, doit donc être vérifiable – et il ne l'est pas, pour la simple raison que ce qu'il contient n'appartient pas au domaine de l'expérience, ne peut même pas y appartenir : l'âme immortelle, Dieu, le Tout du monde ne se constatent pas. Aussi n'est-il pas surprenant que les discours des uns et des autres se contredisent, et de la façon la plus inquiétante en ce qu'il ne s'agit pas de l'opposition entre une affirmation et une négation qui se correspondraient, mais d'une non-coïncidence qui ne laisse rien à trancher, vu que chaque discours est cohérent en lui-même (du moins idéalement) et diffère simplement de l'autre, un peu comme une couleur diffère d'un son sans le réfuter ni être réfutée par lui.
Sensualisme et scepticisme
Il en résulte ce qui se présente tantôt comme sensualisme, tantôt comme scepticisme, deux désignations également dangereuses, puisque les deux mouvements sont loin de vouloir écarter la raison calculatrice ou la science moderne (Locke est l'ami de Newton) et de douter de la possibilité de raisonner efficacement sur les données immédiates de l'expérience (Hume). Ce qui les distingue du rationalisme, c'est qu'ici la raison cesse d'être toute-puissante, même en son principe : il n'y a de connaissable pour nous que ce monde des sens, il n'existe aucun au-delà de pensée « pure » ; nous nous orientons très bien, et très raisonnablement, dans notre vie aussi longtemps que nous n'oublions pas que cette vie est une vie active, agissante, produisant des biens, demandant une organisation de l'État et de la société qui permette la collaboration de tous en vue de buts terrestres qui, une fois qu'on ose l'avouer, se montrent être ceux de tous. Ce que nous faisons, nous pouvons aussi le comprendre (Vico et, avant lui, Bayle en tirent la conséquence en plaçant au premier plan l'histoire, science vraiment humaine puisque science des actions humaines) ; nous nous perdons dès que nous prétendons à une connaissance des choses telles qu'elles sont en elles-mêmes, c'est-à-dire telles qu'elles sont (ou seraient) en dehors de toute connaissance humaine. Non qu'on nie nécessairement l'existence d'un Dieu personnel, d'un au-delà, de l'immortalité de l'âme (on ne le fait qu'exceptionnellement) ou qu'on engage la lutte contre la religion naturelle (il en est autrement, par exemple, pour Voltaire et Rousseau, en ce qui concerne les dogmes révélés et les Églises constituées en organismes de droit public) ; on reconnaît même volontiers la valeur morale et éducative de la religion, et les matérialistes, comme Helvétius, sont rares. Mais toute thèse positive, historique, qui ne découle pas du pur concept de la religion est regardée comme en dehors de la discussion raisonnable, pure et simple expression d'un sentiment personnel ou, dans le pire des cas, invention intéressée. On est sensualiste et sceptique sur tous les points où il est impossible d'instituer une discussion raisonnable qui puisse aboutir à l'aide de la cohérence formelle, certes, mais aussi et surtout par renvoi à une expérience méthodiquement conduite. On l'est parce que l'on est raisonnable et que, raisonnable, on veut protéger l'humanité des guerres de religion, des persécutions, des souffrances provoquées par des discussions sans objet assignable. Hobbes, Spinoza, Locke, Bayle, Voltaire, et tant d'autres sont d'accord sur ce point : aucune autorité, religieuse ou non, ne saurait invoquer la simple tradition ou des lumières particulières devant le tribunal de la raison souveraine.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Éric WEIL : professeur à l'université de Nice
Classification
Média
Autres références
-
RAISON (notions de base)
- Écrit par Philippe GRANAROLO
- 2 949 mots
Les historiens de la philosophie sont très nombreux à avoir décrit la mutation intellectuelle qui s’est produite sur le sol de la Grèce antique comme un combat du « logos » contre le « muthos », autrement dit (en se souvenant que le mot grec logospossède de multiples significations)...
-
ADORNO THEODOR WIESENGRUND (1903-1969)
- Écrit par Miguel ABENSOUR
- 7 899 mots
- 1 média
...l'inadéquation entre les questions philosophiques et la possibilité de leurs réponses qui provient de la non-correspondance entre l'esprit et le réel. La fameuse formule hégélienne, « le réel est le rationnel » et inversement, n'est plus de saison. Car la clé de la raison n'est plus susceptible d'ouvrir... -
AFFECTIVITÉ
- Écrit par Marc RICHIR
- 12 231 mots
...passion elle est supprimée. » Cette distinction fait écho à celle de l'anthropologie. Ce qui les distingue est leur rapport au temps, leur rapport à la raison et par là au sentiment du sublime – auquel correspond un affect du sublime. Alors que l'affect est fugace comme le temps qui s'écoule, et que... -
ALAIN ÉMILE CHARTIER, dit (1868-1951)
- Écrit par Robert BOURGNE
- 4 560 mots
...Hegel dans son enseignement –, une « restauration » de l'entendement. Si l'entendement séparé impose au savoir de s'autolimiter à l'univers du fini, la raison est, dans l'entendement même, négation de la finitude, mais cette négation ne s'arrache pas elle-même à la finitude. Il n'y aura pas d'autre... -
ANCIENS ET MODERNES
- Écrit par Milovan STANIC et François TRÉMOLIÈRES
- 5 025 mots
- 4 médias
...mouvement des sciences : Malebranche prendra grand soin de la distinguer de la philosophie, pour laquelle il n'y a pas d'autre autorité que la raison. Pouvait-on cependant reconnaître cette dernière sans admettre la pérennité de la vérité – et déplacer alors les prétentions de la théologie... - Afficher les 86 références
Voir aussi