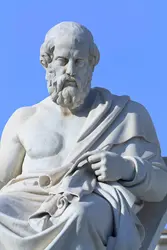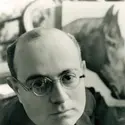RAISON
Article modifié le
La raison transcendantale
Cette raison s'abstient donc, elle se déclare sceptique, dès qu'il est question de ce qui est au-delà du sensible, du donné. Or la saisie pensante du donné n'est pas donnée elle-même, elle est élaborée. Cela est vrai de la science même, qui parle réellement de la nature, mais à l'aide de la mathématique qui est une création de l'esprit humain. Cela est vrai, et plus visible, quand on regarde des concepts comme ceux de substance, de cause, de réalité, qui, loin d'être tirés des données sensibles, en rendent seulement possible la structuration. Bien plus, et en un sens bien plus important, cela est vrai dans un domaine qui nous concerne au plus profond de notre existence : nous ne pouvons nous empêcher de chercher un sens à notre vie et au monde dans lequel nous vivons – et ce sens des faits n'est pas un de ces faits : nous sommes bien obligés de nous orienter, de prendre des décisions en cherchant, consciemment ou non, non une des règles qu'offrent les différentes traditions existant empiriquement, mais une règle qui soit la même pour tous, afin qu'une morale raisonnable, c'est-à-dire universelle, puisse nous guider vers un bonheur qui ne dépende pas des accidents de ce monde et que nous soyons en droit d'espéré en proportion avec notre effort moral, dans un monde situé au-delà de celui de l'expérience sensible.
Kant et l'universalité de la raison
On a dit avec juste raison que tous les motifs de l'histoire de la pensée philosophique se rejoignent dans la pensée de Kant, qui est déterminée par cette tension-unité du sensible et du suprasensible. En effet, non satisfait de l'empirisme sensualiste et sceptique, Kant en maintient toutes les affirmations, rejetant seulement ses négations. Il est convaincu que la métaphysique traditionnelle, celle des xvie et xviie siècles, est intenable, que c'est elle-même qui pousse au scepticisme, et il soutient en même temps qu'aucune pensée humaine qui veut se comprendre ne peut renoncer à la recherche d'un inconditionné, d'un absolu, d'un fondement inaccessible au discours discursif, à la science du sensible, et pourtant plus réel que tout ce qui est donné à nos sens et à une pensée qui ne fait qu'organiser ce donné. L'homme est un être qui agit dans le monde, qui s'organise dans des sociétés et des États, parce qu'il a des intérêts concrets, parce qu'il est intéressé ; et ce même être aspire à une justice qui soit vraiment divine, divine déjà sur terre en ce qu'elle reconnaisse la valeur absolue de tout individu, divine dans un au-delà qui apporte la récompense à celui qui, au mépris de ses intérêts, de ses penchants, de cette nature sensible dont il ne se défera jamais, a cherché cette justice dans cette vie. Science, morale, religion, politique, cosmologie, tout doit être pensé par la raison dans un système qui ne néglige aucune des expressions qu'ont trouvées les aspirations les plus profondes des hommes.
Si l'humanité ne s'est pas comprise jusqu'ici, si elle ne s'est pas entendue avec elle-même, c'est qu'elle avait employé un concept doublement ambigu de la raison. Sans doute, la raison est une ; mais elle l'est sous des aspects différents. Elle pense le monde, elle vise l'action. Théorique, elle est discursive et est installée, sous le nom d'entendement, dans le fini des connaissances scientifiques, toujours particulières et partielles ; elle serait vide si elle ne recevait pas des sens une matière qu'organisent ses concepts en objets de connaissance, mais qu'ils ne créent pas : son activité, en soi pure spontanéité, ne devient effective que sur fond de passivité. Il n'en est pas de même quand elle ne cherche plus les déterminations des objets particuliers à l'intérieur du monde, mais se met à penser ce monde même, la Totalité-Unité (qu'elle doit viser si elle veut établir ordre et cohérence parmi les résultats de l'entendement) ; elle est alors raison au sens fort, mais elle n'a plus d'accès direct au sensible ; elle doit s'appuyer sur l'entendement, comme celui-ci s'appuyait sur la sensibilité, pour parvenir à cette unité en elle-même, d'un côté, à celle de son objet, de l'autre, unité sans laquelle aucune science ne serait vraiment fondée. Pratique, elle a affaire, non à ce qui est, mais à ce qui doit être, à un sens du monde et de la vie humaine et aux conditions morales de la réalisation de ce sens dans une nature qui, pur fait, n'en a pas en elle-même et ne peut en recevoir que par rapport à un bien absolu que seule la raison pratique est à même de penser, dont elle est la pensée. Si la métaphysique s'est effondrée dans le scepticisme, c'est qu'elle avait prétendu à une connaissance de type scientifique – seule possible là où il y a observation et expérience et, partant, passivité – dans un domaine où la tâche est de penser, par sa pure spontanéité, la totalité qui est parfaitement concevable par concepts purs, mais ne peut pas être donnée comme fait parmi les faits, comme un de ces faits dont elle vise l'unité jamais atteinte ; confondant l'aspect théorique avec l'aspect pratique de la raison une, la métaphysique avait voulu fonder la morale, la religion, le sens de la nature et de la vie sur un fait, celui de l'existence d'un Dieu cosmique, d'un grand architecte, d'un être plus grand, plus puissant que les autres, mais de leur nature : aucun chemin ne mène cependant d'un fait à un sens ; et c'est le sens (ou, selon un terme à la mode, la valeur) qui fait qu'il y ait des faits, puisque ne peut être considéré comme fait que ce qui possède un sens, pour théorique que celui-ci puisse apparaître.
Autonomie et limites de la raison
Partout, il s'agit d'universalité, en science autant qu'en morale ; mais elle n'est pas partout de même rang. Il s'agit toujours d'autonomie de la raison, mais d'une autonomie qui n'est pas toujours de même étendue. Pris en lui-même, le discours de la science est universel et postule l'adhésion de tous ceux qui y prennent part ; mais il ne l'est qu'à cette condition : une autre universalité infiniment plus profonde existe, celle du discours qui porte sur le bien et le mal, sur le sens et la fin de l'existence humaine, qui dit pour tout être humain comment il doit se décider s'il veut être raisonnable, s'il ne veut pas vivre sous la poussée des instincts et des passions de l'animal, discours qui est à la fois fondement et aboutissement de la première universalité, née du travail d'esprits humains, mais qui ignore la question essentielle qui constitue l'humanité de l'homme, celle du sens de toute entreprise. Partout, la raison est autonome : qui prescrirait, comme du dehors, des règles raisonnables à la raison ? Si la faculté telle qu'elle existe empiriquement, psychologiquement, historiquement dans l'être fini qu'est l'homme se fourvoie et a besoin d'une critique, seule la raison qui peut la formuler : elle ne fait rien d'autre quand elle limite les prétentions de l'entendement discursif et calculateur, quand elle s'oppose à sa tentative de transformer en objet ce qui ne peut jamais être observé, mesuré, situé dans l'espace et le temps, mais se révèle à une pensée qui veut découvrir, par une analyse régressive, les conditions de tout discours cohérent, les concepts qui le constituent, les principes qui lui permettent, d'une part, de connaître la réalité sensible et, de l'autre, de penser le sens qui doit être, le devoir, et les conditions sous lesquelles l'homme peut espérer atteindre un bonheur auquel, être indigent, il aspire naturellement, qu'aucune science ne peut lui promettre, que la morale ne vise pas, mais que cette même morale, s'il s'en rend digne, l'autorise à espérer dans un au-delà de toute connaissance possible, en une espérance qui n'est ni en contradiction ni en accord avec une connaissance théorique incapable de se prononcer en dehors de son domaine.
Ainsi, la raison autonome n'est pas toute-puissante. Comme entendement, elle fournit les concepts (catégories) et les principes fondamentaux de toute science naturelle possible, mais elle est incapable de construire concrètement cette science, ayant besoin de données matérielles, sensibles qui lui viennent du dehors ; raison pratique, elle constitue toute morale qui ne soit pas arbitraire, c'est-à-dire la morale tout court quant à son fondement ; et elle peut le faire parce que la loi qu'elle prescrit, elle se la donne à elle-même et est ainsi libre dans l'universalité de sa règle absolue ; mais elle ne saurait pas particulariser ces règles si elle n'apprenait pas d'ailleurs, de l'expérience commune de l'humanité, comment est constitué l'être en lequel cette raison réside et qui doit seulement se faire raisonnable et moral, qui ne l'est pas puisqu'il est aussi être de besoins et de désirs : elle purifie les maximes selon lesquelles nous agissons, elle ne les invente pas, elle les trouve. Elle ne pense pas seulement une totalité en même temps cosmique et sensée, elle peut même montrer que cette pensée est justifiée par les intérêts de la raison, par le fait qu'il n'y a possibilité de cohérence qu'à cette condition ; mais elle ne pense les structures sensées que comme des quasi-faits, dans le mode du « comme si », comme si un Dieu moral était le créateur de cette unité de réalité et de sens, comme si une finalité intérieure expliquait la particularité de l'organisme vivant et de la nature entière regardée comme si elle formait un organisme comme si la beauté de certains objets naturels était une sorte de faveur faite aux facultés humaines pour préparer l'humanité par une joie désintéressée à l'attitude désintéressée qui fait l'universalité de la morale. Ce n'est pas que ce « comme si » dévalue ce qu'il révèle ; au contraire, il le garantit de tout scepticisme ; mais pour cette raison même, il est aussi nécessaire de l'introduire afin d'empêcher le retour de la chosification scientiste, qui transforme en affirmation pseudo-scientifique ce qui se justifie seulement dans la pensée du Tout : ce qui rend possible toute compréhension cohérente du donné n'est pas et ne peut pas être de l'ordre du donné.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Éric WEIL : professeur à l'université de Nice
Classification
Média
Autres références
-
RAISON (notions de base)
- Écrit par Philippe GRANAROLO
- 2 949 mots
Les historiens de la philosophie sont très nombreux à avoir décrit la mutation intellectuelle qui s’est produite sur le sol de la Grèce antique comme un combat du « logos » contre le « muthos », autrement dit (en se souvenant que le mot grec logospossède de multiples significations)...
-
ADORNO THEODOR WIESENGRUND (1903-1969)
- Écrit par Miguel ABENSOUR
- 7 899 mots
- 1 média
...l'inadéquation entre les questions philosophiques et la possibilité de leurs réponses qui provient de la non-correspondance entre l'esprit et le réel. La fameuse formule hégélienne, « le réel est le rationnel » et inversement, n'est plus de saison. Car la clé de la raison n'est plus susceptible d'ouvrir... -
AFFECTIVITÉ
- Écrit par Marc RICHIR
- 12 231 mots
...passion elle est supprimée. » Cette distinction fait écho à celle de l'anthropologie. Ce qui les distingue est leur rapport au temps, leur rapport à la raison et par là au sentiment du sublime – auquel correspond un affect du sublime. Alors que l'affect est fugace comme le temps qui s'écoule, et que... -
ALAIN ÉMILE CHARTIER, dit (1868-1951)
- Écrit par Robert BOURGNE
- 4 560 mots
...Hegel dans son enseignement –, une « restauration » de l'entendement. Si l'entendement séparé impose au savoir de s'autolimiter à l'univers du fini, la raison est, dans l'entendement même, négation de la finitude, mais cette négation ne s'arrache pas elle-même à la finitude. Il n'y aura pas d'autre... -
ANCIENS ET MODERNES
- Écrit par Milovan STANIC et François TRÉMOLIÈRES
- 5 025 mots
- 4 médias
...mouvement des sciences : Malebranche prendra grand soin de la distinguer de la philosophie, pour laquelle il n'y a pas d'autre autorité que la raison. Pouvait-on cependant reconnaître cette dernière sans admettre la pérennité de la vérité – et déplacer alors les prétentions de la théologie... - Afficher les 86 références
Voir aussi