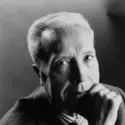RÉCEPTION, art et littérature
Article modifié le
Littérature
Les études sur la réception s'intéressent au rôle structurant, dans l'œuvre, du destinataire. Qu'il soit lecteur ou spectateur, celui-ci permet d'actualiser ce qui, sans lui, ne pourrait exister qu'à l'état latent. Seule la réception permet à l'œuvre de s'inscrire dans l'histoire. Qu'il la rejette, l'oublie, la réhabilite ou l'encense, le destinataire détermine donc sa postérité.
Mais il détermine également le sens même de l'œuvre, dans la mesure où il peut être celui qui reçoit et actualise un roman ou une pièce de théâtre, et parfois celui qui produit. Car tout auteur est avant tout un lecteur, et chaque œuvre peut être considérée comme une réponse à une œuvre antérieure. C'est le sens, notamment, de la répartition canonique en « genres littéraires ». Le genre suppose en effet l'inscription de l'auteur dans une lignée qui le précède, dont il peut respecter les règles ou s'écarter. La trame, les thèmes, le style d'un roman s'inscrivent nécessairement dans une histoire littéraire, où les œuvres conversent. Le roman Ulysse (1922) de James Joyce fait ainsi écho à L'Odyssée d'Homère (viiie siècle av. J.-C.). De façon générale, l'existence de parodies, d'imitations, de transpositions d'œuvres d'un genre à un autre témoignent de ce que l'auteur est d'abord un lecteur. Gérard Genette parle à propos de ces œuvres dérivées d'œuvres antérieures, d'une « littérature au second degré, qui s'écrit en lisant » (Palimpsestes, 1982). De façon plus générale, toute littérature dérive d'une littérature antérieure. La tragédieMédée (1635) de Pierre Corneille répond à celles du Grec Euripide et du Romain Sénèque. L'actualisation de l'œuvre se réalise donc à travers sa réception, que celle-ci produise une autre œuvre ou qu'elle reste singulière. Mais comment, dans ce dernier cas, décrire l'action solitaire du lecteur de roman ?
D'abord, il arrive que la figure du lecteur soit explicitement inscrite dans l'œuvre. L'auteur peut ainsi lui suggérer d'adopter une posture de réception, s'adresser à lui. Paul Scarron, dans Le Roman comique (1651-1657), use de ce procédé pour inciter le lecteur à la patience, ou pour s'excuser ironiquement de quelque maladresse. Au théâtre, il arrive également qu'un personnage s'adresse en aparté au public. Cette pratique est fréquente dans les prologues de comédies. On la retrouve par exemple dans Amphitryon ou La Marmite de Plaute (254-184 av. J.-C.). Le théâtre en général rend d'ailleurs plus aisée la détermination de l'attitude du destinataire. Par ses rires, ses applaudissements ou ses huées, le public se manifeste ici directement.
Pour prendre en compte l'effet de l'art sur son destinataire, au-delà de ces manifestations explicites, Hans Robert Jauss propose d'élaborer une « esthétique de la réception ». « [Par] tout un jeu d'annonces, de signaux – manifestes ou latents – de références implicites, de caractéristiques déjà familières, [le] public est prédisposé à un certain mode de réception » (Pour une esthétique de la réception). Il existerait ainsi un « horizon d'attente » du destinataire, que le contexte social, politique, historique et littéraire permettrait de déterminer. Car la réception se modifie au cours du temps. Ainsi la Justice poursuivit-elle Charles Baudelaire pour Les Fleurs du mal (1857) et Gustave Flaubert pour Madame Bovary (1857), alors que ces œuvres sont aujourd'hui des classiques de l'institution scolaire et universitaire. Dans « Pierre Ménard, auteur du Quichotte » (1939), repris par la suite dans Fictions (1944), Jorge Luis Borges analyse les mécanismes de la réception. Pierre Ménard, auteur français fictif contemporain de Borges, aurait réécrit littéralement quelques chapitres du Don Quichotte (1605-1615) de Miguel de Cervantès. Toutefois, malgré leur littéralité, les deux œuvres diffèrent de beaucoup : Cervantès emploie un langage familier à son époque, tandis que Pierre Ménard se distingue par son emploi archaïque de la langue. De même, Borges soutient que celui-ci fait preuve d'une plus grande originalité dans les thèmes, car parler de combats était naturel à un ancien guerrier, alors que cela constitue pour un auteur français du xxe siècle une preuve d'imagination. À travers cette mystification, Borges souligne le rôle créateur du lecteur, qui modifie le sens du livre en l'actualisant.
Mais prendre en compte la réception, c'est bousculer le sens même du texte littéraire. Selon Michel Charles, la lecture se présente en effet comme un processus erratique, qui fonctionne par oublis, par retours, par rectifications. Chaque texte se présente alors comme une « configuration instable » (Introduction à l'étude des textes, 1995), où le lecteur peut, à chaque phrase, imaginer un certain nombre de textes possibles en fonction des éléments du texte, éléments qui s'avéreront principaux ou secondaires dans la suite de la lecture. À côté de l'intrigue principale, une théorie de la réception met ainsi en lumière l'existence de « textes fantômes ». Si l'on postule que le lecteur, par opposition au chercheur « professionnel », n'a pas encore lu l'œuvre dans son entier, alors le commentateur doit retrouver cette démarche ouverte, où chaque mot renvoie à d'autres mots possibles. Commencer un roman par une phrase telle que « la marquise sortit à cinq heures » semblait à Paul Valéry d'un arbitraire insupportable, tout comme à André Breton qui reprend la phrase dans le Manifeste du surréalisme. Ce sentiment d'arbitraire naît précisément de tous les possibles que l'auteur a supprimés pour écrire sa phrase, son récit, mais dont, pour M. Charles, la lecture garde une trace. Ainsi le destinataire imagine-t-il toujours, virtuellement, d'autres textes possibles qui jalonnent sa lecture.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Elsa MARPEAU : ancienne élève de l'École normale supérieure, agrégée de lettres modernes, docteure en lettres modernes et en arts du spectacle
- François-René MARTIN : ancien pensionnaire à l'Institut national d'histoire de l'art, chargé de cours à l'École du Louvre
Classification
Autres références
-
CRÉATION LITTÉRAIRE
- Écrit par Gilbert DURAND
- 11 579 mots
- 3 médias
...collective (au sens non jungien du terme) d'une époque, d'un milieu social qu'elle informe. Cette créativité sociale peut être formulée par une théorie de la réception (Rezeptionstheorie), selon laquelle c'est bien l'œuvre qui crée la sensibilité d'un groupe, contrairement à l'hypothèse réductrice inverse.... -
CRITIQUE LITTÉRAIRE
- Écrit par Marc CERISUELO et Antoine COMPAGNON
- 12 922 mots
- 4 médias
L'esthétique de laréception apparaît comme un compromis entre l'histoire littéraire et la philosophie herméneutique. À la question « comment faire encore de l'histoire littéraire après Heidegger ? », elle répond en mettant l'accent sur le lecteur, sur la relation du texte et du lecteur, sur le procès... -
GENRES LITTÉRAIRES
- Écrit par Jean-Marie SCHAEFFER
- 3 086 mots
- 1 média
La notion de genre littéraire a joué de tout temps un rôle important dans la description et l'explication des faits littéraires. C'est que la littérature n'est jamais simplement la somme des œuvres individuelles, mais se constitue tout autant à travers les relations que ces œuvres tissent entre elles....
-
JAUSS HANS ROBERT (1921-1997)
- Écrit par Karlheinz STIERLE
- 822 mots
Né à Göppingen, Hans Robert Jauss est avec Wolfgang Iser le fondateur d'un groupe de recherche littéraire connu sous le nom d'école de Constance. À la théorie traditionnelle de la production et de l'imitation littéraires, celle-ci oppose une théorie de la réception qui, pour la première fois,...
- Afficher les 7 références
Voir aussi