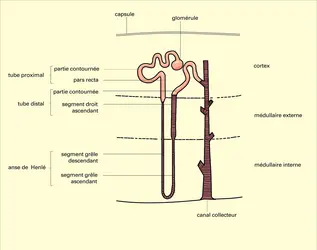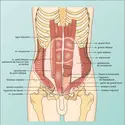REIN
Article modifié le
Traitement des maladies rénales
Le traitement des maladies rénales comporte trois catégories d'action possible : le traitement des causes de la maladie ; celui de ses conséquences ; enfin, les méthodes de remplacement des reins lorsque ceux-ci sont détruits.
Traitement des causes de l'altération rénale
Supprimer la cause de l'altération des reins est parfois possible. Il en est ainsi en cas d'infections spécifiques telles qu'une tuberculose curable par les antibiotiques, en cas de calculs urinaires que le chirurgien peut enlever et dont le médecin peut empêcher le retour si la formation des calculs a une cause que l'on peut corriger.
Dans les glomérulonéphrites, on est relativement désarmé quant au traitement de la cause, sauf dans certaines formes secondaires à une maladie générale justiciable d'un traitement spécifique : par exemple, usage des corticoïdes et des drogues dites immunosuppressives dans la néphrite du lupus érythémateux disséminé.
Traitement des conséquences de l'altération rénale
C'est le traitement antihypertenseur quand la maladie entraîne une hypertension artérielle, et c'est surtout le traitement de l'insuffisance des fonctions rénales. Ce traitement repose tout d'abord sur des précautions de régime : limitations dans l'apport d'azote, d'eau et de sodium, ajustées aux possibilités d'excrétion du rein. C'est ainsi qu'une restriction des aliments protidiques proportionnelle au degré de l'insuffisance excrétoire des reins est souvent nécessaire ; cette restriction ne peut cependant s'abaisser au-dessous d'un apport quotidien minimal de 0,6 g/kg/j, soit environ 40 g de protides par jour chez l'adulte, sous peine d'entraîner des accidents de carence azotée, y compris une aggravation possible de la maladie rénale. La ration de sel est souvent conditionnée par la tension artérielle autant et plus que par l'insuffisance rénale : l'hypertension artérielle conduit à restreindre la ration de sodium, tandis qu'en l'absence d'hypertension artérielle un régime normalement salé est souvent possible (sauf le cas particulier des situations où existent des œdèmes, tel le syndrome néphrotique).
Le syndrome néphrotique entraîne la prescription d'un régime pauvre en sel, de médicaments diurétiques, de perfusions veineuses d'albumine humaine et, surtout, chaque fois que la biopsie rénale montre des altérations dont on sait aujourd'hui qu'elles entrent dans la liste des maladies améliorables par ce traitement, des dérivés de la cortisone, parfois complétés par des médicaments immunosuppresseurs.
Traitement de remplacement des fonctions rénales
On a déjà mentionné le bouleversement que les méthodes d'épuration extrarénale ont apporté aux possibilités d'action dans l'insuffisance rénale aiguë. Mais, aujourd'hui, l'urémie chronique parvenue au stade ultime où les reins ne sont plus capables d'assurer la vie peut, elle aussi, bénéficier d'un traitement salvateur, grâce aux techniques de dialyse et à la greffe rénale.
Les techniques de dialyse utilisent soit l' hémodialyse périodique, soit la dialyse péritonéale de suppléance.
L'hémodialyse périodique, ou usage répété, deux ou trois fois par semaine, du rein artificiel, s'est développée depuis 1960, date à laquelle Scribner, de Seattle, conçut pour la première fois un dispositif ingénieux permettant d'obtenir l'accès permanent et facile aux vaisseaux sanguins, nécessaire à la réalisation pratique de ce traitement. En une dizaine d'années à peine, ce mode de remplacement de la fonction rénale absente s'est répandu dans le monde entier et des milliers de malades sont ainsi maintenus en vie et en pleine activité par des séances régulières de dialyse par le rein artificiel, dans des centres spécialisés ou même à domicile.
La technique de l'hémodialyse repose sur la mise en présence, de part et d'autre d'une membrane de dialyse (fig. 5), du sang du malade et d'une solution de composition choisie. Le sang est prélevé à l'aide de dispositifs de canulation des vaisseaux de l'avant-bras, par l'intermédiaire d'un shunt artérioveineux (fig. 6), chirurgicalement créé entre l'artère radiale et une veine de l'avant-bras. La veine se dilate sous l'afflux du sang artériel et permet des ponctions indéfiniment renouvelées à l'aide d'aiguilles de calibre approprié. Le liquide de dialyse est fabriqué par des générateurs munis de dispositifs de contrôle très précis, assurant la sécurité et l'automaticité de l'hémodialyse. Au total, la conduite du traitement exige de douze à dix-huit heures d'épuration par semaine, réparties en deux ou trois séances hebdomadaires. Il en résulte une servitude indiscutable, tenant à la longueur des horaires de dialyse, mais n'interdisant nullement, dans la pratique, le retour à une activité familiale et socio-professionnelle voisine de la normale.
De nombreux progrès sont venus améliorer les conditions de survie des malades ainsi traités. Ils tiennent, d'une part, à l'amélioration de la technologie, en particulier à l'augmentation de l'efficacité des membranes de dialyse aujourd'hui utilisées. Ils tiennent, d'autre part, aux progrès considérables qui ont été faits dans la connaissance du mécanisme de l'urémie et de ses complications, et des traitements préventifs qui peuvent être désormais opposés à nombre de ces manifestations. Il n'existe aucune limite théorique à la survie offerte par l'hémodialyse périodique. De fait, de nombreux malades sont traités depuis plus de trente ans par cette technique, et de nouveaux progrès sont espérés dans l'avenir. Tous tendent à la réduction de la durée des séances de dialyse, grâce à l'utilisation de membranes de dialyse améliorées, tout en sachant que des raisons physiologiques interdisent d'espérer abaisser cette durée au-dessous de trois heures par séance de dialyse.
La dialyse péritonéale de suppléance, qui avait été utilisée sous forme de dialyses intermittentes de très longue durée du fait de la faible efficacité des échanges à travers la séreuse péritonéale, connaît un regain de faveur sous la forme de dialyse péritonéale continue ambulatoire (D.P.C.A.), comme l'a proposée Oréopoulos à Toronto, en 1976. Cette technique, beaucoup plus simple que la précédente, consiste en l'introduction dans la cavité péritonéale, de trois à cinq fois par vingt-quatre heures, de deux litres de solution de dialyse stérile, préalablement tiédie, fournie sous forme de poches en matière plastique munies de leur tubulure. Cette technique se prête à l'utilisation par le malade lui-même à domicile.
Quant aux indications et aux résultats de la greffe rénale, on les trouvera développés à l'article transplantations d'organes.
Ces deux traitements sont complémentaires : le plus souvent, une transplantation rénale ne peut être effectuée d'emblée et le délai d'attente nécessaire sera assuré par la pratique des hémodialyses périodiques. Dans certains cas, des malades ne sont pas en mesure, pour des raisons tenant à l'état anatomique de leur vessie ou à des raisons immunologiques, de bénéficier de l'espoir d'une transplantation rénale. Enfin, la transplantation rénale est déconseillée, habituellement, chez les malades âgés de plus de cinquante ans, car leur tolérance au traitement immunosuppresseur est moins bonne que celle des sujets plus jeunes. Ces patients relèvent alors d'un traitement définitif par l'hémodialyse périodique. Il est judicieux, dans ce cas, de les orienter vers un entraînement à la dialyse à domicile, de manière à leur assurer la plus grande autonomie possible.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Paul JUNGERS : professeur de néphrologie à la faculté de médecine Necker-Enfants malades
Classification
Médias
Autres références
-
ABDOMEN
- Écrit par Claude GILLOT
- 6 350 mots
- 9 médias
Les contusions du rein ne sont pas rares après fracture des dernières côtes ; elles se manifestent par une hématurie, un hématome lombaire périrénal. Elles peuvent conduire à la néphrectomie (ablation du rein). -
ACIDO-BASIQUE ÉQUILIBRE
- Écrit par Pierre KAMOUN
- 2 958 mots
- 1 média
Le tubule rénal contribue au maintien de l'équilibre acido-basique par trois mécanismes : excrétion ou réabsorption des bicarbonates, excrétion d'acides faibles et formation de sels d'ammonium. -
ALDOSTÉRONE
- Écrit par Pierre KAMOUN
- 1 642 mots
...l'effet biologique après 3 à 5 jours d'administration d'aldostérone) est observé sur la réabsorption du sodium mais non sur l'excrétion du potassium. Elles ont lieu au niveau des canaux collecteurs des néphrons du cortex rénal. Hormone de la rétention sodée, l'aldostérone s'oppose à l'action natriurétique... -
AZOTÉMIE
- Écrit par Geneviève DI COSTANZO
- 424 mots
L'élévation dans le sang du taux de l'urée et des autres produits d'excrétion azotée est communément décrite en clinique sous le nom d'azotémie ou d'urémie. Elle représente le stade terminal de l'insuffisance rénale progressive et résulte de l'impossibilité d'excréter...
- Afficher les 39 références
Voir aussi
- NÉCROSE
- NÉPHROPATHIES
- PYÉLONÉPHRITE
- RÉNINE
- ANGIOTENSINE
- ŒDÈME
- CLEARANCE
- VASOCONSTRICTION
- VASOPRESSINE ou HORMONE ANTIDIURÉTIQUE (ADH) ou PITRESSINE
- HÉMATURIE
- ÉRYTHROPOÏÉTINE (EPO)
- URÉE
- BIOPSIE
- ANGIOGRAPHIE
- RADIOLOGIE
- URIQUE ACIDE
- MÉTABOLISME AZOTÉ
- SODIUM, biologie
- POTASSIUM, biologie
- ALBUMINURIE
- INSUFFISANCE RÉNALE
- GLOMÉRULONÉPHRITE
- DIABÈTE RÉNAL
- HÉMODIALYSE
- ANURIE
- AMMONIAC, biochimie
- PROTÉINURIE
- LEUCOCYTURIE
- NÉPHROTIQUE SYNDROME
- URÉMIE
- NÉPHRON
- NÉPHROLOGIE
- URINE
- POLYKYSTOSE RÉNALE
- TUBULONÉPHRITE AIGUË
- NÉPHROANGIOSCLÉROSE
- MICROANGIOPATHIE THROMBOTIQUE ou PURPURA THROMBOCYTOPÉNIQUE THROMBOTIQUE
- AUTO-IMMUNITAIRES MALADIES ou AUTO-IMMUNES MALADIES
- BICARBONATE
- REIN ARTIFICIEL
- CYSTOSCOPIE
- NÉPHROGRAMME ISOTOPIQUE
- UROGRAPHIE
- VITAMINES D ou CALCIFÉROLS
- ARTÉRIOGRAPHIE
- GROSSESSE
- PONCTION
- NÉPHRITE, pathologie
- CALCUL URINAIRE
- CIRCULATOIRE APPAREIL
- DIALYSE THÉRAPEUTIQUE
- ANSE DE HENLÉ
- ACIDITÉ URINAIRE TITRABLE
- DÉMINÉRALISATION, médecine
- EXPLORATION FONCTIONNELLE
- GLOMÉRULE RÉNAL
- IMMUNISATION
- FILTRATION & ULTRAFILTRATION RÉNALES
- ISOTOPES, biologie
- CAPSULE DE BOWMAN
- DÉBIT SANGUIN RÉNAL
- CONTRE-COURANT SYSTÈME À
- RÉABSORPTION, physiologie
- TUBULE RÉNAL
- TUBULOPATHIES
- ANGIOTENSINOGÈNE