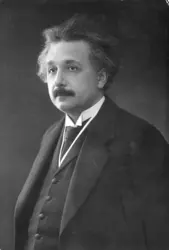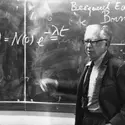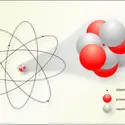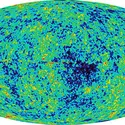RELATIVITÉ Vue d'ensemble
La théorie de la relativité est souvent considérée comme l'exemple même des révolutions scientifiques qu'a connues le xxe siècle. On ne peut pourtant la comprendre que dans un cadre historique bien plus large, en remontant aux débuts mêmes de la science moderne. C'est en effet à Galilée, et non à Albert Einstein, que l'on doit sinon le terme (d'ailleurs problématique, nous le verrons), du moins l'idée de relativité. Dans un très beau passage du Dialogue sur les deux grands systèmes du monde (1632), Galilée écrit : « Si donc un peintre avait commencé, en quittant le port [de Venise] à dessiner avec une plume sur un papier et continué à le faire jusqu'à Alexandrie, il aurait pu tracer à la plume toute une histoire avec beaucoup de figures aux contours parfaits et hachurés en mille et mille directions, avec des villages, des édifices, des animaux et toutes sortes d'autres choses, et pourtant tout le mouvement véritable, réel et essentiel de la plume n'aurait été qu'une ligne très longue mais toute simple ; le peintre, lui, pour ce qui est de son opération propre, aurait tracé exactement les mêmes lignes que si le navire était resté immobile. » En d'autres termes, la description d'un phénomène est nécessairement relative au point de vue adopté (les physiciens parlent de « référentiel »), mais, et c'est là l'essentiel, il existe des points de vue équivalents : pour le peintre à son bord, le mouvement du bateau est « comme rien » (Galilée). Le principe de relativité affirme l'identité des lois de la physique dans tous les référentiels équivalents. Cet énoncé est loin d'être trivial : il ne proclame l'équivalence que de certains référentiels, ceux dont le mouvement relatif est uniforme, de vitesse constante. Des mouvements accélérés ne sont pas « comme rien » : nous avons tous l'expérience des sensations physiques dues à l'accélération ou au freinage d'un véhicule ; il existe donc des référentiels non équivalents.
Encore faut-il concrétiser le principe général de relativité en une théorie spécifique, qui indique comment sont reliées les grandeurs physiques mesurées dans deux référentiels équivalents – comment est vu le dessin dont parle Galilée quand il est contemplé sur le bateau même, ou du point de vue d'un observateur immobile par rapport à la Terre (un satellite géostationnaire, par exemple). Ainsi, les coordonnées spatiales d'un événement se transforment, mais la coordonnée temporelle reste inchangée. Les formules (dites, par hommage anachronique, « transformations de Galilée ») qui explicitent le passage d'un référentiel à un autre, paramétrées par la vitesse relative des deux référentiels, sont au demeurant, dans le cadre de la physique classique, si simples qu'elles restèrent longtemps implicites. C'est avec cette théorie classique de la relativité qu'entre en conflit, vers la fin du xixe siècle, l'électromagnétisme de James Clerk Maxwell, et en particulier l'invariance de la vitesse de la lumière qu'il implique. Plutôt que de renoncer au principe de relativité, Einstein montre en 1905 comment le sauvegarder en en modifiant l'expression, illustrant ainsi le fameux adage du prince Salina dans Le Guépard : « il faut que tout change pour que rien ne change... ». Des formules de transformation plus sophistiquées (dites de Lorentz, 1904) permettent en effet d'énoncer l'équivalence des référentiels d'une façon compatible avec la théorie de Maxwell. Lorsque la vitesse relative des deux référentiels est négligeable devant la vitesse de la lumière, les formules de Lorentz se ramènent à celles de Galilée. La théorie einsteinienne prédit, et l'expérience vérifie amplement, diverses distorsions spatio-temporelles entre deux points de vue (souvent et abusivement appelés « contraction des longueurs » et « dilatation des temps »), mais ces effets a priori étranges ne sont guère que l'analogue des effets de perspective (ou plus précisément de parallaxe) dans l'espace ordinaire. Aujourd'hui, l'accent est mis beaucoup moins sur les aspects relatifs de l'espace-temps que sur ses aspects absolus : plutôt qu'aux grandeurs qui dépendent du référentiel, on s'intéresse à celles qui n'en dépendent pas – telle la vitesse limite (celle de la lumière) justement. La dénomination « relativité » est au fond assez mal choisie, comme Einstein lui-même finit par en convenir.
Mais pourquoi donc ce terme ? Bien qu'Einstein ne l'emploie pas dans son premier et fondateur article de 1905, il l'introduit dès l'année suivante. Il faut y voir l'influence directe du grand physicien et épistémologue Ernst Mach (1838-1916) qui défendait une conception explicitement relativiste (au sens métaphysique) de l'espace et du temps, déniant toute pertinence à l'idée newtonienne d'un espace et d'un temps absolus. Naturellement, entre ce point de vue strictement philosophique et la théorie physique d'Einstein, il n'y a pas d'identification possible, mais le lien, historiquement contingent, n'en est pas moins déterminant. Le terme « relativisme » s'était fixé dans le vocabulaire philosophique au cours du dernier tiers du xixe siècle. L'idée de relativisme (de la connaissance, justement) se répandra dans une acception critique ou sceptique, chez Mach par exemple ou Henri Poincaré, qui fut sans doute le premier, en 1904, à utiliser, dans une version encore abstraite, l'expression de « principe de relativité », et écrivait par ailleurs que « dans notre monde relatif, toute certitude est un mensonge ». On ne saurait donc s'étonner, et encore moins se gausser, des interprétations populaires du « tout est relatif » abusivement attribué à Einstein, puisque aussi bien on trouve aux origines mêmes de la formulation einsteinienne des résurgences du profond et permanent courant sceptique de la pensée humaine. La fortune de la terminologie relativiste, cependant, ne tient pas à ses seules sources philosophiques. L'ambiance historique des circonstances de l'émergence de la théorie n'a pas eu une mince influence. Einstein acquit sa formation au Polytechnicum de Zurich, et commença sa carrière au bureau des brevets de Berne, deux villes, où, dans les premières années du xxe siècle, régnait un climat de liberté et d'innovation intellectuelles, dû à l'intense passage de révolutionnaires politiques de toute l'Europe ou de novateurs culturels. Au sein de cette véritable contre-culture que représentait bien le cercle d'amis d'Einstein (l'Académie Olympia), il n'est guère étonnant que le thème de la relativité des valeurs (sociales, morales, esthétiques) ait pris une importance considérable, au point de marquer de son empreinte les nouvelles idées de la physique.
Une « théorie de la relativité », galiléenne ou einsteinienne, porte en vérité sur la structure même de l'espace-temps, pour lequel elle constitue l'exact analogue de la géométrie ordinaire utilisée pour décrire la structure de l'espace seul. Il faut donc considérer ces théories comme des « chronogéométries », appellation qu'il aurait mieux valu leur réserver. Vite acceptée par les physiciens, dès le début du xxe siècle, la chronogéométrie einsteinienne est aujourd'hui le cadre standard dans lequel sont décrits les phénomènes faisant intervenir des vitesses élevées, comme en physique des particules fondamentales, où cette théorie régit le fonctionnement des accélérateurs aussi bien que l'analyse des réactions entre particules. Mise à l'épreuve quotidiennement dans de très nombreuses expériences, la relativité einsteinienne n'a encore, un siècle après sa naissance, connu aucun conflit avec les observations.
La réforme due à Einstein de notre conception de l'espace-temps est souvent dénommée plus spécifiquement « relativité restreinte » pour la distinguer d'une seconde avancée ; Einstein développa en effet, à partir de 1915, une nouvelle théorie de la gravitation en accord avec la nouvelle conception de l'espace-temps, vouée à remplacer la théorie newtonienne classique. Cette théorie fut dénommée « relativité générale », par référence à la présentation géométrisée choisie par Einstein et fondée sur l'équivalence, quant à l'écriture des équations de la théorie, de tous les référentiels. On aboutit ainsi à décrire les effets de gravitation de façon purement géométrique, en les attribuant à une courbure de l'espace-temps, et non plus à une force, comme dans la conception newtonienne. Mais le principe d'invariance est ici essentiellement formel, et la même théorie est susceptible d'interprétations physiques différentes, par exemple en termes (plus conventionnels) de champ gravitationnel plutôt que de géométrie non euclidienne. Sur le plan expérimental, la théorie einsteinienne put prédire dès le premier quart du xxe siècle de faibles déviations par rapport à la théorie newtonienne pour certains phénomènes tels que les orbites planétaires (déplacement séculaire du périhélie de Mercure) ou la trajectoire des rayons lumineux passant auprès d'une masse importante (déviation des directions stellaires au voisinage du Soleil). Les observations confirmèrent avec précision ces effets, qui doivent même aujourd'hui être pris en compte dans certaines technologies comme la localisation par GPS. Mais la « relativité générale » est aussi convoquée chaque fois qu'il s'agit de décrire des phénomènes gravitationnels intenses, comme autour d'astres très concentrés (étoiles à neutrons, trous noirs) ; là encore, les observations sont actuellement toutes en accord avec la théorie. Reste un problème ouvert, celui de l'articulation entre théorie quantique et relativité générale, qui, si elles ne présentent pas de franche opposition, montrent une certaine incompatibilité d'humeur, que des reformulations en cours d'étude (théorie des supercordes par exemple) s'efforcent d'atténuer voire d'effacer.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean-Marc LÉVY-LEBLOND : professeur émérite à l'université de Nice
Classification
Média
Autres références
-
THÉORIE DE LA RELATIVITÉ, en bref
- Écrit par Bernard PIRE
- 175 mots
- 1 média
Albert Einstein propose, en 1905, la théorie de la relativité restreinte comme un nouveau cadre pour décrire de façon cohérente les phénomènes physiques mettant en jeu des vitesses proches de celle de la lumière. En imposant l'universalité de la vitesse de la lumière, la relativité restreinte...
-
ANTIMATIÈRE
- Écrit par Bernard PIRE et Jean-Marc RICHARD
- 6 934 mots
- 4 médias
...mêlant les spéculations hardies et l'analyse critique rigoureuse, fut nécessaire pour élaborer cette théorie. Le début du siècle vit naître la théorie de la relativité, qui modifie notre conception de l'espace et du temps, établit l'équivalence entre masse énergie, et corrige la mécanique classique lorsque... -
ATOME
- Écrit par José LEITE LOPES
- 9 146 mots
- 13 médias
...étaient publiés, deux théories, formulées quelques années auparavant, retenaient l'attention des physiciens : la théorie des quanta de Planck (1901) et la théorie de la relativité d' Einstein (1905). Les travaux de Poincaré, de Lorentz et d'Einstein conduisirent, au début du xxe siècle, à... -
CONTINU & DISCRET
- Écrit par Jean-Michel SALANSKIS
- 7 673 mots
...le discours qu'elle tient. L'interférence entre ce que dit la physique et le sens philosophique du continu, du discret et de leur opposition est devenue plus flagrante avec l'apparition des deux grandes théories « révolutionnaires » du début de ce siècle : la relativité et la mécanique quantique. -
COSMOLOGIE
- Écrit par Marc LACHIÈZE-REY
- 9 302 mots
- 6 médias
...fait contradictoire avec l'idée d'espace absolu et rigide que la physique newtonienne considérait, et que seule permettait d'appréhender la théorie de la relativité générale. Mais l'impact de cette théorie, ainsi que celui de la relativité restreinte, dépassait la simple introduction de la notion d'expansion,... - Afficher les 45 références