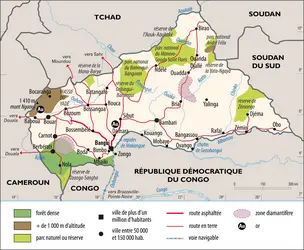CENTRAFRICAINE RÉPUBLIQUE
| Nom officiel | République centrafricaine |
| Chef de l'État | Faustin Archange Touadéra - depuis le 30 mars 2016 |
| Chef du gouvernement | Félix Moloua - depuis le 9 février 2022 |
| Capitale | Bangui |
| Langue officielle | Sango , Français |
| Population |
5 152 421 habitants
(2023) |
| Superficie |
622 980 km²
|
Article modifié le
Histoire
L'époque précoloniale
Les travaux de l'archéologue P. Vidal et des linguistes de l'équipe de J. Thomas et L. Bouquiaux (au début des années 1980) remettent en cause toutes les idées reçues sur l'histoire centrafricaine.
Les industries microlithiques apparaissent sur le sol centrafricain depuis plus de dix mille ans, mais, en l'absence de découvertes de squelettes de cette époque, on ne sait de qui elles furent l'œuvre : on pense que des Pygmées et d’autres populations noires se partageaient déjà l'espace centrafricain, car l'insensible transition entre le Paléolithique et le Néolithique dans les sites préhistoriques étudiés montre plus un processus de lente acculturation qu'une rupture technologique qui aurait été la conséquence d'une invasion brutale.
La domestication de l'igname sauvage et du palmier à huile marque le début de l'agriculture dans la région de la Bénoué et a des conséquences démographiques. Vers le IIIe millénaire avant J.-C., l'expansion des gens de langues bantu se heurte vers l'est aux colonies de locuteurs des langues proto-adamawa et oubanguiennes. Les premiers développèrent leur colonisation vers le sud, les seconds vers l'est : l'agriculture est attestée en Centrafrique à la moitié du IIe millénaire avant J.-C. À la fin du IIe millénaire avant J.-C., alors que l'ensemble du territoire actuel de la République centrafricaine et du sud du Tchad est colonisé par les Oubanguiens et les Adamawa, qui assimilent peu à peu ou marginalisent les groupes autochtones, une civilisation se développe dans la région de Bouar, qui érige des mégalithes (en gbaya : tazunu) jusqu'au ier siècle après J.-C.
La fin de la civilisation des tazunu est contemporaine de l'apparition de la technique du fer. Trouvant vraisemblablement ses origines dans la civilisation de Nok vers le ve siècle avant J.-C., cette technique est connue des Oubanguiens au plus tard au début du Ier millénaire après J.-C. : elle se développe d'ouest en est sans heurts notables, permettant un essor démographique constant jusqu'au xviiie siècle où la population est estimée à six millions d'habitants pour l'actuel Centrafrique. Jusque-là, la région n'est touchée par aucun courant commercial au long cours. Seule innovation connue, les sorghos sont introduits par contacts avec les populations septentrionales et les bananes plantains arrivent par l'Oubangui.
Le commerce de traite atlantique, nilotique et saharien touche les Oubanguiens au plus tôt au cours du xviiie siècle. Les riverains de l'Oubangui vont devenir les courtiers et les piroguiers des traitants tandis que, sur le Mbomou, des aristocraties militaires se structurent, qui mettent en place des États fournisseurs d'esclaves aux commerçants tant nilotiques qu'atlantiques.
À l'ouest les Fulbé de l'Adamawa et au nord les Baguirmiens de Cha puis de Ndélé (Bilad el Kuti), vassaux du Ouadday, mettent progressivement les pays gbaya et banda en coupe réglée.
La mise en contact avec le monde extérieur de populations isolées de lui depuis des millénaires provoque, vers la fin du xixe siècle, de violentes épidémies de variole qui décimeront les Oubanguiens plus sûrement que les razzias esclavagistes puisque, de nos jours encore, le tiers du territoire centrafricain, naguère peuplé par les populations kreich et yulu, est un quasi-désert humain. Ces épidémies vont, en outre, précipiter les survivants dans des mouvements migratoires désordonnés, tel lignage fuyant la maladie vers l'ouest, tel autre vers le sud (phénomène yangéré).
C'est de cette époque que date l'introduction de la patate douce, de l'arachide et du manioc qui resteront longtemps encore des productions marginales.
Après avoir pillé la région du Mbomou et le pays banda, Rabeh s'installe de 1879 à 1890 au Bilad el Kuti, à la tête duquel il place Mohammed Sénoussi. De là, il s'attaque au Baguirmi qu'il détruit avant de conquérir le Bornou. C'est le moment où se développe la pénétration française (mission Crampel, 1890 ; mission Maistre, 1892-1893).
L'époque coloniale
Les premières expéditions coloniales amenèrent la conclusion de traités de protectorat avec un certain nombre de chefferies de la région, traités qui permirent rapidement de déposséder les autorités locales de tout pouvoir au bénéfice de l'administration militaire puis civile des Français. Ceux-ci durent faire face à la concurrence des puissances coloniales européennes ainsi qu'à de nombreuses révoltes, et ils durent modifier constamment et les frontières de la colonie d' Oubangui-Chari jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale et les structures administratives dont les ressorts et les compétences ne seront pas fixés définitivement avant 1958.
Par décret du 28 décembre 1897, le Congo français fut réorganisé, le commissaire général ayant sous ses ordres deux lieutenants-gouverneurs, l'un pour le Congo, l'autre pour l'Oubangui. Une tentative de décentralisation se fit jour avec le décret du 29 décembre 1903 qui créait quatre régions dont l'Oubangui-Chari ; ce territoire était dirigé par un délégué permanent qui supervisa, à partir de 1906, les activités du territoire militaire du Tchad. Avec le décret du 15 janvier 1910 est instituée l' Afrique-Équatoriale française (A-EF) dont les frontières vont être immédiatement modifiées : le 4 novembre 1911, le gouvernement français céda à l'Allemagne une partie importante de l'ouest du bassin de l'Oubangui, modification sans lendemain qui fut annulée lors des opérations militaires de 1914.
L'occupation du territoire par les Français amena sur place des compagnies concessionnaires qui exploitèrent le pays et les hommes dans des conditions telles que les révoltes se succédèrent sur l'ensemble du pays depuis le début du xxe siècle : en effet, les populations furent poussées à bout par le statut que leur imposait le Code de l'indigénat : les travaux forcés, l'impôt de capitation, les cultures obligatoires, les corvées masculines, féminines, voire infantiles entraînèrent des mouvements de résistance sporadiques qui culminèrent avec la « guerre des Houes » (« Kongo-Wara ») lancée en 1928 à l'appel de Karinou, un prêtre des cultes traditionnels, qui souleva tout l'ouest du Centrafrique et toucha le sud du Tchad. La situation militaire ne fut rétablie qu'en 1931. Ces révoltes et leur répression laissèrent dans l'opinion des traces qui subsistent toujours.
Les transformations des structures sociales
Les conséquences sociales de la période coloniale furent considérables. Au début du xxe siècle, avec le développement du commerce et l'abandon de la culture du mil au profit du manioc, la vie communautaire est ébranlée : les rites traditionnels tombent en désuétude, les travaux des champs sont, en certains endroits, délaissés au profit du transport du caoutchouc ; le portage, la création des postes administratifs en dehors des villages, les constructions de villages dits de plantation, l'abandon de l'artisanat entraînent une crise dans l'agriculture traditionnelle. Les premiers signes d' exode rural apparaissent au moment où les techniques culturales primitives et la culture sur brûlis affaiblissent les sols plus rapidement que par le passé. À partir de 1924, sous l'impulsion de Félix Éboué, la culture cotonnière se répand, culture extensive, pratiquée selon l'expérience qu'en avaient les sociétés cotonnières belges du Congo, c'est-à-dire selon les méthodes autoritaires. L'exode rural se poursuit, la population de Bangui progresse parallèlement. Cependant, la politique cotonnière a aussi des conséquences favorables : augmentation de la production, amélioration des communications, extrême attention portée aux problèmes de l'encadrement agricole. À titre expérimental, le système dit des paysannats est institué en zone cotonnière. L'expérience des villages pilotes placés sous le contrôle de l'État est décevante : elle faisait bon marché de l'attachement des paysans à l'économie traditionnelle qui était remise en cause par la nouvelle culture et que ni la circulation des produits ni la fluidité monétaire n'avaient pu détruire.
Jusqu'à l'indépendance, la famille élargie demeure la cellule sociale de base à laquelle échappent en partie les élites sociales nouvelles (hauts fonctionnaires) dont le nombre s'accroît rapidement après 1956.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Apolline GAGLIARDI : diplômée en sciences politiques, spécialiste de la République centrafricaine
- Jean-Claude GAUTRON : professeur à l'université de Bordeaux-I
- Jean KOKIDE : docteur en histoire, chef de département d'histoire à l'université de Bangui, République centrafricaine
- Jean-Pierre MAGNANT : maître de conférences d'histoire des institutions
- Roland POURTIER : doctorat ès lettres et sciences humaines, professeur honoraire, université de Paris-Panthéon-Sorbonne, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer
- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis
Classification
Médias
Autres références
-
CENTRAFRICAINE RÉPUBLIQUE, chronologie contemporaine
- Écrit par Universalis
-
BANGUI
- Écrit par Roland POURTIER
- 739 mots
- 1 média
La capitale centrafricaine, Bangui, avec son agglomération incluant Bimbo, est créditée d’une population de 1 500 000 habitants en 2023, soit plus de la moitié de la population urbaine du pays. Berberati, la deuxième ville du pays, ne compte guère plus de 100 000 habitants. Bangui illustre parfaitement...
-
BOKASSA JEAN BEDEL (1921-1996)
- Écrit par Bernard NANTET
- 718 mots
- 1 média
Jean Bedel Bokassa naît en 1921 à Bobangui, dans l'ancien Oubangui-Chari, un des quatre territoires de l'Afrique-Équatoriale française qualifiée autrefois de « Cendrillon de l'empire français ». Orphelin à six ans, il est élevé par les missionnaires. En 1939, la carrière militaire s'offre...
-
CHARI-LOGONE
- Écrit par Marie-Christine AUBIN
- 530 mots
Ce sont les deux principaux fleuves qui alimentent le lac Tchad. Le Chari prend sa source en République centrafricaine et arrose le Tchad. Il est formé d'une série de petites rivières : le Bamingui (où se trouve sa véritable source), le Gribingui, l'Ouham, ou Bạhr Sara, qui...
-
CINQUIÈME RÉPUBLIQUE - Les années Hollande (2012-2017)
- Écrit par Pierre BRÉCHON
- 7 032 mots
- 3 médias
...En janvier 2013, les forces françaises interviennent au Mali pour éviter la mainmise d’un mouvement djihadiste sur le pays. Suit une intervention en Centrafrique, où se déchirent factions chrétiennes et musulmanes, et où l’ordre public n’est plus assuré. François Hollande rencontre ainsi plusieurs... - Afficher les 10 références
Voir aussi
- TRANSPORTS ÉCONOMIE DES
- MILICE
- CASQUES BLEUS
- ÉCONOMIQUE UNION
- COMMUNICATION VOIES DE
- SAVANE
- OUBANGUI-CHARI
- OUBANGUI
- UDEAC (Union douanière et économique de l'Afrique centrale)
- MUTINERIE
- BOZIZÉ FRANÇOIS (1946- )
- AFRIQUE, économie
- CEMAC (Communauté économique monétaire en Afrique centrale)
- OPPOSITION POLITIQUE
- PARTI UNIQUE
- RÉPRESSION
- AFRIQUE, géographie
- AFRIQUE NOIRE, histoire, période coloniale
- AFRIQUE NOIRE, histoire, des indépendances à nos jours
- AFRIQUE NOIRE ÉTATS D'
- AFRIQUE, préhistoire
- EXODE RURAL
- ÉPIDÉMIES
- AFRIQUE NOIRE, histoire précoloniale
- FRANCE, histoire, de 1974 à nos jours
- AFRIQUE NOIRE, ethnologie
- AFRIQUE NOIRE, langues
- PAYS ENCLAVÉS
- SANGO, langue
- BOGANDA BARTHÉLÉMY (1910-1959)
- MESAN (Mouvement de l'évolution sociale de l'Afrique noire)
- CORRUPTION
- DJOTODIA MICHEL (1949- )
- SAMBA-PANZA CATHERINE (1954- )