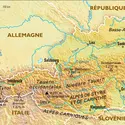RESTITUTION DES BIENS CULTURELS
Article modifié le
Les restitutions aux musées et aux collectionneurs particuliers
Plusieurs cas de figure sont ici à distinguer, chacun posant des problèmes spécifiques. Le plus simple est celui des objets volés dans les musées ou chez les collectionneurs particuliers, ou provenant des fouilles clandestines, ou expatriés en violation des lois en vigueur. Il semble clair, en effet, que ces objets doivent être restitués sans aucune contrepartie à leurs propriétaires légitimes ou aux pays qu'ils ont frauduleusement quittés. Autrement dit, l'obligation de restituer des objets d'origine illicite concerne tout État sur le territoire duquel on les découvre, quel qu'en soit le possesseur – un musée public ou un collectionneur particulier. Toutefois, ce dernier, s'il réussit à prouver sa bonne foi au moment de l'achat de l'objet, peut demander une indemnité équivalant au prix payé pour celui-ci. En effet, tous les cas de vol, de fouilles clandestines ou de sortie illégale du territoire ne sont pas documentés. Les listes des œuvres d'art volées tenues à jour et publiées par Interpol – la première notice de ce type date de 1947 – ne sont pas et ne sauraient être complètes. L'existence de fouilles illicites, par exemple, arrive souvent avec retard à la connaissance des autorités, tandis que les objets qui en proviennent circulent déjà sur le marché. Dans ce cas, le paiement d'une indemnité équitable est censé instaurer « une coexistence entre les deux finalités recherchées : d'une part, assurer la restitution indépendamment de la bonne foi de l'acquéreur, et, d'autre part, exclure que cette restitution puisse avoir le caractère de spoliation », d'après Guido Carducci à propos de la convention d'Unidroit.
La situation des musées est différente. Ceux du moins qui sont membres de l'International Council of Museums (I.C.O.M.) se sont engagés, en effet, à vérifier l'origine des objets qui appartiennent à leurs collections. Dès avril 1970, un groupe d'experts de l'I.C.O.M. a énoncé le principe selon lequel « l'origine de tout objet à acquérir, quelle que soit sa nature, doit être complètement, clairement et correctement documentée. Cela est tout aussi important pour un objet du type généralement défini comme “artistique” que pour un objet relevant de l'archéologie, de l'ethnologie, de l'histoire et des sciences naturelles ». Ce principe s'est traduit par la suite en une série de recommandations que les musées sont tenus de suivre. Comme l'a montré un retentissant procès intenté en 2005 par le gouvernement italien au musée Getty de Malibu et à sa conservatrice des antiquités, Mme Marion True, la pratique, même après 1970, s'écartait considérablement de ces beaux principes. Dans le sillage de ce procès, plusieurs musées américains, dont le Metropolitan Museum de New York, le Fine Arts Museum de Boston et le Cleveland Museum of Art, restituèrent à l'Italie et à la Grèce plus de cent antiquités qui avaient été expatriées illégalement. Quant au musée Getty, il a restitué à l'Italie quarante objets et institué une politique d'acquisitions parmi les plus strictes aux États-Unis, si ce n'est au monde. Après cinq ans de procédure, le procès ne s'est terminé ni par une condamnation ni par l'acquittement, mais parce qu'il y eut prescription. Il est permis d'espérer que, à la suite de ces précédents, aucun musée ne se permettra désormais d'acheter des objets suspects, ce qui réduira le marché pour les objets pillés en Afghanistan, notamment au musée de Kaboul, et en Irak, au musée de Bagdad. S'agissant des collectionneurs particuliers, rien n'est moins sûr. Pourront-ils à l'avenir arguer de leur bonne foi ? Et leurs acquisitions seront-elles dans trente ans couvertes par la prescription ? Ne faudrait-il pas unifier les législations dans les pays où les collectionneurs sont nombreux pour éviter que les bénéficiaires de ces récents pillages puissent impunément en profiter ? Nous en sommes encore loin.
Si les principes concernant des objets d'origine illicite sont entrés désormais dans le droit, il en va autrement s'agissant de la restitution à des particuliers ou à des institutions, notamment aux Églises, des biens culturels nationalisés. Le problème se pose dans tous les anciens pays du bloc communiste, et avec une acuité particulière dans l'ex-U.R.S.S. où tant les œuvres d'art ayant appartenu à la dynastie Romanov que les collections particulières ont été nationalisées par les bolcheviks et réparties entre les différents grands musées, sans que la provenance des œuvres soit toujours indiquée.
Faut-il rendre ces collections aux descendants des propriétaires, dont certains ne le demandent même pas ? Faut-il au contraire les considérer comme une propriété inaliénable de l'État, suivant l'exemple donné par la France qui n'a jamais restitué les œuvres nationalisées au cours de la Révolution ? Et si on choisit la seconde solution, faut-il dédommager les descendants des propriétaires qui ont été spoliés et, si oui, comment ? Le débat sur ces sujets se poursuit tant en Russie que dans d'autres pays auparavant communistes. Il est compliqué par l'intervention de l'Église orthodoxe en Russie ou de l'Église catholique en Pologne, qui exigent la restitution des biens leur ayant appartenu, y compris les biens culturels dont les œuvres d'art. Les autorités sont portées à leur donner satisfaction pour éviter un conflit et s'assurer leur appui, pour des raisons politiques. Mais si on cède aux revendications des Églises, au nom de quoi refuse-t-on de rendre leurs biens aux particuliers ?
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Krzysztof POMIAN : directeur de recherche émérite au C.N.R.S., directeur scientifique au Musée de l'Europe, Bruxelles
Classification
Autres références
-
AUTRICHE
- Écrit par Roger BAUER , Jean BÉRENGER , Annie DELOBEZ , Encyclopædia Universalis , Christophe GAUCHON , Félix KREISSLER et Paul PASTEUR
- 34 129 mots
- 21 médias
En 1998, la saisie à New York du Portrait de Wally d'Egon Schiele a incité l'État autrichien à adopter une loi sur la restitution des biens artistiques spoliés. Celle-ci s'est rapidement avérée insuffisante, comme l'a montré l'affaire des cinq tableaux de Gustav Klimt... -
PATRIMOINE CULTUREL ET CONFLITS ARMÉS
- Écrit par Julien ANFRUNS
- 3 426 mots
- 4 médias
D’autres problèmes touchant le patrimoine naissent des conflits, commela délicate question de la restitution ou du retour de biens qui ont fait l’objet de vols ou trafics illicites et qui se trouvent dans un autre pays. Les États ont en partie couvert cette problématique par la Convention sur l’interdiction...
Voir aussi
- COLLECTION, art et culture
- ALLEMANDE RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE (RDA)
- MAORIS
- MNR (Musées nationaux récupération)
- SPOLIATION DES JUIFS DE FRANCE
- COLLECTIONNEURS
- ICOM (International Council of Museums) ou CONSEIL INTERNATIONAL DES MUSÉES
- MARBRE, sculpture
- IDENTITÉ, sociologie
- PARTHÉNON
- INALIÉNABILITÉ
- DOMINATION, sociologie
- GRÈCE, histoire, jusqu'à l'indépendance (1830)
- GRÈCE, histoire, de 1830 à nos jours
- OFFRE & DEMANDE
- ALLEMAGNE RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D' (RFA), histoire depuis 1990
- EFFONDREMENT DU BLOC COMMUNISTE
- IMPÉRIALISME CULTUREL
- LOUVRE MUSÉE DU
- URSS, histoire
- MARCHÉ DE L'ART
- PILLAGE DES ŒUVRES D'ART
- HAWASS ZAHI (1947- )
- RESTES HUMAINS, muséologie
- BRUCE THOMAS dit LORD ELGIN (1766-1841)