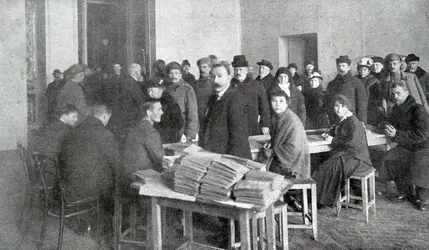RÉVOLUTION RUSSE
Article modifié le
Le premier gouvernement provisoire (mars-avril 1917)
Formé le 2 mars, le premier gouvernement provisoire est présidé par le prince Georges Lvov, entouré d'une majorité de représentants éminents du parti constitutionnel-démocrate (Pavel Milioukov aux Affaires étrangères ; Nikolaï Nekrassov aux Transports ; Andreï Chingarev à l'Agriculture). À la gauche de l'échiquier politique gouvernemental, Alexandre Kerenski, ministre de la Justice, est censé « faire le pont » entre le gouvernement et le soviet. En quelques semaines, ce gouvernement prend un train de mesures spectaculaires : libertés fondamentales, suffrage universel, amnistie générale, abolition de la peine de mort, suppression de toutes les discriminations de caste, de race ou de religion, reconnaissance du droit de la Finlande et de la Pologne à l'autodétermination. Malgré ces mesures réellement révolutionnaires, qui marquent une rupture radicale avec la culture politique de l'autocratie tsariste, le gouvernement doit faire face à une vague de revendications et d'actions difficilement contrôlables émanant des couches les plus diverses d'une société en révolution.
Les ouvriers demandent – et obtiennent, le plus souvent – la journée de huit heures, ainsi que des augmentations de salaire, vite absorbées néanmoins par une inflation galopante. Ils mettent sur pied des comités d'usine et des unités de « gardes rouges ». Les comités d'usine ont pour objectif de contrôler l'embauche et les licenciements, d'empêcher les patrons de procéder à des lock-out, sous prétexte de rupture d'approvisionnement, mais aussi de maintenir une certaine discipline du travail, de lutter contre l'absentéisme. Ces mesures constituent l'ébauche d'un contrôle ouvrier sur la marche des entreprises. Quant aux unités de gardes rouges, ce sont des milices ouvrières armées prêtes à défendre l'usine en tant qu'outil de travail des prolétaires, mais aussi à « défendre la révolution » contre ses « ennemis ».
Le gouvernement provisoire doit aussi faire face à l'agitation croissante qui gagne les armées. Dès le 1er mars 1917, le soviet de Petrograd a promulgué un texte fondamental, le Décret n0 1, véritable charte des droits du soldat. Ce texte abolit les règles de discipline militaire les plus vexatoires de l'ancien régime et permet aux soldats-citoyens de s'organiser en comités de soldats. Loin de se borner aux prérogatives, limitées, que leur donne le Décret n0 1, les comités de soldats outrepassent rapidement leurs droits, en viennent à récuser tel ou tel officier, prétendent en élire de nouveaux. Les unités sont progressivement gagnées par un « pouvoir soldat » qui déstabilise l'armée. Les désertions se multiplient. De mars à octobre 1917, plus de deux millions de paysans-soldats, fatigués de combattre, désertent. Leur retour au village alimente, à son tour, les troubles dans les campagnes.
Dans les villages, cependant, les désordres restent, durant le printemps de 1917, limités, surtout en comparaison avec ce qui s'était passé en 1905. La chute du tsarisme est l'occasion, pour les assemblées paysannes, de rédiger pétitions et motions exposant les doléances et les souhaits du peuple des campagnes. La question de la terre est au centre de tous les espoirs et de toutes les revendications. Les paysans exigent la saisie et la redistribution des terres de la Couronne et des grands propriétaires fonciers. Dans ces « cahiers de la révolution russe » (Marc Ferro) s'exprime avec force l'idéal paysan ancestral du « partage noir », en fonction des « bouches à nourrir ». Puisque la terre est un « don de Dieu », elle ne doit appartenir à personne. Chaque famille paysanne doit en avoir l'usufruit « à mesure de ce qu'elle peut mettre en valeur elle-même, sans l'aide de salariés ». Selon cette logique, « il ne sera laissé au grand propriétaire qu'un domaine qu'il peut cultiver lui-même, avec sa famille ».
Pour donner vie à ce vieil idéal égalitaire, les paysans s'organisent, mettent en place des comités agraires, tant au niveau du village que du canton. Jusqu'au début de l'été de 1917, ces comités font encore confiance au gouvernement provisoire et au soviet de Petrograd pour résoudre rapidement le problème agraire. « La terre par la Constituante », telle est, sur cette question capitale, la politique du gouvernement : seule l'Assemblée constituante, élue au suffrage universel, sera habilitée à légiférer sur la question agraire. Toute saisie illégale de terres sera sanctionnée. Entre une paysannerie de plus en plus impatiente et un gouvernement soucieux d'éviter l'anarchie et de prévenir les jacqueries, la méfiance, peu à peu, s'installe.
Pour le gouvernement provisoire, la question la plus urgente reste celle de la guerre. Les libéraux au pouvoir considèrent que seule une victoire de la Russie aux côtés des Alliés réussirait à amarrer solidement le nouveau régime aux démocraties occidentales et à assurer la cohésion d'une société en révolution. Aussi, dès le 4 mars 1917, Pavel Milioukov adresse-t-il une note aux Alliés dans laquelle il dit la détermination du nouveau gouvernement russe de poursuivre la guerre jusqu'à la victoire et l'annexion de Constantinople. Sur la question cruciale des buts de guerre, le soviet de Petrograd adopte une position différente de celle du gouvernement. Dans son Appel aux peuples du monde entier (14 mars 1917), le soviet de Petrograd se prononce pour une « paix sans annexions ni contributions ». Il prône le « défensisme révolutionnaire », qui s'efforce de concilier la « lutte des peuples contre les ambitions annexionnistes de leurs gouvernements » et le « maintien d'une politique défensiste préservant la combativité de l'armée ».
Seul de tous les dirigeants politiques, Lénine, contre l'opinion même de la majorité des bolcheviks, prédit la faillite du défensisme révolutionnaire et prône une rupture immédiate entre le soviet et le gouvernement provisoire. Décidé à tout prix à rentrer en Russie et aidé par le gouvernement allemand qui compte sur la force de déstabilisation du discours léniniste auprès d'une opinion publique russe qui doute de l'opportunité de poursuivre la guerre, Lénine quitte Zurich le 28 mars 1917, traverse, dans un wagon bénéficiant du statut d'exterritorialité, l'Allemagne, gagne la Suède et arrive, le 3 avril, à Petrograd. Il y présente (4 avril 1917) ses fameuses Thèses d'avril, vaste programme contre la poursuite de la guerre, contre le gouvernement provisoire, contre la république parlementaire. Lénine prône la nationalisation des terres, le contrôle ouvrier et le passage de « tout le pouvoir aux soviets ». Ces thèses radicales suscitent incompréhension et opposition au sein même du parti bolchevique, qui reste très divisé, tiraillé entre une base (marins de Kronstadt, gardes rouges des quartiers ouvriers de Petrograd) impatiente, voire prompte à l'aventure, et des dirigeants (Zinoviev, Kamenev) hostiles à tout aventurisme.
Quelques jours après le retour de Lénine en Russie, les positions divergentes du soviet de Petrograd, dominé par les socialistes-révolutionnaires et les mencheviks, et du gouvernement provisoire, à majorité constitutionnelle-démocrate, débouchent sur une crise politique (« crise d'avril »). Le 18 avril 1917, Pavel Milioukov adresse une note aux Alliés réaffirmant que la Russie combattra « jusqu'à la victoire finale ». La position du soviet, pour une « paix sans annexions ni contributions », n'est même pas mentionnée. La rue se mobilise, exigeant la démission de Milioukov. D'imposantes manifestations où, pour la première fois, figurent des mots d'ordre bolcheviques (« Tout le pouvoir aux soviets ! ») contraignent Milioukov et Alexandre Goutchkov, le ministre de la Guerre, à démissionner.
Face à cette situation de crise, le soviet de Petrograd annonce son ralliement à un gouvernement de coalition, qui rassemblerait libéraux (constitutionnels-démocrates) et socialistes modérés (socialistes-révolutionnaires et mencheviks). Cette participation n'est pas exempte d'arrière-pensées : les libéraux espèrent tenir les socialistes modérés par leur participation aux responsabilités gouvernementales et à la conduite de la guerre, tout en utilisant leur influence conciliatrice sur les masses ; les socialistes espèrent obtenir des réformes et la cessation de la guerre, tout en déjouant les projets contre-révolutionnaires. L'entrée de six ministres socialistes, dirigeants du soviet de Petrograd (dont Tseretelli et Tchernov) dans le second gouvernement provisoire, laborieusement constitué le 5 mai 1917, modifie profondément la donne politique et remet en question le principe même du double pouvoir. Les lignes de clivage ne passent plus désormais entre le soviet et le gouvernement. Devenus les gestionnaires de l'État bourgeois, les socialistes modérés laissent l'initiative de la contestation aux bolcheviks à un moment où les tensions sociales s'exacerbent.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Nicolas WERTH : directeur de recherche au CNRS
Classification
Médias
Autres références
-
ANTONOV-OVSEÏENKO VLADIMIR ALEXANDROVITCH (1884-1938)
- Écrit par Claudie WEILL
- 421 mots
Fils d'officier, Antonov-Ovseïenko entre à l'école des cadets de Voroneje. Il quitte l'armée, adhère dès 1901 au mouvement révolutionnaire et se rapproche des mencheviks en 1903. Lors de la révolution de 1905, il est l'un des experts militaires de la social-démocratie russe. Il essaye de soulever...
-
ARMÉE BLANCHE
- Écrit par Pierre KOVALEWSKY
- 456 mots
- 4 médias
Cette expression désigne ordinairement les diverses formations militaires qui ont combattu le pouvoir bolchevique en Russie de 1918 à 1922. Si leur but premier était le renversement du nouveau régime, certains de leurs chefs continuaient à se référer au pouvoir issu de la révolution de Février,...
-
BERDIAEV NICOLAS (1874-1948)
- Écrit par Olivier CLÉMENT et Marie-Madeleine DAVY
- 2 310 mots
...joue courageusement à Moscou un rôle pacificateur, et qui fait de lui un député à l'éphémère « Conseil de la République », l'inquiète par son irréalisme. La révolution bolchevique où pointe, à travers l'anarchie, l'esprit du grand inquisiteur, lui arrache d'abord un cri d'indignation. Mais... -
BOLCHEVISME
- Écrit par Georges HAUPT
- 7 596 mots
- 6 médias
Le terme de bolchevisme, dérivé du substantif abstrait bolchinstvo (majorité), désigne la théorie révolutionnaire de Lénine et la praxis du Parti bolchevique dont celui-ci fut le fondateur, le dirigeant et le stratège. Les origines et l'évolution sémantique de ce mot, lointain souvenir d'un...
- Afficher les 63 références
Voir aussi
- AGRAIRES RÉFORMES
- AGRAIRE RÉVOLUTION
- OUVRIÈRE CLASSE
- PAYSANNES RÉVOLTES
- MUTINERIE
- DÉMOCRATISATION
- DOUMA, assemblée
- ABOLITION DE LA PEINE DE MORT
- FÉVRIER 1917 RÉVOLUTION DE
- KERENSKI ALEXANDRE FEDOROVITCH (1881-1970)
- BOLCHEVIQUE PARTI
- CONTRE-RÉVOLUTION RUSSE
- DOUBLE POUVOIR
- KD ou CADET (Parti constitutionnel démocrate), Russie
- OCTOBRE RÉVOLUTION D' (1917)
- THÈSES D'AVRIL
- GRÈVE GÉNÉRALE
- JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES
- DÉFENSISME RÉVOLUTIONNAIRE
- RUSSIE, histoire, de 1801 à 1917