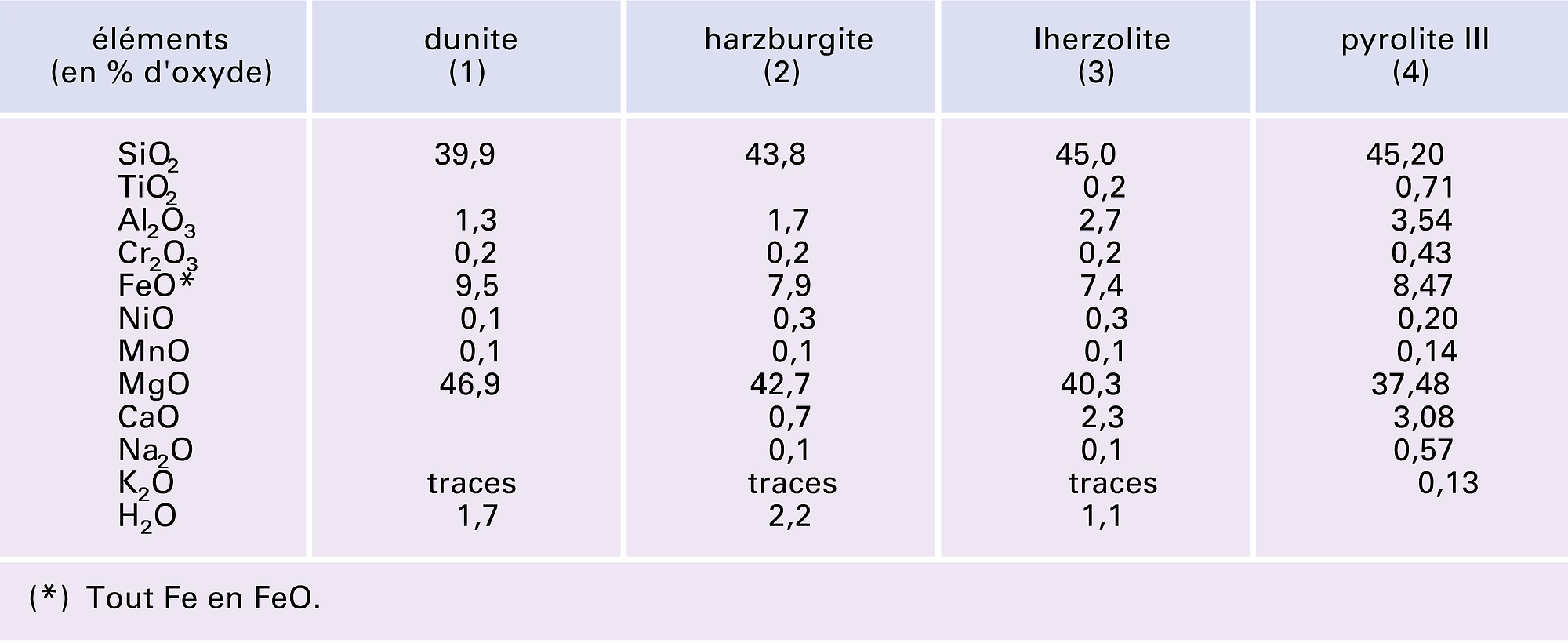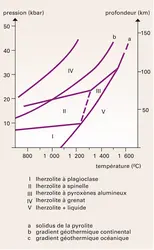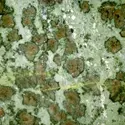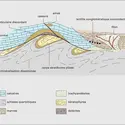ULTRABASIQUES ROCHES
Article modifié le
Types de gisement
Les gisements des roches ultrabasiques peuvent être rapportés à quatre types principaux, différant les uns des autres par la nature des roches qui y sont associées et par les rapports de l'ensemble avec l'encaissant. Les gisements étroitement liés aux vieux socles (Scandinavie, Galice, Massif central français), dont les caractères minéralogiques découlent essentiellement de l'action du métamorphisme régional, ne seront pas pris en considération ; la plupart des massifs de péridotite à grenat appartiennent à cette catégorie.
Les intrusions stratifiées péridotite-gabbro
Les intrusions stratifiées péridotite-gabbro forment des lentilles qui atteignent plusieurs kilomètres d'épaisseur, dont les structures sont parfois parallèles à celles de l'encaissant sédimentaire (gisements concordants). Les lopolites ou laccolites des gisements types (Rhum, Écosse ; Stillwater, États-Unis) sont formées pour leur plus grande part de l'association de roches ultrabasiques (péridotites et pyroxénites) et de roches basiques (gabbros à olivine, norites, anorthosites). En volume, le rapport des roches holomélanocrates aux roches gabbroïques est généralement inférieur à 1/10. Les différents types de roches sont disposés d'une façon déterminée et constante : les roches ultrabasiques, les plus denses, se trouvent dans la partie inférieure du gisement et sont surmontées par des gabbros dont la densité va en diminuant vers le toit du dispositif ; la partie supérieure est parfois occupée par des roches de composition granitique. Il existe d'autres caractères spécifiques remarquables :
– Le contact de la série avec les roches encaissantes est marqué par une bordure figée qui indique que l'intrusion s'est mise en place sous forme liquide ou partiellement liquide.
– Dans la plupart des gisements, un litage rythmique des formations, résultant de l'alternance de lits parallèles entre eux, tour à tour holomélanocrates et mésocrates, constitue des séquences plusieurs fois répétées sur une même verticale. L'explication de ces structures suppose un mécanisme de cristallisation fractionnée à partir d'un liquide et une différenciation par gravité des premières phases constituées dans le magma (phases d'accumulation) ; cette « sédimentation magmatique » s'accompagne parfois de la formation de figures sédimentaires analogues à celles qui caractérisent les séries de type « flysch ». Un effet thermogravitationnel (effet « Soret ») peut également rendre compte de certaines caractéristiques de ce litage.
Enfin, des concentrations d'intérêt économique en platine, chrome, nickel et cobalt sont génétiquement liées à quelques-unes de ces intrusions.
L'ensemble des caractères décrits à propos des intrusions stratifiées se retrouve dans les séries ophiolitiques. Celles-ci se distinguent par le lieu de leur mise en place, au niveau des dorsales océaniques, et, dans le cas type, par la présence, au sommet de la série, de spilites elles-mêmes surmontées par des radiolarites.
Les massifs de lherzolite et leur cortège
Les gisements – qui ont une surface allant de quelques mètres carrés à quelques dizaines de kilomètres carrés – sont pour l'essentiel constitués de lherzolites ou de harzburgites à spinelle. Les gabbros sont très rares, les roches associées, sous la forme de filons, aux péridotites étant représentées par divers types de pyroxénite, plus rarement par des amphibolites. Ces gisements sont souvent situés dans des orogènes récents (Alpes, Pyrénées, Cordillères bético-rifaines...), ce qui explique qu'ils soient encore très fréquemment appelés « péridotites de type alpin ».
Les lherzolites et les roches qui leur sont associées possèdent deux caractères qui suffisent à les distinguer nettement des intrusions stratifiées. Le premier est d'ordre structural : les roches sont dans leur masse affectées par des plissements isoclinaux et par une schistosité dus à des déformations plastiques sous des pressions élevées, comparables à celles qui doivent régner dans le manteau supérieur. Le second caractère est d'ordre minéralogique : la nature des paragenèses de même que la composition chimique des minéraux indiquent des conditions de cristallisation ou de recristallisation à des températures et à des pressions élevées correspondant à des profondeurs comprises entre 30 et 100 kilomètres, c'est-à-dire également dans le manteau supérieur.
Les lherzolites peuvent être partiellement ou entièrement remplacées par des serpentinites, roches hydratées qui pour certains auteurs constitueraient en partie la croûte océanique.
Les complexes annulaires alcalins et les pipes de kimberlite
Le caractère alcalin des roches ultrabasiques constituant ces gisements se traduit par la présence de micas et de pyroxènes sodiques dans les péridotites et les pyroxénolites.
Dans les complexes annulaires, la roche holomélanocrate est étroitement associée à des roches plutoniques riches en feldspathoïdes (théralites, ijolites) et dans certains cas à des carbonatites. Les différents types de roches sont disposés de façon concentrique, constituant un cylindre subvertical discordant sur l'encaissant. Elles auraient cristallisé à partir d'un magma fortement enrichi en alcalins et en éléments volatils (H2O, CO2) injecté à faible profondeur (gisement subvolcanique).
Les kimberlites sont des péridotites micacées bréchiques qui emplissent des cheminées d'explosion subverticales, à contours elliptiques (« pipes »). Ces dunites à phlogopite, souvent très altérées, contiennent en grand nombre des enclaves très diverses : sédimentaire, métamorphique ou éruptive, parfois d'origine extrêmement profonde, et constituent, avec certains lamproïtes (États-Unis, Australie), le gisement du diamant. La cristallisation des kimberlites se serait produite à partir d'un magma basique ou ultrabasique alcalin, différencié à grande profondeur. Ce processus étant accompagné d'une concentration des éléments volatils dans le liquide résiduel, cela expliquerait la nature explosive de la mise en place.
Les enclaves dans les basaltes et dans les kimberlites
Les enclaves de roches ultrabasiques observées dans les laves épanchées à la surface sont de deux types :
– Elles résultent de l'accumulation des cristaux les premiers formés dans le magma, à des profondeurs variées ; elles possèdent alors les caractères texturaux et minéralogiques des péridotites et pyroxénites des intrusions stratifiées. Ces enclaves, ou « cumulats », s'observent aussi bien dans les basaltes tholéiitiques que dans les basaltes alcalins.
– Les péridotites, qui sont de loin les plus abondantes, et les pyroxénites (avec ou sans grenat) ont les caractères structuraux, minéralogiques et chimiques des lherzolites et des roches associées présentes dans les zones de plissement alpin. Souvent désignées sous le nom de « nodules », ces roches représenteraient le matériau constituant le manteau supérieur de la Terre dans la zone même où le basalte a pris naissance ou au-dessus de celle-ci. Le fait que ce type d'enclave ne soit présent que dans les laves basaltiques alcalines n'est pas encore clairement expliqué.
Outre ces deux types d'enclaves, les kimberlites contiennent aussi des fragments de lherzolite ou de harzburgite à grenat, qui auraient été arrachés aux zones profondes du manteau supérieur.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Fernand CONQUÉRÉ : ancien maître assistant au Muséum national d'histoire naturelle
- André-Bernard DELMAS : assistant de recherche à l'Institut national de la recherche agronomique, Versailles
- Jacques KORNPROBST : docteur ès sciences professeur de géologie à l'université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand, directeur du centre de recherches volcanologiques
- Georges PÉDRO : directeur de recherche à l'Institut national de la recherche agronomique, membre de l'Académia Europaea
Classification
Médias
Autres références
-
ÉCLOGITES
- Écrit par Gérard GUITARD
- 1 509 mots
- 3 médias
Les éclogites – ainsi désignées par l'abbé Haüy pour indiquer la « sélection » (ἐκλογή) singulière de leurs minéraux – sont des roches essentiellement formées de grenat et de clinopyroxène particuliers ; leur composition chimique, généralement analogue à celle de basaltes et de gabbros, est souvent...
-
MÉTAUX - Gisements métallifères
- Écrit par Marie-José PAVILLON
- 7 843 mots
- 5 médias
...sont souvent difficiles à préciser (en dehors des relations purement géométriques), sauf en ce qui concerne les roches basiques (basaltes, gabbros) et ultrabasiques ( péridotites) caractérisées par des minéralisations en Cu, Pt, Cr, Ni, Co, Fe, Ti. Mis à part le cuivre très ubiquiste, la majorité du... -
NEWJANSKITE & SYSSERTSKITE
- Écrit par Guy TAMAIN
- 209 mots
Minéraux du groupe de l'iridosmine composés principalement d'osmium et d'iridium en solution solide, la newjanskite et la syssertskite (découvertes dans l'Oural, à Neviansk et à Syssert respectivement) cristallisent dans le système hexagonal et se présentent sous forme de lamelles ou grains tabulaires....
-
NICKEL
- Écrit par Jacques GRILLIAT , Bernard PIRE , Michel RABINOVITCH et Jacques SALBAING
- 4 778 mots
- 6 médias
Ces amas dérivent de l' altération, sous climat tropical humide, deroches ultrabasiques (péridotites et dunites). Ces latérites plus ou moins anciennes peuvent se trouver à l'air libre si la surface d'altération n'a pas été enfouie sous des sédiments plus récents, ou former un niveau dans une séquence... - Afficher les 9 références
Voir aussi
- GISEMENTS MÉTALLIFÈRES
- ALTÉRATION DES ROCHES
- CRISTALLISATION
- LHERZOLITES
- SERPENTINISATION
- PÉRIDOTITES
- MAGMAS
- PÉTROLOGIE
- ENCLAVES, pétrologie
- KIMBERLITES
- GABBROS
- PYROLITE
- COMPLEXES ANNULAIRES
- ASBOLANES
- DUNITE
- FERRITISATION
- PYROXÉNOLITES
- SIFÉMISATION
- SIMATISATION
- AMPHIBOLOLITES
- INTRUSION, géologie
- CUMULATS
- DIFFÉRENCIATION, pétrologie
- HARZBURGITES
- SERPENTINITES
- HOLOMÉLANOCRATES ROCHES
- LITAGE, pétrographie
- MAGMAS BASALTIQUES