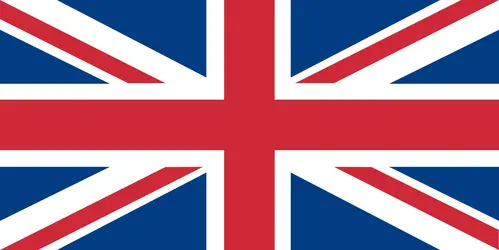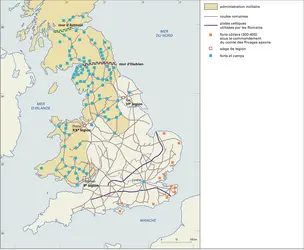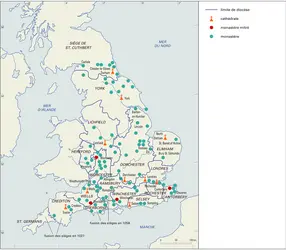ROYAUME-UNI Histoire
| Nom officiel | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord |
| Chef de l'État | Le roi Charles III - depuis le 8 septembre 2022 |
| Chef du gouvernement | Keir Starmer - depuis le 5 juillet 2024 |
| Capitale | Londres |
| Langue officielle | Anglais (Le gaélique et le gallois sont reconnus comme langues officielles localement.) |
Article modifié le
Guerres et crises
De 1914 à 1945, la Grande-Bretagne est entrée dans l'âge de la guerre totale. La Grande Guerre avait déjà conduit au combat 5 millions de soldats, marins, aviateurs et entraîné une énorme mobilisation de main-d'œuvre et de moyens à l'intérieur ; la guerre de 1939-1945, aussi exigeante en combattants, a obligé à soumettre la population civile à des règles d'emploi et à des déplacements contraints de main-d'œuvre qui ont transformé la population active en une véritable armée du travail entre les mains d'un ministre, Ernest Bevin, qualifié de « dictateur du travail ». Les pertes humaines ont été considérables : 700 000 tués britanniques sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale (et plus de 200 000 soldats de l'Empire); plus de 400 000 morts au combat entre 1939 et 1945. Chiffres auxquels il convient à chaque fois d'ajouter des blessés graves, succombant parfois quelque temps après, et aussi, pour apprécier l'effet démographique, le déficit des naissances entraîné par la rupture de la vie familiale et les retards au mariage non compensés ; on avait ainsi estimé à 2 millions les pertes réelles en métropole de 1914-1918. Les ruines matérielles ont été fort lourdes. Le territoire britannique est relativement épargné pendant la Grande Guerre : il s'est agi alors des pertes en bateaux, du coût financier et de l'endettement, de l'épuisement de machines industrielles, de la disparition de marchés traditionnels, de l'impossibilité de récupérer certains avoirs et investissements, en particulier dans la Russie révolutionnaire. La Seconde Guerre mondiale, qui a connu les mêmes charges, leur a ajouté les énormes destructions provoquées par les bombardements et qu'on a estimées par exemple au tiers du parc des logements et à une proportion similaire des infrastructures ferroviaires ou industrielles. Appauvrissement relatif et déclin de puissance mondiale ne pouvaient que s'ensuivre, même si l'illusion impériale, dans l'entre-deux-guerres, et la victoire dans chacun des conflits ont retardé les prises de conscience. Même si, d'autre part, chaque guerre s'est accompagnée d'un énorme effort de création d'entreprises nouvelles, d'inventivité, et si on a assisté à de véritables bonds en avant technologiques dans les secteurs les plus neufs. Il convient aussi de souligner à cet endroit le traumatisme psychologique considérable, pour les individus comme pour la nation dans son entier, créé par la cruauté des événements et des deuils, et qu'a complété le désir de compensations de toutes sortes, de facilités nouvelles de vie après les guerres : d'une sécurité accrue pour les moins favorisés aux loisirs les plus diversifiés pour tous, dans un esprit de libération des mœurs et de reniement de vieilles valeurs que l'on considère dépassées.
Le bilan de la Grande Guerre
En 1918-1919, les pessimistes sont encore rares. La famille royale, qui a adopté en 1917 le nom de Windsor, est très populaire. Au pouvoir depuis la fin de 1916, David Lloyd George est à la tête d'une coalition parlementaire et gouvernementale regroupant les conservateurs et ceux des libéraux, fidèles à sa personne, qui ne reconnaissent plus la légitimité d'Asquith. En juillet 1918, on a modifié le régime en accordant enfin le droit de vote à tous les hommes de vingt et un ans et plus, ainsi qu'aux femmes à partir de trente ans. En décembre, le nouveau corps électoral, sous l'impression de la victoire, a fait un triomphe aux bénéficiaires de l'investiture de Lloyd George (coupon elections). Celui-ci, fort de l'appui de sa nation, a négocié à Versailles les meilleures conditions possibles de paix, obtenant des dépouilles coloniales allemandes une part considérable de l'ancien Moyen-Orient ottoman, un quart des futures réparations allemandes et, au bénéfice de chacun des dominions, un siège à la Société des Nations. À l'intérieur, où le Parti travailliste s'est doté de sa « constitution » définitive, des transferts de fidélité libérale se font à son profit comme à celui des conservateurs (Churchill n'accomplit ce pas qu'en 1924). Un boom économique, bénéfique aux constructions navales notamment, dissimule la profondeur des difficultés à venir, limitées par ailleurs par la préservation quelque temps des contrôles gouvernementaux dans les mines de charbon et des prix garantis aux agriculteurs.
Les années 1920
En Angleterre, comme ailleurs, les années 1920 ont été des années « folles ». Les femmes sont émancipées dans leur comportement en société avant de recevoir, en 1928, la pleine égalité de droits électoraux avec les hommes. Des loisirs nouveaux pimentent la vie, ainsi le cinéma, les palais de la danse, les grands spectacles sportifs, qui justifient par exemple la construction d'un stade de 100 000 places à Wembley en 1926. La protection sociale est étendue par une série de lois successives, en particulier les allocations de chômage qui, en fin de période, sont versées pendant douze mois aux ayants droit. L'activité économique s'accélère, procurant au pays un taux de croissance industrielle supérieur à 2 % par an en moyenne ; l'Angleterre « verte » s'industrialise : raffineries de pétrole, usines pétrochimiques, industries électriques, automobile y prospèrent. L'électrification des entreprises garantit d'importants gains de productivité. La Cité retrouve son rôle de grande place financière internationale et, en 1925, le chancelier de l'Échiquier Winston Churchill peut faire adopter le Gold Standard Act qui, rétablissant partiellement la convertibilité en or de la livre, rend à la monnaie britannique sa parité d'avant guerre avec le dollar américain. De nouvelles chaînes de magasins se développent – ainsi Marks & Spencer à partir de 1928 –, les activités de service sont en plein essor. La prospérité est sélective : les grandes industries traditionnelles du charbon, des constructions navales, des cotonnades stagnent ou périclitent, condamnant des régions entières de l'Angleterre « noire » au marasme, conduisant 10 % de la population active, en moyenne, au chômage, semant les ferments du désespoir dans le sud du pays de Galles, le centre de l'Écosse, le Lancashire. Dans les campagnes, aux aristocrates et grands propriétaires appauvris par les impôts sur le revenu et les droits successoraux, l'euphorie des fermiers, qui leur rachètent, en six ans, près d'un quart de l'Angleterre, le cède bientôt aux souffrances d'un endettement excessif dans un temps de baisse des prix agricoles après la suppression des garanties gouvernementales. Une fraction de la société ne profite pas du développement : d'où des crises graves en 1921-1922 et surtout en mai 1926, quand une grève « nationale » ou « générale » de neuf jours paraît mettre en péril la nation elle-même!
Politiquement, ces années voient la grande relève du Parti libéral par le Parti travailliste : à partir de décembre 1923, celui-ci est le deuxième parti de gouvernement, Ramsay MacDonald devenant en janvier 1924, pour moins de dix mois, le premier Premier ministre de son parti, malgré une position minoritaire au Parlement ; en 1929, sans avoir la majorité absolue, le Labour Party n'en devient pas moins le plus nombreux au Parlement, et Ramsay MacDonald est derechef rappelé au 10 Downing Street. La vigueur du Parti travailliste explique sans doute dans une certaine mesure l'échec complet du jeune Parti communiste constitué en 1921 : ce qui n'exclut pas une grande peur « du rouge », des accusations systématiques de « cryptocommunisme » contre le Labour Party, en particulier en 1924 où un faux aujourd'hui notoire, la lettre Zinoviev, prétendument signée du président de l'Internationale communiste, et attestant de la réalité de la menace révolutionnaire en Grande-Bretagne, sert d'argument de poids à la campagne électorale du Parti conservateur. Plus positivement, la relève politique ne s'accompagne d'aucune remise en question du système de la monarchie parlementaire.
L'empire évolue. Pendant que l'Irak devient un protectorat de fait et la Transjordanie, création artificielle, un mandat solidement contrôlé, qu'on se consolide en Palestine, qu'on refuse en Inde de tenir les promesses de 1917, on fait évoluer les dominions vers une pleine souveraineté internationale. En 1926, la conférence impériale adopte la définition de la commission Balfour d'un Commonwealth de nations britanniques égales en statut et unies par leur commune allégeance à la Couronne ; et, cinq ans plus tard, le Parlement peut l'inclure dans le statut de Westminster (1931). Cette position juridique est aussi celle d'une fraction de l' Irlande : les vingt-six comtés de l'« État libre », détaché de l'ensemble par l'accord de décembre 1921 qui a, ipso facto, maintenu l' Ulster au sein du Royaume-Uni.
La position mondiale de la Grande-Bretagne, quoique diminuée, demeure exceptionnelle. Elle constitue avec la France, en l'absence des États-Unis, l'un des deux piliers essentiels de la Société des Nations. Elle s'efforce, en Europe, de jouer les honnêtes courtiers, au prix d'un refroidissement des relations avec la France, dans le but d'une réinsertion de l'Allemagne dans la communauté des nations et de la restauration de la prospérité générale : en 1925, le pacte de Locarno, grâce à la garantie britannique de toutes les frontières à l'ouest de l'Europe, dégèle la situation et permet, l'année suivante, de faire entrer l'Allemagne à la SDN. Les Britanniques ont aussi favorisé la mise sur pied de règlements de réparations plus étalés et moins exigeants, en 1924 (plan Dawes) et en 1929 (plan Young). Dans le Pacifique, l'Angleterre a dû renoncer à poursuivre, en 1921-1922, son alliance avec le Japon, de façon à inclure les États-Unis (accords de Washington, 1922) dans un vaste ensemble international de garanties apportées à l'intégrité chinoise et à un système de parités fixes entre les flottes de haute mer ; ce qui équivalait à laisser aux Américains la police du Pacifique ! Ouvert très tôt à la reprise de relations commerciales avec la Russie bolchevique, après quelques velléités d'intervention armée contre-révolutionnaire, le Royaume-Uni reconnaît le premier l'URSS en 1924... mais rompt avec elle en 1927. Reflet du pacifisme de l'opinion publique, la diplomatie britannique joue partout en faveur de la paix, incitant à l'ouverture d'une conférence du désarmement sous l'égide de la SDN (elle s'ouvre en fait en 1932), participant en 1928 au pacte Briand-Kellog de mise hors la loi de la guerre ; les budgets militaires diminués attestent à la fois des incapacités matérielles et une volonté politique.
Les années 1930
Dans la mémoire collective, les années 1930 constituent les années « sombres », années noires de dépression économique, de crise sociale, de démission internationale.
La crise économique, née en 1929 aux États-Unis, frappe l'Angleterre de plein fouet en 1931, menant en juillet à une panique financière. Elle est marquée par une crise commerciale, par la diminution, parfois de moitié, de la production industrielle, par un chômage qui frappe au moins 3 millions de Britanniques en 1932, par la souffrance des régions déjà victimes du déclin au cours de la décennie précédente. Elle dure au moins jusqu'en 1935 et a paru appeler, pour la combattre, un gouvernement d'Union nationale que Ramsay MacDonald constitue le 24 août 1931 contre la majorité de son propre parti qui le qualifie de « déserteur ». Le très bas prix des produits alimentaires et des matières premières, auxquels la Grande-Bretagne n'applique pas de droits de douane, constitue pour elle un fondement de son salut ; elle y ajoute une dévaluation monétaire de l'ordre de 40 % en 1932 pour relancer ses exportations, une stricte austérité budgétaire pour rétablir la confiance dans la livre, le retour au protectionnisme abandonné en 1846, mais en le nuançant par des accords de « préférence impériale » avec son Empire (accords d'Ottawa, 1932) ; une vigoureuse politique de construction de logements sociaux et privés, l'encouragement public à des opérations de concentration de l'appareil productif, des garanties de prix accordées à l'agriculture par l'intermédiaire d'offices fonciers, le dynamisme des secteurs de pointe et une relance par la consommation (sans suivre pourtant les incitations de John Maynard Keynes à une inflation contrôlée), obtenue par l'augmentation du pouvoir d'acquérir des biens industriels et par l'arrivée à maturité de l'arme publicitaire, ont constitué entre autres les conditions de relèvement. Au total, les années 1930 auront connu, malgré la crise, un taux de croissance moyen d'environ 3 % et certainement démenti les sombres prédictions d'observateurs étrangers comme André Siegfried (« La Crise anglaise au xxe siècle », 1931) sur l'incapacité paresseuse des dirigeants de l'économie britannique. Guérie en 1935, celle-ci ne parvient pourtant pas à résorber un important chômage, près de deux millions de victimes encore en 1937, année de la publication de la grande enquête de George Orwell, La Route de Wigan Pier ; des régions entières demeurent sinistrées, décrites par J. B. Priestley dans ses Voyages en Angleterre, et, en Écosse et dans le pays de Galles, des mouvements nationalistes y trouvent le prétexte de leur développement. La misère a été grande parmi les chômeurs en fin de droits, humiliés par l'obligation de s'adresser à l'Assistance publique et d'y subir un rigoureux examen de toutes leurs ressources (Means Test) ; la « faim » a provoqué en 1934 et en 1935 l'organisation de marches sur Londres. Les gouvernants, Stanley Baldwin succédant à MacDonald en 1935 et cédant la place à Neville Chamberlain en 1937, n'ont jamais accepté de prendre de grandes mesures sociales : c'est en 1938 seulement qu'on instaure une semaine de congés payés. Même si, économiquement, la politique suivie paraît efficace, si se trouve presque résolue la terrible question du logement ouvrier, si des signes nouveaux de confort se sont largement répandus, dont la radio dans 80 % des foyers en 1938, les mentalités ouvrières ont été marquées durablement par la vision d'un désastre social.
Le politique reflète le trouble de l'économique. Le Parti travailliste, victime de ses déchirements intérieurs, a été laminé aux élections de 1931 et ne connaît qu'un début de redressement en 1935, même si de nouveaux chefs, Clement Attlee, Stafford Cripps, Hugh Dalton, viennent remplacer les anciens : à la fin de la période, la suggestion d'un « Front populaire » avec les communistes, faite par Stafford Cripps et Aneurin Bevan, conduit à des exclusions également dommageables à l'unité et à l'image du parti. Sans effectuer de véritable percée, le Parti communiste tente de profiter de la situation, pratique à partir de 1935 une politique de « la main tendue », essaye d'encadrer les chômeurs et de s'infiltrer dans les syndicats, gonfle quelque peu des effectifs militants toujours inférieurs à la trentaine de milliers. Plus sérieuse a paru un moment la menace fasciste. D'abord appelée Nouveau Parti en 1931, une Union britannique des fascistes a été créée par sir Oswald Mosley en 1932. Ancien ministre travailliste en 1930 encore, un temps idole de la gauche du parti, remarquable orateur, Mosley imite l'Italie, constitue des troupes de « chemises noires », mène des actions violentes ; à partir de 1934, séduit par Hitler, Mosley achève de donner un caractère raciste et particulièrement antisémite à son mouvement et consent à de véritables opérations de pogrome dans l'East End londonien. Le mouvement ne compte guère plus de 20 000 membres. Son dynamisme s'étiole quand la loi sur l'Ordre public de 1936 interdit le port d'uniformes aux membres de tout parti politique et promulgue l'interdiction de manifestations. Il ne peut guère prendre prétexte de la gravité d'une crise qui se résorbe peu à peu ; il ne correspond pas à un besoin pour des bourgeois que rassure la vigueur du Parti conservateur. Il n'ose pas, en 1935, affronter le verdict des urnes ; il souffre de la douteuse réputation des nazis et des fascistes du continent. Du coup, pendant que les libéraux ne cessent de s'entre-déchirer entre partisans obstinés du libre-échange et « nationaux », disposés à suivre les principes de l'Union nationale, sans parler de la petite fraction des fidèles du seul Lloyd George, les conservateurs apparaissent comme les grands bénéficiaires de la période. Leur pragmatisme, leur compétence, leur efficacité leur valent bien des ralliements, leurs chefs, de Stanley Baldwin, déjà Premier ministre en 1923 et en 1924-1929, à Neville Chamberlain, fils de Joseph, brillant responsable des Finances, jouissent d'une grande popularité ; même si Winston Churchill, opposé à toute concession aux nationalismes coloniaux, est mis alors sur la touche, réduit au rôle de prophète de malheurs internationaux ou à celui, plus discuté, d'« ami » du roi Édouard VIII, monté sur le trône en 1936 et contraint l'année suivante à abdiquer pour pouvoir épouser Mrs. Simpson.
La politique étrangère constitue le domaine où l'adhésion de la grande majorité des hommes politiques et de l'opinion a couvert les erreurs les plus considérables. En partie sous la pression de la nécessité, parce qu'une grande politique de réarmement a longtemps paru financièrement suicidaire, surtout par l'effet de mauvais calculs, on a privilégié partout et toujours la recherche du compromis, l'acceptation des coups de force, la résignation à la révision de traités essentiels, le non-engagement militaire. En 1932, rien n'est fait pour empêcher le Japon d'annexer de facto le Mandchoukouo ; en 1935-1936, l'opposition à la conquête italienne de l'Éthiopie, pourtant accompagnée d'un embargo international sur certains produits et du déploiement d'une force navale britannique importante en Méditerranée, aboutit à un fiasco et à la reconnaissance de l'empire italien d'Afrique en 1937 ; dans l'affaire de la Rhénanie en 1936, on déclare hors de question toute intervention militaire contre une Allemagne dont on a admis, dès 1935, le réarmement naval par un traité bilatéral qui violait ouvertement le traité de Versailles ; la guerre d'Espagne (1936-1939), qui est, en Grande-Bretagne, la grande affaire où partisans et adversaires du fascisme se reconnaissent, mais où aussi les partisans de l'ordre à tout prix privilégient l'injustice plutôt qu'un gouvernement « rouge », est l'occasion pour Londres d'imposer à la France la politique de non-intervention ; l'Anschluss de l'Autriche est reconnu sans difficulté et, en 1938, Chamberlain, homme de l'appeasement, devient celui, inoubliable, de Munich. Il faut attendre mars 1939 pour que le gouvernement soit soudain saisi d'une fièvre de garanties à tous les pays menacés par l'expansionnisme nazi, dont la Pologne, mais il demeure si hésitant à l'idée d'une alliance avec l'URSS que celle-ci est poussée à préférer, en août, un pacte avec l'Allemagne. Dans ce grand gâchis, on reconnaîtra la pression de l'opinion publique, ultra-pacifiste (succès du « référendum [privé] pour la paix » de 1935, organisation d'objecteurs de conscience), une confiance naïve d'hommes civilisés dans les vertus de la négociation raisonnable, le souvenir du cauchemar des tranchées de 1914-1918, le refus du principal parti d'opposition, le Parti travailliste, en avril 1939 encore, d'accepter même l'idée du service militaire en temps de paix, la foi dans la SDN. Et on soulignera que l'Angleterre a pourtant confirmé en 1936 sa détermination de s'en tenir au traité de Locarno en cas d'agression contre la France ou la Belgique, qu'elle a commencé alors son grand réarmement aérien, que sa politique, au printemps et au cours de l'été de 1939, a été énergique. Il n'en reste pas moins que le souvenir des échecs contribue jusqu'à nos jours à ternir la réputation des dirigeants d'avant la guerre.
Ceux-ci avaient été plus sages dans leur politique impériale. Après l'adoption du statut de Westminster en 1931, les accords d'Ottawa de 1932, la constitution ultérieure d'une zone sterling (excluant le Canada), ils ont pratiqué une politique de consultation systématique des dominions ; seule l'Irlande du Sud de De Valera, qui a proclamé sa neutralité en 1938, n'interviendra pas aux côtés de la métropole en 1939. L'Inde a connu une conférence de la Table ronde à Londres, de 1931 à 1935, mais le nouveau statut de 1935 ne donne pas satisfaction aux nationalistes. Les Égyptiens qui, en 1936, signent avec l'Angleterre une « alliance » ne se sentent pas moins vassalisés qu'au temps, en 1914, où ils étaient devenus un protectorat du Royaume-Uni. L'empire est pourtant solidement tenu en main et son loyalisme a paru attesté lors des fêtes du couronnement de George VI en 1937.
Démocratie décadente aux yeux d'un Hitler, en tout cas solide et fière de libertés intérieures, rayonnant toujours sur le monde par sa langue et sa civilisation, elle offre, dans l'entre-deux-guerres, une floraison exceptionnelle de grands esprits, économistes comme J. M. Keynes, romanciers comme Aldous Huxley, jeunes poètes comme Stephen Spender, Cecil Day-Lewis, visionnaires sociaux comme George Orwell, héros de l'empire comme T. E. Lawrence, auteur en 1926 des Sept Piliers de la sagesse et prophète de l'alliance des peuples des sables et du peuple de la mer, sans oublier la reine du roman policier, Agatha Christie ! La Grande-Bretagne a encore une grande fierté de son destin. Le vieillissement de sa population, inexorable du fait de taux de natalité très bas, la prévision des experts qu'il n'y aurait plus vers 1970 que vingt-cinq ou trente millions de Britanniques nourrissaient cependant un pessimisme dont Arnold Joseph Toynbee commençait à se faire le porte-parole.
La Seconde Guerre mondiale
Dans ces conditions, la guerre a représenté un test suprême. La Grande-Bretagne peut s'enorgueillir d'avoir résisté seule entre l'armistice signé par le gouvernement Pétain, et appliqué le 25 juin 1940, et l'entrée en guerre de l'URSS, attaquée par l'Allemagne un an plus tard. Les États-Unis ne participent officiellement au conflit qu'après Pearl Harbor (7 décembre 1941). L'évacuation de Dunkerque, parachevée les 2 et 3 juin 1940, a rassemblé la nation dans un grand élan patriotique qu'a su incarner Churchill, devenu Premier ministre d'un gouvernement de coalition, le 10 mai ; on a parlé de l'« esprit de Dunkerque » pour signifier l'obligation d'une solidarité totale dans la guerre comme dans l'avenir, une fois la paix revenue. La bataille d'Angleterre a été gagnée grâce à la qualité des avions britanniques et à l'héroïsme des équipages, grâce aussi au radar et à l'erreur stratégique allemande qui a consisté à substituer au bombardement des installations militaires et des réseaux de communication celui de villes à terroriser. En Afrique, en Asie, de durs revers ont précédé les renversements décisifs, ainsi l'humiliante perte de Singapour devant les Japonais en février 1942. Parmi les leçons les plus évidentes du conflit : le rôle irremplaçable des États-Unis, qui, après la loi cash and carry de 1939, ont permis aux démocraties de s'approvisionner chez eux, après la loi « prêt-bail » de mars 1941 ont permis au Royaume-Uni de poursuivre ses achats sans les payer, ses caisses étant vides, et qui après leur entrée dans la guerre ont remporté des victoires navales et terrestres décisives ; c'est alors que naît l'esprit d'une « grande alliance » des peuples anglo-saxons et le mythe de liens privilégiés entre Angleterre et États-Unis. La guerre fait naître des espoirs et des programmes pour ses lendemains, tels les deux rapports Beveridge, le plus célèbre de 1942 sur les assurances sociales, et celui de 1944 sur « le plein-emploi dans une société de liberté ». En 1945, vainqueur quelque peu épuisé, le Royaume-Uni est heureux d'avoir pu compter sur le soutien actif de l'Empire, malgré les réticences des nationalistes hindous, les tentations d'opposition en Irak et en Égypte, la neutralité de l'Eire. Le destin mondial d'une puissance qui a tenu sa place dans toutes les grandes conférences, les dernières à Yalta et Potsdam (juill.-août), paraît indiscutable à tous les responsables politiques et à la haute administration.
Entre 1945 et 1987, la Grande-Bretagne a dû progressivement se résigner à un déclin mondial accompagné d'un repliement sur les îles métropolitaines, et se mettre en quête d'un destin nouveau qu'elle a choisi européen. À l'intérieur, elle a connu le développement d'un État-providence, bénéficiaire pendant longtemps d'un consensus entre les grandes forces politiques avant d'être remis en question par les néolibéraux.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Bertrand LEMONNIER : agrégé de l'Université, docteur en histoire, professeur de chaire supérieure au lycée Louis-le-Grand, Paris
- Roland MARX : professeur à l'université de Paris-III-Sorbonne nouvelle
- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis
Classification
Médias
Voir aussi
- RÉPARATIONS LES
- PARTIS COMMUNISTES
- ANTICOMMUNISME
- CULLODEN BATAILLE DE (16 avr. 1746)
- BAGDAD PACTE DE (1955) ou CENTO (Central Treaty Organization) ou MEDO (Middle East Defence Organization)
- MIGRANTS
- CRANMER THOMAS (1489-1556)
- SDN (Société des nations)
- MERCIE
- JACQUES Ier (1566-1625) roi d'Angleterre (1603-1625) et roi d'Écosse sous le nom de JACQUES VI (1567-1625)
- NAVIGATION ACTE DE (1651)
- ATLANTIQUE ALLIANCE
- PLANTAGENÊTS LES
- SUPRÉMATIE ACTE DE (1534)
- STUART LES
- RÉVOLUTION ANGLAISE PREMIÈRE (1641-1649)
- PITT WILLIAM, dit LE SECOND PITT (1759-1806)
- PITT WILLIAM, 1er comte de Chatham dit LE PREMIER PITT (1708-1778)
- COMMUNES CHAMBRE DES
- TUDOR LES
- GEORGE III (1738-1820) roi de Grande-Bretagne (1760-1801) puis du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande (1801-1820)
- GUILLAUME III (1650-1702) stathouder de Hollande (1674-1702) et roi d'Angleterre (1689-1702)
- LIBÉRAUX, Royaume-Uni
- LABOUR PARTY ou PARTI TRAVAILLISTE, Royaume-Uni
- JACOBITES, histoire de l'Écosse
- HADRIEN MUR D'
- ISLAMISME
- CEE (Communauté économique européenne)
- LIBRE-ÉCHANGE
- DOUANIÈRE POLITIQUE
- VOTE DROIT DE
- ENCLOSURE
- ESPIONNAGE
- IMPÉRIALISME & ANTI-IMPÉRIALISME
- TRAVAIL DES ENFANTS
- MIGRATIONS HISTOIRE DES
- TRADE UNIONS
- RÉARMEMENT
- SPEAKER, institutions politiques
- SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
- OUVRIÈRE CLASSE
- ATTENTAT
- MOYENNES CLASSES
- LUDDISME
- BRISEURS DE MACHINES
- MACHINE À VAPEUR
- ATLANTISME
- PAUVRETÉ
- UNIFORMITÉ ACTES D'
- DÉVOLUTION
- CONSEILS ROYAUX
- DOUANIÈRE UNION
- NORMANDS
- SINN FEIN
- MARCHANDS AU MOYEN ÂGE
- INÉGALITÉS ÉCONOMIQUES
- ANGLETERRE
- EUROPE, politique et économie
- DÉMOCRATISATION
- MARIAGE HOMOSEXUEL
- PARLEMENT CROUPION
- ANGLO-NORMAND ÉTAT
- LIBERTÉS & PRIVILÈGES
- ROYAUME-UNI, histoire, de 1801 à 1914
- ROYAUME-UNI, histoire, de 1914 à 1945
- ROYAUME-UNI, histoire, de 1945 à nos jours
- COMMUNICATION POLITIQUE
- ROMAINE EXPANSION
- RADICAUX ANGLAIS
- RÉFORME ÉCONOMIQUE
- ÉCONOMIE DIRIGÉE
- PLEIN-EMPLOI
- POLITIQUE MONÉTAIRE
- PRODUCTIVITÉ
- POLITIQUE ÉCONOMIQUE
- PARITÉ MONÉTAIRE
- SOCIAL-DÉMOCRATIE
- INDE, histoire : l'époque coloniale
- ANGLAIS DROIT
- URBANISATION
- TEXTILES INDUSTRIES
- ROYAUME-UNI, droit et institutions
- GRANDE-BRETAGNE, histoire, des origines au XIe s.
- GRANDE-BRETAGNE, histoire, le Moyen Âge de 1066 à 1485
- GRANDE-BRETAGNE, histoire, les Tudors (1485-1603)
- GRANDE-BRETAGNE, histoire, les Stuarts (1603-1714)
- ASSISTANCE SYSTÈMES D'
- GRANDE-BRETAGNE, histoire : XVIIIe s.
- GRANDE-BRETAGNE, histoire, de 1801 à 1914
- GRANDE-BRETAGNE, histoire, de 1914 à 1945
- GRANDE-BRETAGNE, histoire, de 1945 à nos jours
- BRITANNIQUE EMPIRE, Afrique
- BRITANNIQUE EMPIRE, Moyen-Orient
- PANDÉMIES
- COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
- IMMIGRATION
- ANGLAISE LITTÉRATURE, fin XIXe, XXe et XXIe s.
- BOOTH WILLIAM (1829-1912)
- VERSAILLES TRAITÉ DE (28 juin 1919)
- LANCASTRE LES
- O'CONNOR FEARGUS EDWARD (1796-1855)
- QUADRUPLE ALLIANCE (20 nov. 1815)
- ÉGLISE HISTOIRE DE L', du concile de Trente à nos jours
- ENSEIGNEMENT
- ÉVANGÉLISATION
- PENSÉE ÉCONOMIQUE HISTOIRE DE LA
- POLITIQUE FISCALE
- POLITIQUE SOCIALE
- DURÉE DU TRAVAIL
- SOCIALISTES MOUVEMENTS
- PRIVATISATION
- RUSSELL JOHN lord (1792-1878)
- BRITANNIQUE EMPIRE
- CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE
- ANGLO-IRLANDAIS ACCORDS (1985 et 1998)
- MAASTRICHT ou MAËSTRICHT TRAITÉ DE (1992)
- VACHE FOLLE MALADIE DE LA ou ESB (ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE)
- CLEGG NICK (1967- )
- MILIBAND ED (1969- )
- MAY THERESA (1956- )
- BREXIT
- JOHNSON BORIS (1964- )
- CHEQUERS PLAN DE (juill. 2018)
- UKIP (United Kingdom Independence Party) ou PARTI POUR L'INDÉPENDANCE DU ROYAUME-UNI, parti politique
- STARMER KEIR (1962- )