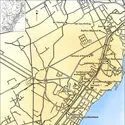SANCTUAIRE, Grèce hellénistique et Rome antique
Article modifié le
Sanctuaires et rituels à Rome
Membres de la cité, d'un collège ou d'une famille, les dieux des Romains résident sur terre, au milieu du peuple des humains. Selon leur statut, les sanctuaires qui leur servent de demeures sont construits par le peuple romain ou par des particuliers sur des terres publiques ou privées, et offrent le cadre de leur vie sociale. Noyau de la pratique religieuse, ces relations entre hommes et dieux sont régies par des « traditions rituelles » (ritusromanus, graecus, etc.), qui structurent, à côté d'autres impératifs formels, l'aménagement des espaces cultuels.
Avant d'étudier la distribution et la fonction des lieux du culte, il convient de faire deux remarques préliminaires. Qu'appelle-t-on, d'abord, un sanctuaire dans la Rome ancienne ? D'un point de vue formel, un sanctuaire n'est pas nécessairement un bâtiment, ni d'ailleurs simplement un lieu ou un édifice occupés par une divinité. En effet, tout lieu public ou privé peut servir de sanctuaire, de lieu de culte, pour peu qu'il y ait des hommes pour célébrer les rites : souvent un espace purifié avec un autel permanent ou portatif suffit. Toutefois, reconnaître une présence divine, dresser un autel, une chapelle, un temple, et célébrer un culte ne revient pas pour autant à créer un lieu sacré. En termes romains, seuls sont sanctuaires les terrains ou bâtiments consacrés par un magistrat du peuple romain, ou à défaut, en vertu d'une loi, ou par ceux que le peuple a élus à cette fin. Si ces règles ne sont pas respectées, la consécration et la dédicace ne sont pas valables, et on peut disposer librement de l'objet ou du lieu en question. Ainsi un autel, une chapelle et un lit sacré, dédiés en 120 avant notre ère par une vestale « sans l'ordre du peuple », furent détruits (Cicéron, Sur sa maison, LIII, 136 sqq.). Bien entendu, tant qu'un sanctuaire privé n'empiète pas sur les terres du peuple romain et n'engage que la communauté qui l'a aménagé et le patronne, qu'il s'agisse d'un collège professionnel, d'un groupe de militaires (voir le sanctuaire des sous-officiers à Osterburken, Bade Wurtemberg) ou d'une famille, sa dédicace est pleinement valable, à l'intérieur de ces limites, et la cité la cautionne comme telle.
Rites de fondation
Les premiers rituels dont un sanctuaire est le théâtre sont ceux de sa fondation, à commencer par les règles spatiales auxquelles il est soumis. En effet, un sanctuaire n'est pas élevé n'importe où. Comme les habitants de Rome, les dieux romains ne sont pas tout à fait égaux entre eux. Sans même parler de ceux qui, du haut du Capitole, gèrent et protègent la destinée du peuple romain, il y a les divinités considérées comme romaines « depuis toujours » (Jupiter, Junon, Minerve, Janus, Vesta...), et celles qui ont reçu le droit de cité à une date plus récente. Pour peu que leur fonction l'autorise, les dieux « anciens » établissent leur résidence principale dans la partie la plus intime de Rome, à l'intérieur du pomerium, limite archaïque englobant à la fin de la République l'aire comprise entre le forum, le Capitole, la vallée du Grand Cirque et le Tibre. Au-delà de cette ligne, rarement franchie sous la République par les divinités naturalisées, Cybèle par exemple, on trouve les nouveaux venus comme Apollon, Esculape, Hercule ou les dieux de l'Aventin, à côté de vieilles divinités comme Mars ou Vulcain qui ne peuvent être présentes qu'aux limites de l'espace habité. Les règles ont évolué sous l'Empire et sont devenues plus complexes puisque la ligne pomériale fut étendue à plusieurs reprises, au point d'englober des sanctuaires jadis exclus de la résidence privilégiée dans le premier cercle de la citoyenneté.
Les rites de fondation se déroulent une fois que la divinité a officiellement reçu un lot de terre et les moyens financiers pour aménager le templum avec ses édifices. Dans un premier temps, après la « définition », la « libération » du site (effatio et liberatio), et éventuellement son orientation par les augures, un magistrat (ou un dédicant élu) procède à la constitutio (l'installation) du sanctuaire. Tacite en a laissé une description vivante dans les pages consacrées à la reconstruction du temple de Jupiter capitolin en 70 (Histoires, iv, 53). Après des aspersions d'eau, l'aire sacrée est purifiée par un suovétaurile (un verrat, un bélier et un taureau), qui en fait le tour avant d'être sacrifié à Mars. Puis le magistrat appelle l'assistance divine et touche les câbles servant à la mise en place de la première pierre, effectuée par le peuple, pendant que des offrandes en métal précieux sont jetées dans les fondations. Une fois l'édifice construit, le magistrat procède à la dédicace (dedicatio), qui en fait une propriété définitivement divine. Les rites fondateurs ne sont évidemment pas quotidiens, mais, sous une forme mineure, ils sont couramment célébrés, chaque fois qu'un lieu sacré a été souillé, abîmé, foudroyé, ou qu'il doit supporter des travaux. En même temps, les sanctuaires reçoivent régulièrement des dons de la part du peuple romain, des magistrats ou des personnes qui les fréquentent. Qu'il s'agisse de simples ex-voto, de vaisselle cultuelle, d'autels, d'images divines et de leurs parures, de restaurations ou d'édifices entiers, tous ces dons entraînent des rites de dédicace, au point qu'il faut considérer ceux-ci comme les rites les plus courants des sanctuaires romains.
Au-delà de ces rites constitutifs, la vie liturgique des sanctuaires est multiforme. Elle consiste essentiellement en sacrifices offerts par des magistrats, des prêtres, et éventuellement des citoyens particuliers. Ces sacrifices animent quotidiennement les grands temples et sanctuaires. Étant donné la complexité, le nombre et la durée des sacrifices, certains lieux sacrés, comme les temples capitolins, sont utilisés sans interruption tous les jours, suivant un calendrier rituel fixe, complété par une série impressionnante de sacrifices circonstanciels. En revanche, d'autres temples urbains, suburbains ou extra-urbains ne sont fréquentés qu'à l'occasion de quelques fêtes. Ces disparités sont accrues par les rites propres à chaque culte. Néanmoins, en raison d'indéniables constantes, il est possible de tracer une image générale de l'occupation rituelle des lieux sacrés. Les sources privilégient le cas de Rome, et notamment les cultes publics de Rome, mais ceux-ci ont pu servir de modèles pour les sanctuaires privés autant que pour les temples publics des autres cités de l'Italie et de l'Empire, pour peu qu'ils appartiennent à des divinités du panthéon traditionnel romain.
Attributions rituelles des lieux sacrés
À côté des impératifs formels et esthétiques, ce sont des intentions rituelles et proprement religieuses qui déterminent la configuration et l'articulation des divers espaces d'un lieu sacré. Un sanctuaire comprend des aménagements spécifiques en vue des rituels, et des parties dont l'agencement paraît obéir à une intention religieuse plus large. Pour détecter les indices d'une finalité rituelle, les sources archéologiques sont d'un secours relatif, car les temples ou sanctuaires romains sont rarement fouillés et publiés entièrement, au point que beaucoup de plans donnent l'illusion que le culte était célébré dans la cella du sanctuaire. Or il est indéniable que les principaux rituels se déroulent à ciel ouvert, devant les temples et auprès de l'autel central. Cette règle n'empêche toutefois pas que certaines séquences de rites prennent place dans d'autres parties du sanctuaire, dans l'entrée, dans les portiques et même dans la cella du temple. La fonction des divers espaces sacrés dépend donc des rituels qui y sont célébrés, et la description d'un sacrifice illustrera leur rôle changeant.
Le sacrifice commence à l'extérieur de l'aire sacrée proprement dite. Avant l'ouverture du rite sacrificiel, les victimes y ont été choisies, nettoyées et décorées ; les participants se sont eux aussi purifiés par une ablution près d'une fontaine, éventuellement dans les thermes. À cette fin, ils disposent souvent d'une fontaine placée près du porche, comme par exemple devant le sanctuaire de la Bona Dea à Ostie, ou bien de bains situés en marge de l'aire centrale (voir les bains du bois sacré de Diane à Némi, ceux du bois sacré des arvales à Rome [membres d'une confrérie restaurée par Auguste, qui célébrait un culte agraire], ou ceux du temple d'Hercule à Ostie). D'ailleurs, il semble que l'aménagement rituel de l'aire sacrée comprenait souvent un autre puits, sans doute parce qu'une nouvelle purification était requise pour pénétrer dans la cella du temple ; d'ailleurs, les célébrants avaient généralement besoin d'eau tout au long des services religieux : en effet, ces puits se situent fréquemment au pied de la cella, comme par exemple à Osterburken, à Tarquinia (Ara della regina) et déjà à Pyrgi (temple A).
Après ces activités préparatoires, une procession se rend de l'entrée du templum à l'autel. Les sanctuaires bien conservés laissent supposer que la procession sacrificielle empruntait une voie spécifique, comme celle qui est attestée à Gabies, à Némi et à Osterburken. Il n'est pas audacieux de supposer qu'en milieu urbain, sur le forum romain par exemple, les cortèges empruntaient la vieille voie sacrée, à l'instar des augures. Arrivé près de l'autel, le cortège s'immobilise et les célébrants procèdent à l'« immolation » (c'est-à-dire à la consécration) de la victime, qui requiert la présence d'un foyer portatif à côté de l'autel. Ensuite, la victime, attachée à un anneau de fer fixé au pied de l'autel (comme par exemple dans le sanctuaire de Junon à Gabies), est abattue, ouverte et découpée. Nous ignorons pratiquement tout de ces opérations, mais il est certain que la découpe et notamment le traitement préliminaire des parts divines (la fressure, comprenant le foie, le péritoine, la vésicule biliaire, les poumons et le cœur) sont effectués à proximité de l'autel. La fressure est mise à bouillir ou à griller, suivant le type de victime, alors que les autres chairs de la victime reposent près de l'autel. Une fois la cuisson ou la grillade de la fressure arrivées à point, les célébrants versent la part divine dans le feu de l'autel. Rien ne les empêche d'offrir des parts de viande supplémentaires sur l'autel, ou bien dans la cella, sur une table placée devant l'image de la divinité. C'est ce qui se passe lors du sacrifice célébré par la confrérie des arvales où, une fois la fressure servie sur l'autel, les prêtres présentent des boulettes de foie (prélevé sur la fressure ?) à la déesse Dia, sur la table dressée dans son temple.
L'exemple de Dea Dia montre d'ailleurs qu'une divinité ne banquette jamais seule, tout comme son sanctuaire n'est jamais réservé à elle seule. Aucun dieu du panthéon romain ne vit seul. Chacun accueille dans sa résidence les collègues divins qui lui rendent service dans le sanctuaire (par exemple les nymphes patronnant l'eau courante des fontaines) ou dans l'exercice de ses pouvoirs (divinités fonctionnelles proches). La demeure d'une divinité peut ainsi recevoir plusieurs statues, et l'aire de son temple accueille généralement plusieurs autels et même des chapelles secondaires. L'aire du templum d'Osterburken, qui est vraisemblablement dédié à Jupiter, comprend une trentaine d'autels de Jupiter associé à d'autres divinités et une chapelle dédiée à la déesse Candida. Dans le bois sacré de Diane à Némi se dresse un temple dédié à Isis et Bubastis, et le bois sacré de Dia, à Rome, a abrité plus d'une quinzaine d'autres divinités, disposant chacune d'un autel dit temporaire. Enfin, sous l'Empire, les bois sacrés de Diane à Némi ou de Dea Dia à Rome, et la plupart des autres sanctuaires, accueillent comme invités ou comme associés les empereurs divinisés et le génie du prince régnant.
Une fois faites les offrandes aux dieux, pour peu qu'il ne s'agisse pas d'un sacrifice aux dieux d'en bas (dont les victimes sont entièrement brûlées), les célébrants « profanent » par attouchement les chairs des victimes. Ces chairs représentent la part des hommes. Selon la liturgie, elles sont partagées et consommées sur place, ou vendues en boucherie aux simples citoyens (peut-être dans les boutiques du sanctuaire). En tout cas, une partie au moins des chairs est consommée sur place par les magistrats ou par les prêtres chargés du rituel, étant donné que sacrifier signifie pour les Romains banqueter avec les dieux. Ces banquets sont consommés sur des lits de table dressés sous les portiques, sur les aires ou dans les salles annexes des sanctuaires : c'est à cette fonction qu'a servi le triclinium flanquant le temple des Augustales, à Misène, récemment découvert. Les procès-verbaux des frères arvales et des dédicaces à Jupiter Dolichenus à Rome mentionnent les salles de banquet ; de nombreuses inscriptions précisent, par ailleurs, que les sanctuaires comprennent régulièrement une cuisine.
Toutes ces installations ne concernent évidemment que les rites communs à la plupart des cultes. Il va de soi que tout sanctuaire comporte des aménagements particuliers au service du dieu qui l'habite. Les divinités oraculaires ou guérisseuses disposent par exemple d'un puits des sorts, comme à Préneste, de portiques, où les consultants passent la nuit en attendant que la divinité leur apparaisse pendant leur sommeil, comme par exemple dans le « bâtiment allongé » de Lydney Park, dans le Gloucestershire, et bien sûr dans le fameux Asklépiéion de Pergame. Sans parler de l'agencement spécifique des temples patronnés par les dieux égyptiens, anatoliens ou syriens.
Les aménagements proprement rituels d'un sanctuaire sont fréquemment complétés par une aire réservée aux jeux sacrés. En milieu urbain, les jeux sont célébrés soit dans les bâtiments publics indépendants (comme le Grand Cirque, le théâtre de Marcellus, l'odéon de Domitien), soit dans des édifices temporaires dressés en marge du sanctuaire (par exemple les théâtres de bois de l'ère républicaine). L'association des cirques et des théâtres aux lieux sacrés est particulièrement visible dans les sanctuaires extra-urbains, où le templum est le plus souvent adjacent à un théâtre (à Némi, Gabies, Pietrabbondante...) ou à un cirque (bois sacré de Dea Dia, sanctuaire de la gens Julia à Bovillae).
Fonctions symboliques de l'espace
Au-delà des fonctions rituelles, des fins esthétiques et urbanistiques, l'articulation des divers espaces d'un sanctuaire obéit sans doute encore à d'autres règles religieuses. Dans une religion ritualiste comme celle des Romains, tout élément du culte, les gestes et paroles du rituel aussi bien que l'agencement même du lieu sacré participent à l'énonciation de représentations religieuses. En raison de sa riche documentation, un lieu saint comme le bois sacré de Dea Dia (La Magliana, Rome) livre quelques indications sur les énoncés religieux attachés à l'articulation des espaces cultuels et transmis par eux.
Trois secteurs bien définis du sanctuaire de La Magliana servent au culte : le bois sacré (lucus) de la déesse, le Caesareum, espace consacré aux empereurs divinisés et au génie du prince régnant, ainsi qu'un secteur réservé aux pavillons (papiliones) et au bain des prêtres. À proximité des deux derniers bâtiments est aménagé un cirque.
L'étude de divers rituels concernant le bois sacré montre que celui-ci ne peut être soumis à aucune violation et ne peut contenir ni corps ni végétal morts ou impurs. Conformément à la nature immortelle et céleste de sa propriétaire, le bois sacré doit rester à l'écart de la mort et de l'impureté. Avant de pénétrer dans ce bois pour y célébrer le sacrifice annuel, les prêtres offrent, d'autre part, des sacrifices expiatoires pour signaler à la déesse et lui demander d'excuser les travaux d'élagage symbolique accomplis au même instant. Ces rituels tendent à montrer qu'un bois sacré (étymologiquement « clairière », notamment « clairière destinée au culte ») est un bois bien entretenu, mais non exploité, où l'homme ne pénètre qu'avec précaution et à des fins cultuelles. Ce bois comporte une clairière réservée au culte. Ainsi, le templum de Junon à Gabies contient sans doute un lucus, avec sa clairière : l'espace sur lequel est construit le sanctuaire de la déesse. Au fond, un bois sacré peut être défini comme un espace cultuel entouré d'arbres ; ce n'est pas simplement un bois. D'ailleurs, on trouve parfois un lucus à l'intérieur d'un bois exploité (nemus), comme à Némi, où le bois sacré de Diane désigne à proprement parler la terrasse du sanctuaire.
L'examen des rites célébrés au lucus de Dia, joint à celui des règlements d'autres bois sacrés, montre que l'on ne pénètre dans ces endroits qu'à des fins rituelles. Pour cette raison, beaucoup d'aires sacrées comportent des voies pavées, bien délimitées, et des portiques communiquant directement avec l'extérieur, comme à Gabies ou à Némi. Tout paraît suggérer qu'à l'exclusion des prêtres, des célébrants, du sénat (qui se réunissait à l'occasion dans la cella d'un temple), et de ceux qui en ont reçu l'autorisation expresse des prêtres, personne ne viole cet espace strictement « privé » de la divinité, au moins pendant la célébration du culte.
Construit en marge du bois sacré de Dia et consacré aux empereurs divinisés, le Caesareum n'est l'objet d'aucune restriction d'accès ; il sert même de siège officiel aux prêtres, qui se réunissent devant les statues impériales pour les rites préliminaires et y retournent après le sacrifice, offert dans le bois sacré, pour consommer le banquet sacrificiel. On notera aussi que le collège d'Esculape et d'Hygie, à Rome, prend ses décrets au templum des empereurs divinisés (appelé également porticus diuorum), dans la chapelle de Titus.
Enfin, le troisième secteur du sanctuaire de Dea Dia appartient aux prêtres eux-mêmes. Apparemment non consacré, il est réservé aux activités « privées », ou plutôt humaines, de ceux-ci : le repos entre les rituels et les soins du corps (bain, changements de costume). Le cirque, quant à lui, occupe une position intermédiaire proche de celle du Caesareum : séparé du bois sacré et ouvert à tous, il est néanmoins le siège de rites sacrificiels. Les trois espaces, le lucus, le Caesareum et le portique des prêtres, sont clairement hiérarchisés, en tout cas à l'époque impériale, puisqu'ils forment une suite de terrasses communicantes.
Ce type de plan, qui n'est pas sans parallèles, paraît traduire ou respecter la représentation traditionnelle de la pyramide des êtres. En bas, l'espace des hommes, plus haut, le Caesareum des empereurs divinisés, immortels et supérieurs aux hommes, mais proches de ceux-ci ; enfin, au sommet, le bois sacré de la déesse, où les hommes pénètrent exceptionnellement, et où seuls d'autres dieux ou les empereurs divinisés peuvent élire résidence en tant qu'invités. Cette partition spatiale, très claire sur ce site extra-urbain, plus subtile dans les sanctuaires urbains, est en tous points homologue à la hiérarchie des êtres, telle qu'elle est transmise par la pensée et par le rituel des Anciens.
Les lieux sacrés, leur aménagement, les statuts et les rapports de leurs espaces sont manifestement des lieux privilégiés pour étudier et saisir le fonctionnement des religions traditionnelles du monde classique. Dans un système ritualiste sans dogmes révélés, des signes aussi massifs de la présence divine ne pouvaient pas demeurer muets : autant que les gestes et les paroles du rituel, les sanctuaires énonçaient des vérités sur le système du monde. Construits en vue du rituel, ils étaient eux-mêmes conçus comme un énoncé religieux qui s'offrait, avec les rituels, à la libre pensée exégétique des Romains. On devine sans difficulté le riche champ de possibilités ouvert aux maîtres de Rome pour instiller dans le faisceau des signes incitant à l'exégèse des nuances, qui faisaient de l'explication du monde la justification de leur propre pouvoir, sans porter atteinte au corpus des traditions les plus vénérables.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Pierre GROS : chaire de civilisation et archéologie romaines à l'Institut universitaire de France, université de Provence-Aix-Marseille-I
- John SCHEID : directeur d'études à l'École pratique des hautes études (Ve section)
Classification
Médias
Autres références
-
BAALBEK
- Écrit par Claude NICOLET
- 718 mots
- 2 médias
-
CARTHAGE
- Écrit par Abdel Majid ENNABLI , Liliane ENNABLI , Encyclopædia Universalis et Gilbert-Charles PICARD
- 9 844 mots
- 5 médias
Un autre témoignage important de la Carthage punique est le « tophet »,sanctuaire de Tanit et de Baal Hamon. On sait par diverses sources antiques que les Carthaginois pratiquaient des sacrifices de jeunes enfants en l'honneur de divinités tutélaires de la ville. C'est par hasard que ce lieu... -
DELPHES
- Écrit par Bernard HOLTZMANN et Giulia SISSA
- 9 621 mots
- 9 médias
Pour les Grecs, Delphes était le centre géographique du monde : les deux aigles dépêchés par Zeus depuis les bords du disque terrestre s'y étaient rejoints. Aussi le nombril ( omphalos) terrestre y était-il représenté dans la fosse oraculaire ( adyton) du temple sous la forme d'une...
-
DIDYMES
- Écrit par Martine Hélène FOURMONT
- 1 224 mots
La célébrité de Didymes est due au sanctuaire d'Apollon Didymaios, le Didyméion,, implanté en bordure des côtes égéennes, à 17 kilomètres environ au sud de Milet, dont il était dépendant. Il appartenait d'abord à la famille des Branchides, puis il devint le plus grand sanctuaire de la cité,...
- Afficher les 18 références
Voir aussi
- DIEUX & DÉESSES
- PURIFICATION
- TRIGLYPHE
- MÉTOPE
- DÉAMBULATOIRE
- HELLÉNISTIQUE ART
- STATUE DE CULTE
- GRECQUE RELIGION
- DÉDICACE
- HYPOSTYLE, architecture
- ROMAINE RELIGION
- LIEUX SACRÉS
- TEMPLE, Grèce antique
- TEMPLE, Rome antique
- PROCESSION RITUELLE
- DEA DIA, religion romaine
- JEUX ANTIQUES
- MODULE, architecture
- CELLA
- ART & MATHÉMATIQUE
- ROMAINE ARCHITECTURE
- GRECQUE ARCHITECTURE
- COLONNADE
- PRONAOS
- DIPTÈRE, architecture
- PÉRIPTÈRE, architecture
- BOIS SACRÉ
- SANCTUAIRE
- ARCHITECTURE RELIGIEUSE