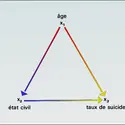SCIENCES Science et progrès
Article modifié le
Le Progrès « par » la Science ?
Qu'en est-il alors de l'idée que le Progrès humain (avec une majuscule) puisse être assuré par la Science ? Certes, jamais le savoir technoscientifique n'a acquis autant d'efficacité pratique. Des découvertes fondamentales débouchent désormais sur des innovations techniques à grande diffusion : les principes si étranges de la théorie quantique prennent corps dans les lasers, qui lisent les disques compacts ou servent aux découpes industrielles ; les sciences de l'information sous-tendent le déploiement de l'informatique de masse et des télécommunications ; la biologie moléculaire commence à trouver des applications médicales (thérapies géniques). Car la décrue budgétaire évoquée plus haut ne saurait être interprétée comme un désintéressement de l'industrie pour la recherche, mais au contraire comme la quête d'un intéressement beaucoup plus concret et immédiat. En témoigne justement l'attention très étroite portée par les industries pharmaceutiques et chimiques aux recherches en génétique moléculaire, allant jusqu'à faire de certaines séquences du génome humain l'objet de brevets commercialisables ou à concevoir des médicaments « ethniques » (B. Jordan, 2008). En d'autres termes, la continuité même d'une activité de recherche scientifique fondamentale, non orientée vers le profit immédiat et non contrôlée par le marché, est désormais en cause. D'ailleurs, la relative stagnation des découvertes fondamentales que nous avons signalée s'accompagne d'un net découplage entre science et technique, au sens où bien peu des innovations technologiques actuelles se font sur la base d'une connaissance approfondie des phénomènes mis en jeu. Au fond, la fécondation de la technique par la science, plus récente qu'on ne veut bien le dire (elle ne remonte guère plus avant que le milieu du xixe siècle), semble perdre sa dynamique, et le développement de la technique reprendre une autonomie qui l'a caractérisé pendant presque toute l'histoire humaine. La recherche technoscientifique elle-même produit plus de savoir-faire que de savoirs, et le progrès technique retrouve nombre des traits qui le caractérisaient avant la « révolution scientifique ».
Au surplus, les connaissances scientifiques se montrent de moins en moins utiles face aux problèmes (santé, alimentation, paix) de l'humanité dans son ensemble. L'efficacité sociale de la technoscience plafonne, faute de trouver dans la plupart des pays les conditions économiques et politiques qui permettraient son utilisation effective. D'ailleurs, ce sont des savoirs et des savoir-faire connus depuis assez longtemps qui permettraient le plus souvent de répondre aux besoins essentiels de la majorité de l'humanité en matière de santé (traiter les parasitoses et les maladies infectieuses, améliorer l'hygiène pour diminuer la mortalité infantile), d'alimentation (développer les cultures vivrières, accroître les rendements, équilibrer les régimes alimentaires) ou de logement (promouvoir des techniques de construction légères et à bon marché). Non seulement la technoscience des pays riches ne contribue-t-elle que peu à résoudre les problèmes des pays pauvres, mais ce sont souvent ces derniers qui aident les premiers ; ainsi le phénomène constant de « fuite des cerveaux » permet-il aux États-Unis de faire réaliser l'essentiel de leur recherche scientifique (dans le domaine biomédical en particulier) par des chercheurs issus d'Asie et d'Amérique latine ; ainsi encore, les ressources naturelles, végétales surtout, de nombreux pays tropicaux sont-elles exploitées par de grandes multinationales, de l'industrie pharmaceutique en particulier, avec très peu de contrôle et encore moins de bénéfices pour ces pays (M. Bouguerra, 1993).
Si l'organisation et la pratique industrielles de la science ne lui permettent guère d'impulser le progrès social, ne peut-on au moins espérer que, de par ses vertus intellectuelles, sinon morales, elle puisse jouer ce rôle éclairant que lui attribuait d'Alembert ? N'est-elle pas effectivement une arme contre la superstition et l'obscurantisme ? En d'autres termes, ne doit-elle pas assumer une mission culturelle majeure ? Mais faut-il vraiment insister sur l'ironie de la conjoncture médiatique, qui voit les moyens de communication modernes déployer une variété et une efficacité toujours plus grande grâce à l'apport des technosciences, pour n'offrir qu'une portion toujours plus congrue à la diffusion de leurs principes de base. Les ondes électromagnétiques, les tubes cathodiques, les puces électroniques, les algorithmes informatiques, etc., qui sont derrière les écrans des téléviseurs et des ordinateurs, ne passent que bien rarement devant pour s'exposer et s'expliquer au vu et au su de leurs utilisateurs. Même les technologies plus traditionnelles, comme celles de l'automobile, deviennent plus opaques et moins accessibles aux yeux et aux mains des usagers. Point n'est besoin d'aller au fond de l'espace pour trouver des trous noirs d'où aucune information ne ressort : la plupart des objets techniques modernes en sont de bons exemples. Mais, plus encore que la croissante difficulté de nos sociétés à partager le savoir technoscientifique, c'est leur incapacité à diffuser les valeurs de rationalité et d'esprit critique sur lesquelles se fonde ce savoir qui témoigne de sa situation paradoxale. Rien ne démontre mieux la faillite des espoirs d'un rationalisme naïf que la parfaite compatibilité de la science moderne et des fanatismes nouveaux, au détriment des traditions culturelles (et scientifiques !) les plus riches et les plus ouvertes. En terre d'Islam (F. Faouzia Charfi, 1995), c'est dans les facultés des sciences, les écoles d'ingénieurs et les instituts techniques que l'intégrisme recrute le plus aisément, et c'est souvent vers l'informatique que se dirigent les jeunes juifs orthodoxes les plus intolérants (comme l'assassin d'Itzhak Rabin). La secte japonaise Aum Shinri-kyo a largement recruté dans les milieux scientifiques, son culte avait une forte dimension technique (on se rappelle les casques à électrodes de ses adeptes) et ses locaux disposaient d'équipements scientifiques perfectionnés, en électronique et, bien sûr, en chimie. L'édition offre des exemples moins dramatiques, mais emblématiques : l'un des agents littéraires américains, spécialisé dans le livre scientifique grand public, affiche à son catalogue à la fois des ouvrages de chercheurs réputés (Gell-Mann, Eldredge, Dennett...) et des textes qui conjuguent ésotérisme et scientisme de la façon la plus primaire qui soit : Physique et métaphysique de la présence spirituelle ou bien La Physique de l'immortalité. La cosmologie moderne et la résurrection des morts, équations à l'appui ; en France, Dieu et la science ont voici quelques années conclu une piètre alliance chez un éditeur respectable. La résurgence, aux États-Unis tout particulièrement, des courants créationnistes et de leur forme moderne rebaptisée Intelligent Design a témoigné, en 2009, année de célébration de l'anniversaire de la naissance et de l'œuvre de Darwin, de la même incapacité du savoir scientifique à s'installer au cœur de la culture contemporaine (J.-M. Lévy-Leblond, 2004). Ici, il faut bien le dire, la raison s'affronte en même temps à l'économie et à l'idéologie. Dans la confusion ambiante, il est à craindre que soient bien mal perçues, et que se voient même parfois travesties, les rares tentatives pour sortir des affrontements stériles entre un rationalisme étroit et un fidéisme naïf (H. Atlan, 1986).
Nous sommes enfin amenés à nous poser la question du rôle de la science, non pas seulement comme pourvoyeuse de connaissances, mais comme modèle idéal de comportement humain. On a longtemps entretenu une image de la science comme parangon de vertu, où régnerait le seul empire de la raison et de la bonne foi, où les désaccords se régleraient par la libre discussion, où le dévouement au bien public et l'avancement des connaissances seraient par essence liés. La formulation, encore souvent avancée, de « communauté scientifique » traduit bien cette vision idéale ; elle est pourtant sérieusement mise à mal dans la réalité, où la hiérarchisation des tâches et des responsabilités est aussi importante dans les laboratoires que dans les usines, et où les rivalités – entre équipes, entre disciplines, entre nations – sont intenses. Il suffit de lire la presse, et en particulier la presse scientifique professionnelle, pour constater la prégnance des affaires de fraude qui ne cessent de défrayer la chronique, des querelles de priorité, des abus médiatiques ; l'affaire Reuben, qui a secoué le monde de la recherche pharmacologique en 2009, en est une illustration parlante. Que l'activité scientifique ne soit pas à l'écart des rapports de forces, des luttes d'intérêt, des ambitions de pouvoir ne saurait sérieusement être contesté aujourd'hui. Comment en serait-il autrement alors que la recherche scientifique joue un rôle de premier plan dans certains des problèmes sociaux les plus délicats d'aujourd'hui, qu'il s'agisse des nouvelles épidémies (du sida à la grippe A), des affaires de contamination sanguine, du dopage sportif, etc. ? Non, la collectivité (préférons ce terme, plus sobre, à celui de communauté) scientifique n'est pas cette cité idéale, cette Jérusalem céleste et laïque à la fois, qui pourrait servir de modèle à une société pacifiée.
Mais la reconnaissance réaliste que la science est dans la cité et ne peut lui servir de modèle idéal fait disparaître un paradoxe capital qui minait sournoisement la possibilité même de penser avec quelque cohérence les rapports entre le projet démocratique et la quête scientifique. De fait, si la science était source de cette vérité universelle et de cette objectivité absolue à laquelle elle a prétendu, loin de fonder l'idée démocratique, elle en démontrerait l'inanité. Les thuriféraires de la science ont assez insisté eux-mêmes sur la nature prétendument intrinsèque de sa vérité, indépendante de toute subjectivité, individuelle ou collective. C'est en dépassant le cadre de l'opinion, en refusant la domination de la doxa que la science est censée produire du vrai incontestable : on peut avoir raison contre tous, et finir par les en convaincre – non par la persuasion, mais par la preuve. On ne vote pas pour décider de la validité d'un théorème, et les lois physiques ne sont pas soumises à ratification par une quelconque assemblée représentative – telle est en tout cas la vision conventionnelle de la pratique scientifique. Quoi donc de moinsdémocratique que ces procédures fondées sur la certitude d'une vérité préétablie qui n'est pas à produire mais à découvrir, et qui prétend n'être en rien dépendante des intérêts ou des projets humains ? La démocratie ne se fonde-t-elle pas, à l'inverse, sur la reconnaissance qu'il n'y a pas de vérité politique abstraite et préalable à l'affrontement des opinions ? Le débat démocratique est une technique de décision sociale qui ne prend son sens et sa force qu'une fois admise la large ignorance dans laquelle nous sommes des tenants et aboutissants de nos comportements collectifs. La vision illuministe de la science, sa conception dogmatique conduisent tout naturellement non au pari démocratique, avec son insécurité permanente, mais à la tranquillité du despotisme éclairé : nul hasard historique si Diderot et Voltaire ont fait la cour de (et à) Catherine II de Russie et Frédéric II de Prusse. On peut aussi relire aujourd'hui Renan, qui, en 1848, dès le début de L'Avenir de la science, annonçait clairement son programme : « organiser scientifiquement l'humanité [les majuscules sont de l'auteur], tel est donc le dernier mot de la science moderne, telle est son audacieuse, mais légitime prétention. » Il explicitera sa pensée dans ses Dialogues philosophiques, écrits, comme par hasard, à Versailles, en mai 1871, pendant la Commune : « Les pays où il y a des classes marquées sont les meilleurs pour les savants ; car, dans de tels pays, ils n'ont ni devoirs politiques, ni devoirs de société, rien ne les fausse. Voilà enfin pourquoi le savant s'incline volontiers (non sans quelque ironie) devant les gens de guerre et les gens du monde. » Mieux encore : « Si l'on veut imaginer quelque chose de solide, il faut concevoir un petit nombre de sages tenant l'humanité par des moyens qui seraient leur secret et dont la masse ne pourrait se servir, parce qu'ils supposeraient une trop forte dose de science abstraite. »
Or la science, mieux vaut s'en réjouir que le déplorer, n'est pascette source sacrée et infaillible de la vérité théorique et de l'efficacité pratique. Aucune essence épistémologique ne la prémunit contre la multiplicité des contingences et contradictions de toute activité sociale. La spécificité de ses buts et de ses méthodes est assez incontestable pour qu'il ne soit en rien nécessaire de la séparer, au sein d'une tour d'ivoire, des autres faits et gestes de la cité. Si la question de la vérité ou, au moins, de la validité de ses résultats garde un sens autonome et interne à ses pratiques, il n'en va pas de même quant à la pertinence de ces mêmes résultats, au choix de ses orientations, aux formes de son organisation, à l'intérêt de ses acteurs (et à leurs intérêts). À ce niveau, elle est soumise à l'emprise directe de l'économique, du social, du politique et de l'idéologique. Mais cette reconnaissance de l'absence d'autonomie de l'activité scientifique à la fois sape l'illusoire caution théorique du projet démocratique par la science et dissipe le réel paradoxe conceptuel auquel se heurtait cette prétention. Si la science ne peut plus prétendre inspirer ou guider la démocratie, elle ne peut plus non plus lui être un obstacle. Que le choix démocratique aujourd'hui ait besoin sur nombre de questions d'informations scientifiques ou de moyens techniques, rien de plus évident. Que ces nécessaires expertises soient suffisantes, ou même cruciales, rien de moins certain. Car la science, maintenant, pose plus de questions qu'elle n'en peut résoudre, et élimine plus de fausses réponses qu'elle n'en peut donner de vraies – et cela est déjà beaucoup. Oui, c'est la recherche scientifique qui nous a alertés sur le trou d'ozone, l'effet de serre, l'hiver nucléaire, le sida, les menaces pesant sur la biodiversité – pour s'en tenir aux gros titres des journaux. Mais c'est elle aussi qui se révèle incapable de conclure rapidement et assurément à l'étendue et aux causes de ces dangers – sans même parler des moyens d'y faire face. Constatons ses limites au lieu d'en attendre des miracles, puis de lui reprocher son impuissance. L'illusion de l'expertise ainsi dissipée éloigne la tentation de l'« expertocratie » – néologisme anglo-saxon aussi redoutable que ce qu'il désigne, forme moderne du despotisme (prétendument) éclairé.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean-Marc LÉVY-LEBLOND : professeur émérite à l'université de Nice
Autres références
-
SCIENCE (notions de base)
- Écrit par Philippe GRANAROLO
- 3 558 mots
En raison de son indiscutable progression, et du fait de ses multiples applications techniques qui ont considérablement bouleversé nos vies, la « science » est un terme générique paré d’un immense prestige. On peut du même coup se demander si le recours à ce mot n’a pas trop souvent pour objectif...
-
SCIENCE, notion de
- Écrit par Jean-Paul THOMAS
- 1 954 mots
- 1 média
La science désigne traditionnellement, pour les philosophes, une opération de l'esprit permettant d'atteindre une connaissance stable et fondée. Platon (428 env.-env. 347 av. J.-C.) oppose ainsi, dans le livre V de La République, la science et l'opinion, cette dernière réputée changeante...
-
ANALOGIE
- Écrit par Pierre DELATTRE , Encyclopædia Universalis et Alain de LIBERA
- 10 429 mots
Tout langage de description ou d'interprétation théorique utilisé dans lessciences de la nature comporte une sémantique et une syntaxe, la première portant sur les « objets » que l'on met en relation, la seconde sur ces relations elles-mêmes. Les données sémantiques sont au fond des ... -
ANTHROPOLOGIE DES SCIENCES
- Écrit par Sophie HOUDART
- 3 546 mots
- 1 média
L’anthropologie des sciences constitue, au sein de l’anthropologie sociale, le champ d’étude relatif aux faits de savoir, notamment naturels (botanique et zoologie au premier chef). Elle peut être saisie au sein d’une double généalogie : celle des ethnosciences d’une part ; celle de la sociologie...
-
ARCHÉOLOGIE (Traitement et interprétation) - Les modèles interprétatifs
- Écrit par Jean-Paul DEMOULE
- 2 426 mots
L'archéologie ne saurait se résumer à la simple collecte d'objets contenus dans le sol. Elle ne saurait non plus se cantonner, comme elle l'a longtemps été, au rôle d'une « auxiliaire de l'histoire », incapable par elle-même d'interpréter ses propres documents. Toute science dispose à la fois de faits...
-
CAUSALITÉ
- Écrit par Raymond BOUDON , Marie GAUTIER et Bertrand SAINT-SERNIN
- 12 990 mots
- 3 médias
Le cheminement de la notion métaphysique à un principe utilisable en sciences a été graduel et lent : il a fallu, du côté de la philosophie, restreindre les ambitions ; et, du côté des sciences, clarifier les principes et instituer des expériences. - Afficher les 62 références
Voir aussi