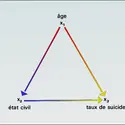SCIENCES Sciences et discours rationnel
Article modifié le
Le type empirico-formel
Le modèle par excellence des sciences de type empirico-formel est fourni par la physique. À la différence des sciences formelles pures, qui construisent entièrement leur objet (ou, plus exactement, ne le découvrent qu'en le construisant), la physique se rapporte à un objet extérieur, qui est donné dans l'expérience empirique : la réalité matérielle, considérée dans ses manifestations non vivantes. De plus, elle a recours à des constructions théoriques, qui sont analogues à celles des sciences formelles, et qui utilisent du reste très largement des théories mathématiques. Il y a donc deux composantes dans la science physique : une composante théorique, de nature formelle, et une composante expérimentale, de nature empirique. On peut à bon droit parler à son sujet d'un savoir empirico-formel. La question essentielle que soulève un tel savoir est celle de l'articulation entre ses deux composantes. Le développement de la physique a fait voir de façon très évidente qu'on ne peut rendre compte du statut de la théorie physique dans les termes d'une doctrine de l'induction. La théorie n'est nullement le résultat d'une démarche de généralisation à partir de cas individuels. Elle est le produit d'une construction intellectuelle, dans laquelle peuvent intervenir des analogies suggérées par l'expérience, mais qui, comme telle, est indépendante des données empiriques et se laisse guider par des principes organisateurs qui sont eux-mêmes de nature formelle. (C'est ainsi que les « principes de relativité » jouent un rôle fort important dans l'élaboration des théories physiques. De tels principes ne fournissent pas un contenu, mais représentent une prescription quant à la forme de la théorie à construire : les relations fondamentales de celle-ci doivent être invariantes par rapport à certaines transformations.) À l'égard du domaine empirique à explorer, la théorie représente un véritable « a priori ». Mais il n'en reste pas moins qu'elle doit pouvoir s'appliquer à la réalité physique, qu'elle doit avoir une portée cognitive effective quant aux contenus empiriques. Il s'agit d'expliquer comment.
Il est utile, pour éclairer ce problème, d'examiner le fonctionnement de la physique du point de vue de l'analyse du langage. La physique utilise deux espèces de langage, l'un théorique, l'autre expérimental.
Le langage théorique contient des termes purement logiques, des termes mathématiques, et un certain nombre de termes, qu'on pourra appeler « descriptifs » pour les opposer aux précédents et qui correspondent au contenu proprement physique de la théorie. Au moyen de ces termes peuvent être formées des propositions. Dans le cadre de ce langage se trouve formulée la théorie proprement dite, qui consiste en une classe, engendrée axiomatiquement, de propositions du langage. Certaines propositions sont choisies comme axiomes ; elles expriment le contenu essentiel de la théorie. Les autres en découlent par application des règles de déduction couramment admises (éventuellement spécifiées). De ce point de vue, la théorie fonctionne comme n'importe quel système formel. Mais, pour avoir le statut d'une théorie physique, elle doit être munie d'une interprétation et, en outre, elle doit pouvoir être mise en relation avec le langage expérimental. C'est à ce niveau que se posent les problèmes les plus difficiles.
Selon le point de vue empiriste strict, qui caractérisait le néo-positivisme du début, les seuls contenus de connaissance que nous puissions acquérir nous sont donnés par les impressions sensibles. Seuls, par conséquent, les termes observationnels (correspondant à un contenu d'observation bien déterminé) ont un sens immédiat. Les autres termes descriptifs (non formels) n'ont qu'un sens dérivé, qui doit être spécifié par « réduction » à des termes observationnels. D'autre part, les résultats des observations sont formulés dans des propositions de base, les « propositions protocolaires » ; une théorie est « vérifiée » dans la mesure où elle s'accorde avec cette base observationnelle. Or, le mécanisme proposé pour la « réduction » des termes descriptifs théoriques correspond exactement au processus de la vérification des propositions théoriques dans lesquelles figurent ces termes. Il y a donc identification du problème de l'interprétation et de celui de la mise à l'épreuve. Cette façon de voir réduit le langage théorique à n'être qu'une sorte d'expédient, un détour plus ou moins commode qui permet de relier entre eux des résultats d'observation. Elle ne fait pas droit à l'autonomie de la théorie et à son contenu propre de signification, et soulève des difficultés telles qu'une nette dissociation des deux problèmes semble s'imposer.
L'interprétation d'une théorie est un problème sémantique, sa mise à l'épreuve un problème méthodologique. La méthode couramment utilisée pour interpréter une théorie consiste à construire un « modèle ». Le modèle joue en quelque sorte le rôle d'un intermédiaire entre la théorie et la réalité physique. Il est constitué d'entités idéales, supposées dotées de certaines propriétés et reliées par certaines relations. Les termes descriptifs de la théorie sont mis en correspondance avec les composantes du modèle (entités, propriétés, relations) de manière telle que les axiomes de la théorie sont vérifiés par les entités du modèle. C'est ce qui justifie l'usage du terme par lequel on le désigne : il constitue comme une réalisation concrète de la structure formelle décrite par la théorie. Mais, d'un autre côté, le modèle présente une sorte de schématisation de la réalité étudiée. Par son intermédiaire, les termes descriptifs de la théorie se trouvent donc rapportés à celle-ci. Toutefois, les aspects de la réalité auxquels renvoient ainsi les termes théoriques ne sont pas nécessairement observables. (Ainsi, à la théorie de la mécanique est associé un modèle constitué de « points matériels », doués de masse et entre lesquels s'exercent des interactions. Ces « points » représentent de façon idéalisée les corps matériels. Leur « masse » représente l'inertie des corps réels. Il s'agit là d'une propriété qui n'est pas observable et sur laquelle on ne peut obtenir des informations que de façon indirecte, en s'appuyant d'ailleurs sur les relations posées par la théorie.)
La mise à l'épreuve d'une théorie fait intervenir le langage expérimental. Celui-ci contient toutes les ressources nécessaires pour décrire les manœuvres expérimentales et leurs résultats. Or, un résultat d' expérience ne consiste nullement en « données » observationnelles pures, il est toujours déjà une interprétation du « donné ». C'est dire que le langage expérimental doit comporter non seulement des termes observationnels, mais également des termes relatifs à des aspects non observables du réel, qui ne sont utilisables que moyennant l'intervention de certaines propositions théoriques. La mise à l'épreuve d'une théorie fait nécessairement entrer en jeu d'autres théories, et elle n'est concluante que dans la mesure où ces dernières sont considérées comme suffisamment validées. En outre, si les propositions expérimentales ont toujours le caractère d'une reconstruction, si elles ne sont pas simplement la transcription verbale d'un enregistrement sensoriel, on ne peut admettre qu'il y ait parmi elles des « propositions de base » qui constitueraient comme un noyau de connaissance définitif et irréformable. Toute proposition expérimentale peut être soumise à révision ; si elle est acceptée à un moment donné, ce n'est pas parce qu'elle aurait un caractère ultime, mais simplement parce qu'elle répond aux critères qui sont acceptés à ce moment en matière de rigueur expérimentale. Ces critères sont relatifs à l'état des connaissances et évoluent avec lui, ils varient d'ailleurs d'un domaine à un autre. (Ainsi, le degré de précision exigé dépendra de l'ordre de grandeur du phénomène étudié.)
Pour mettre une théorie à l'épreuve, on compare certaines des propositions que l'on peut déduire de ses axiomes (moyennant l'intervention de certaines propositions expérimentales, exprimant des « conditions initiales » ou des « conditions aux frontières ») à des propositions expérimentales considérées comme « pertinentes ». Cette comparaison doit se faire entre propositions de même degré de généralité ; d'autre part, elle présuppose une mise en correspondance de certains termes descriptifs appartenant à la théorie avec certains termes descriptifs appartenant au langage expérimental. Cette mise en correspondance repose elle-même sur des considérations d'ordre théorique ; la signification de la mise à l'épreuve dépend donc du crédit que l'on peut accorder à ces considérations.
Cela dit, deux situations peuvent se présenter. Soit une proposition théorique P comparable (moyennant ce qui vient d'être dit) à une proposition expérimentale P′. Première situation : P s'accorde avec P′ (affirme ou nie la même chose). Dans ce cas, on dira que la théorie a reçu une confirmation. Cela ne signifie nullement qu'elle puisse être considérée pour autant comme « vérifiée » (au sens strict du terme) : de prémisses fausses peut parfaitement découler une conséquence vraie. Seconde situation : P contredit P′. Dans ce cas, la théorie est réfutée, on peut la déclarer fausse, car de prémisses vraies ne peut découler une conséquence fausse. Il y a donc, comme l'a fait remarquer K. R. Popper depuis longtemps, une asymétrie entre confirmation et réfutation.
Des conséquences importantes s'ensuivent en ce qui concerne la stratégie de la mise à l'épreuve. On peut chercher à confirmer une théorie, mais alors on n'apprendra jamais rien de certain au sujet de sa valeur de vérité. On peut, en revanche, s'efforcer de la réfuter. Dans ce cas, on peut, si l'on réussit, apprendre qu'elle est fausse et qu'elle doit donc être éliminée. Si elle résiste à l'épreuve, elle sera dite, selon la terminologie de Popper, « corroborée » et pourra être soumise à des épreuves ultérieures. La stratégie de la confirmation est utilisable pour une théorie isolée. La stratégie de la réfutation (ou, ce qui revient au même, de la corroboration) n'a de sens que pour un ensemble de théories. Elle conduit à la représentation suivante de la démarche scientifique : en présence d'un champ d'investigation donné, on propose différentes théories compétitives, on les soumet à des épreuves falsificatrices, et progressivement les théories qui ne résistent pas aux épreuves sont éliminées, cependant que de nouvelles théories sont proposées et mises à leur tour à l'épreuve.
S. Watanabe a proposé un concept qui tient compte à la fois des deux points de vue : c'est le concept de crédibilité. Le « degré de crédibilité » d'une théorie, appartenant à une classe donnée de théories (qui jouent en quelque sorte le rôle d'hypothèses plausibles par rapport à un domaine fixé de phénomènes), est déterminé en tenant compte à la fois d'éléments a priori (c'est-à-dire de critères qui ne dépendent pas de l'expérience : cohérence interne, accord avec d'autres théories déjà éprouvées, simplicité, maniabilité, etc.) et d'éléments a posteriori (appui apporté à la théorie sous forme de confirmation ou de corroboration. Le concept est construit de telle sorte que le degré de crédibilité d'une hypothèse varie en fonction des degrés de crédibilité des hypothèses rivales.
Le type de démarche cognitive caractéristique de la physique se retrouve dans les autres sciences de la nature (en particulier dans la biologie), même si l'élaboration théorique n'a nulle part atteint un statut aussi abstrait et efficace qu'en physique. On peut à bon droit ranger ces sciences sous un même type, celui du savoir empirico-formel.
Le critère de validation propre à ce type de savoir est complexe. Comme la notion de crédibilité le fait clairement apparaître, il comporte à la fois des éléments formels, a priori (non-contradiction, compatibilité entre théories, etc.), et des éléments de portée empirique, a posteriori (soutien apporté par l'expérience, mettant en jeu les conditions propres de validation de celle-ci). Il faut remarquer cependant que la contribution de l'expérience fait intervenir la théorie, et cela à deux titres : comme on l'a vu, l'interprétation des résultats fait appel à des théories, et, d'autre part, c'est la théorie qui suggère les expériences à faire. Il y a donc un mécanisme complexe d'interaction entre théorie et expérience. Ce mécanisme fonctionne de façon à assurer le progrès de la connaissance. La théorie vaut avant tout par son caractère anticipateur et prospectif ; elle doit non seulement rendre compte des faits connus, mais aussi et surtout ouvrir de nouveaux domaines à l'investigation. Les conditions qui assurent la validation sont en même temps les conditions de la progression. Plus le contrôle de la validité des démarches devient efficace, plus la progression devient systématique. Le savoir empirico-formel domine ainsi de plus en plus le processus de sa propre croissance.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean LADRIÈRE : professeur émérite à l'université catholique de Louvain (Belgique)
Classification
Autres références
-
SCIENCE (notions de base)
- Écrit par Philippe GRANAROLO
- 3 558 mots
En raison de son indiscutable progression, et du fait de ses multiples applications techniques qui ont considérablement bouleversé nos vies, la « science » est un terme générique paré d’un immense prestige. On peut du même coup se demander si le recours à ce mot n’a pas trop souvent pour objectif...
-
SCIENCE, notion de
- Écrit par Jean-Paul THOMAS
- 1 954 mots
- 1 média
La science désigne traditionnellement, pour les philosophes, une opération de l'esprit permettant d'atteindre une connaissance stable et fondée. Platon (428 env.-env. 347 av. J.-C.) oppose ainsi, dans le livre V de La République, la science et l'opinion, cette dernière réputée changeante...
-
ANALOGIE
- Écrit par Pierre DELATTRE , Encyclopædia Universalis et Alain de LIBERA
- 10 429 mots
Tout langage de description ou d'interprétation théorique utilisé dans lessciences de la nature comporte une sémantique et une syntaxe, la première portant sur les « objets » que l'on met en relation, la seconde sur ces relations elles-mêmes. Les données sémantiques sont au fond des ... -
ANTHROPOLOGIE DES SCIENCES
- Écrit par Sophie HOUDART
- 3 546 mots
- 1 média
L’anthropologie des sciences constitue, au sein de l’anthropologie sociale, le champ d’étude relatif aux faits de savoir, notamment naturels (botanique et zoologie au premier chef). Elle peut être saisie au sein d’une double généalogie : celle des ethnosciences d’une part ; celle de la sociologie...
-
ARCHÉOLOGIE (Traitement et interprétation) - Les modèles interprétatifs
- Écrit par Jean-Paul DEMOULE
- 2 426 mots
L'archéologie ne saurait se résumer à la simple collecte d'objets contenus dans le sol. Elle ne saurait non plus se cantonner, comme elle l'a longtemps été, au rôle d'une « auxiliaire de l'histoire », incapable par elle-même d'interpréter ses propres documents. Toute science dispose à la fois de faits...
-
CAUSALITÉ
- Écrit par Raymond BOUDON , Marie GAUTIER et Bertrand SAINT-SERNIN
- 12 990 mots
- 3 médias
Le cheminement de la notion métaphysique à un principe utilisable en sciences a été graduel et lent : il a fallu, du côté de la philosophie, restreindre les ambitions ; et, du côté des sciences, clarifier les principes et instituer des expériences. - Afficher les 62 références
Voir aussi