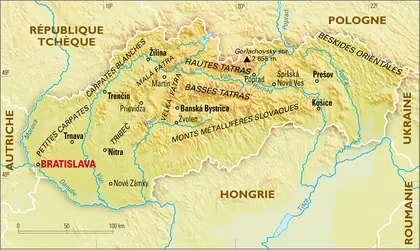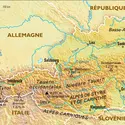SLOVAQUIE
| Nom officiel | République slovaque |
| Chef de l'État | Peter Pellegrini - depuis le 15 juin 2024 |
| Chef du gouvernement | Robert Fico - depuis le 25 octobre 2023 |
| Capitale | Bratislava |
| Langue officielle | Slovaque |
| Population |
5 426 740 habitants
(2023) |
| Superficie |
49 030 km²
|
Article modifié le
Littérature
Recherche d'une culture nationale
L'émergence de la culture et, par conséquent, de la littérature nationale slovaque a été tardive et a dû emprunter bien des détours. La Slovaquie, qui, au ixe siècle, faisait partie de l'empire de la Grande-Moravie, constituait un important centre de la culture vieux-slave. Après la chute de l'État de Grande-Moravie, au xe siècle, le territoire de la Slovaquie fut intégré à d'autres États étrangers, et sa population, soumise à une oppression nationale et sociale pendant presque mille ans, perdit dès lors complètement tous les moyens d'affirmer sa personnalité.
Le latin devint la seule langue littéraire sur le territoire de la Slovaquie, et l'on ne conserve de la période gothique et romane que peu de documents écrits. On peut citer des légendes consacrées à deux saints slovaques, Svorad et Beňadik, qui datent du xie siècle, ainsi qu'une assez riche poésie humaniste provenant de l'époque de la Renaissance.
Au xve siècle, la langue tchèque prit le dessus sur le latin. Mais on peut noter que la poésie religieuse qui s'épanouit à cette époque et connut son apogée au xviie siècle est déjà parsemée d'expressions slovaques.
Outre ces écrits, il existe une littérature orale très riche dans sa forme et conservée dans les chansons, ballades, contes et poèmes épiques populaires qui sont empreints d'un lyrisme original. Un grand nombre de ces chansons est consacré au brigand légendaire Juro Janosǐk qui symbolise la révolte contre l'oppression féodale. Cette littérature populaire a gardé toute sa vitalité jusqu'au xixe siècle, et l'interdépendance de la tradition orale et de la littérature écrite slovaques constitue le trait le plus typique de l'évolution littéraire en Slovaquie.
Éveil de la conscience nationale
Déjà, lors des siècles précédents, des éléments de la langue slovaque parlée apparaissaient dans les textes littéraires, mais ce fut Anton Bernolák (1762-1813) qui tenta le premier de créer une langue littéraire slovaque. La langue de Bernolák fut utilisée notamment par deux écrivains de talent, Jozef Ignác Bajza (1755-1836), auteur du premier roman slovaque, et le célèbre poète classique Ján Hollý (1785-1849), qui écrit ses poèmes épiques en alexandrins afin de prouver que la langue slovaque est suffisamment malléable pour égaler les formes complexes de la poésie antique.
Les deux principaux représentants du classicisme littéraire slovaque sont le poète Ján Kollár (1793-1852) et l'historien Pavel Jozef Šafárik (1795-1861), bien qu'ils aient continué d'écrire en tchèque et que, de ce fait, leur œuvre appartienne dans une mesure égale au patrimoine littéraire tchèque et slovaque. Tous deux ont adopté la conception philosophique de J. G. Herder sur l'avenir glorieux réservé aux Slaves, et ils devinrent les promoteurs les plus importants du panslavisme. Hollý, Kollár et Šafárik ont grandement aidé à réveiller la conscience nationale et ouvert la voie à la création d'une littérature authentiquement autochtone.
Une littérature autochtone
La personnalité la plus prestigieuse du xixe siècle est sans aucun doute Ludovít Štúr (1815-1856), écrivain, savant et député à la Diète hongroise. Il fut le principal artisan de la création d'une langue littéraire moderne (1844). Celle-ci, ayant pour base le dialecte de la Slovaquie centrale, a été adoptée par la nation tout entière. D'autre part, sous l'impulsion de la philosophie hégélienne, il a élaboré le concept de romantisme slovaque, dont les caractéristiques essentielles sont la prééminence de la pensée patriotique et l'attachement aux traditions populaires en tant que sources majeures d'inspiration. Štúr reprochait au romantisme occidental son manque de combativité et son pessimisme foncier. Dans ses écrits comme dans ceux des auteurs appartenant à son école, tels les poètes Samo Chalupka, Andrej Sládkovič, Ján Botto, Janko Král ou le prosateur Janko Kalinčiak, se reflète l'effervescence révolutionnaire des années quarante, de même que les combats intérieurs de l'homme du xixe siècle. Disposant de plusieurs revues publiées pour la première fois en langue slovaque, ils menaient simultanément une action politique et littéraire pour consolider la conscience nationale et répandre les idées patriotiques parmi les couches populaires. Du groupe communément appelé l'« école de Štúr » partit le premier grand essor des lettres slovaques, dont les résonances se prolongèrent jusque dans la seconde moitié du xixe siècle, et cela malgré les efforts acharnés de magyarisation que les autorités poursuivirent après la répression de la révolution de 1848. Durant cette période difficile, quelques écrivains patriotes s'appliquèrent à maintenir le moral d'une population dépouillée progressivement de tous ses moyens culturels.
Cette situation retarda l'avènement du réalisme en Slovaquie, et ce n'est qu'à partir de 1870 qu'une nouvelle génération d'écrivains commença d'élever le niveau esthétique des lettres slovaques. Les auteurs réalistes choisirent de préférence leurs sujets dans la vie contemporaine du peuple plutôt que dans le passé. Cela vaut aussi bien pour le poète P. O. Hviezdoslav (1849-1921) que pour les romanciers Svetozár Hurban Vajanský (1847-1916) et Martin Kukučín (1860-1928). Par la richesse de son langage, la profondeur de sa pensée et la diversité des formes de son œuvre poétique, Hviezdoslav est incontestablement une des figures dominantes de la poésie slovaque. L'originalité de Kukučín réside dans le fait d'avoir introduit dans la prose le personnage du paysan avec son bon sens et son franc-parler, tandis que Vajanský se préoccupe de préférence du rôle que doit assumer l'intelligentsia dans la vie d'un peuple.
Au début du xxe siècle se détache nettement un groupe littéraire appelé « les modernistes slovaques » dont le chef de file est le poète Ivan Krasko (1876-1958). Sa poésie s'apparente à celle des symbolistes occidentaux, mais elle traduit en même temps l'inquiétude du poète concernant le sort de son peuple. D'ailleurs, le trait principal, commun à tous les courants littéraires du xixe et du début du xxe siècle, est le souci constant de défendre l'existence même de la nation, de sa langue et de sa culture.
Les hauts et les bas du xxe siècle
La naissance de l'État tchécoslovaque (1918) modifia fondamentalement la fonction jusque-là exclusivement défensive de la littérature slovaque. Celle-ci trouve alors un champ d'action beaucoup plus large et beaucoup plus varié. Les écrivains slovaques étaient fortement attirés par les courants européens d'avant-garde, et certains contacts s'établirent par l'intermédiaire de la littérature tchèque et grâce à l'hebdomadaire Elán.
Le bouillonnement littéraire de cette époque reflète les efforts assidus des écrivains pour rattraper le retard que la littérature slovaque avait marqué par le passé. En ce qui concerne la prose, plusieurs romanciers, dont Martin Rázus (1888-1937) et Janko Jesenský (1874-1945), persistent dans la tradition réaliste, tandis que Milo Urban (1904-1982) approfondit la facture psychologique du roman réaliste et J. C. Hronský (1896-1961) se rapproche sensiblement du style impressionniste. Le romancier Gejza Vámoš (1901-1956) fut le premier à poser dans la littérature slovaque, jusque-là fort prude, le problème de l'érotisme. Dans le domaine de la poésie évoluent à la fois le vitalisme de Ján Smrek (1898-1982), le mysticisme claudelien de E. B. Lukáč (1900-1979) et le « poétisme » de Valentin Beniak (1894-1973) et de Ladislav Novomeský (1904-1976). Ce dernier est aussi un des chefs de file de la revue Dav groupant des intellectuels de gauche qui tentaient d'élaborer une théorie de la littérature socialiste et qui, dans les années du stalinisme, furent frappés d'anathème.
La Seconde Guerre mondiale ralentit sensiblement l'effervescence si dynamique des lettres de l'entre-deux-guerres. Au début des années 1940 se manifeste avec quelque retard le groupe des surréalistes qui se réclamaient à la fois de la poétique d'André Breton et de la poésie révolutionnaire du romantique Janko Král. Pendant la guerre, sous le régime clérical-fasciste de l'État slovaque, un petit nombre d'écrivains suivit la ligne officielle ultranationaliste, d'aucuns trouvèrent refuge dans une sorte de lyrisme paysan, rappelant celui de Giono et de Ramuz, d'autres enfin, en opposition active au régime, préparaient d'ores et déjà la littérature de l'après-guerre, fortement marquée par l'insurrection nationale d'août 1944, véritable épopée. Celle-ci, s'opposant à l'occupation hitlérienne, a inspiré notamment Dominique Tatarka (1913-1989), Peter Jílemnický (1901-1949), Alfonz Bednár (1914-1989) et Vladimír Mináč (1922-1996) qui lui consacrèrent des œuvres de valeur.
En 1949, peu après l'avènement du régime communiste, les écrivains slovaques exprimaient le souhait, dans leur Manifeste de l'humanisme socialiste, qu'un champ plus libre fût réservé à la création littéraire ; mais ce désir fut catégoriquement rejeté par les idéologues staliniens, et la littérature slovaque réduite à la seule expression du réalisme socialiste. Ce n'est qu'à partir de 1956 que les écrivains slovaques reconquirent progressivement les positions perdues et ajoutèrent à la production littéraire une nouvelle dimension en traitant les problèmes souvent si épineux de l'individu dans la société socialiste. Grâce à l'hebdomadaire KultúrnyŽivot (La Vie culturelle), ils contribuèrent dans une large mesure à la libéralisation du régime et au renouveau de la vie littéraire en Slovaquie, mais leur élan fut brutalement interrompu par les événements d'août 1968. Si de nombreux talents ont pu éclore depuis lors (notamment à travers la dissidence et la Charte 77), la littérature slovaque n'a retrouvé les chemins incertains de la liberté qu'avec l'effondrement du régime communiste en 1989 et la naissance de la Slovaquie indépendante trois ans plus tard.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Fedor BALLO : fonctionnaire à l'U.N.E.S.C.O.
- Jaroslav BLAHA : chargé d'études à la Documentation française, Paris
- Michel LARAN : maître de recherche au C.N.R.S.
- Marie-Claude MAUREL : directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales
- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis
Classification
Médias
Autres références
-
SLOVAQUIE, chronologie contemporaine
- Écrit par Universalis
-
AUTRICHE
- Écrit par Roger BAUER , Jean BÉRENGER , Annie DELOBEZ , Encyclopædia Universalis , Christophe GAUCHON , Félix KREISSLER et Paul PASTEUR
- 34 129 mots
- 21 médias
...également au rang de langue de culture. Les villes royales et les Saxons de Transylvanie parlent et écrivent l'allemand, tandis qu'en Haute-Hongrie (actuelle Slovaquie) les paysans ne connaissent que le slovaque, langue qu'utilisent le clergé et les justices seigneuriales. E. Brown, médecin anglais qui parcourut... -
BACILEK KAROL (1896-1974)
- Écrit par Ilios YANNAKAKIS
- 644 mots
Le nom de Karol Bacilek est étroitement lié à la période la plus sombre de l'histoire tchécoslovaque de l'après-guerre : les « procès » politiques des années 1950. Surnommé le Beria tchécoslovaque, Bacilek a été un des principaux organisateurs des procès contre Slansky et d'autres éminents dirigeants...
-
BRATISLAVA, anc. PRESBOURG
- Écrit par Marie-Claude MAUREL
- 598 mots
- 2 médias
Depuis la scission de la Tchécoslovaquie, le 1er janvier 1993, Bratislava (425 500 hab. en 2003) est devenue la capitale de la République slovaque. Au bord du Danube, à proximité des frontières autrichienne et hongroise, la ville se trouve dans une position excentrée par rapport au territoire...
-
CARPATES
- Écrit par André BLANC , Pierre CARRIÈRE , Encyclopædia Universalis et Mircea SANDULESCU
- 4 852 mots
- 2 médias
- Afficher les 17 références
Voir aussi
- TSIGANES ou TZIGANES
- SÉGRÉGATION
- EUROPE, géographie et géologie
- MINORITÉS
- RÉVOLUTIONS DE 1848
- AUTRICHE-HONGRIE ou AUSTRO-HONGROIS EMPIRE
- EUROPE DE L'EST
- TRAVAIL DROIT DU
- MEČIAR VLADIMÍR (1942- )
- PAUVRETÉ
- PARTITION POLITIQUE
- KOVÁČ MICHAL (1930-2016)
- DZURINDA MIKULAS (1955- )
- CLÉRICALISME
- INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS (IDE)
- GRANDE-MORAVIE
- INÉGALITÉS ÉCONOMIQUES
- SAINT-SIÈGE
- MAGYARS
- ÉGLISE & ÉTAT
- TATRAS ou TATRY
- SLOVAQUE, langue
- SLOVAQUE LITTÉRATURE
- ŠAFÁRIK PAVEL JOZEF (1795-1861)
- VAJANSKY SVETOZÁR HURBAN (1847-1916)
- BERNOLÁK ANTON (1762-1813)
- KRASKO IVAN (1876-1958)
- HOLLY JÁN (1785-1849)
- HVIEZDOSLAV PAVEL (1849-1921)
- KUKUČIN MARTIN (1860-1928)
- HODŽA MILAN (1878-1944)
- ÉCONOMIES SOCIALISTES
- HONGRIE, histoire jusqu'en 1945
- ÉNERGIE ÉCONOMIE DE L'
- COMMERCE EXTÉRIEUR POLITIQUE DU
- AUTOMOBILE INDUSTRIE
- ÉGLISE HISTOIRE DE L', du concile de Trente à nos jours
- POLITIQUE INDUSTRIELLE
- EMPLOI POLITIQUES DE L'
- POLITIQUE SOCIALE
- RELATIONS ÉCONOMIQUES INTERNATIONALES
- CONTRÔLE DES ENTREPRISES PUBLIQUES
- ROMANTISME, littérature
- PRIVATISATION