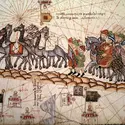SOCIÉTÉS SECRÈTES EN CHINE
Article modifié le
Associations ou fraternités clandestines, connues dans l'Empire chinois dès les premiers siècles de notre ère et qui se sont perpétuées jusqu'au milieu du xxe siècle. À la fois groupes d'insoumission collective, centres de lutte politique contre le pouvoir impérial et foyers de dissidence idéologique, elles constituaient un phénomène récurrent dans la vie sociale de l'ancienne Chine. Elles se regroupent en deux grands ensembles. Au Lotus blanc (Bailianjiao), apparu au xiie siècle sous les Song et implanté en Chine du Nord, se rattachent notamment les Huit Diagrammes (Bagua), qui faillirent s'emparer du palais impérial de Pékin en 1813, les Boxeurs (Yihetuan ou Yihequan), les Abstinents (Zhaijiao), parmi bien d'autres groupes dérivés. La Triade ou Société du Ciel et de la Terre (Sanhehui ou Tiandihui), fondée au xviie siècle par des partisans des Ming pour résister à la conquête mandchoue, était au contraire influente en Chine du Sud, de même que ses filiales plus ou moins lointaines : la Société des aînés et des anciens, ou des frères aînés (Gelaohui), créée au milieu du xixe siècle, la Bande verte (Qingbang), influente parmi les bateliers du canal Impérial, la Bande rouge (Hongbang), puissante parmi les coolies de Shanghai.
La base sociale des sociétés secrètes était complexe. Leurs adhérents étaient recrutés essentiellement dans les classes populaires, chez les paysans pauvres, mais plus encore parmi les errants et marginaux de la société rurale : portefaix, journaliers agricoles, vagabonds, colporteurs, artisans itinérants, bateliers, baladins, contrebandiers... Les sociétés secrètes attiraient également les pauvres gens et les coolies des villes, dont beaucoup étaient des paysans transplantés de fraîche date dans un environnement hostile et qui cherchaient dans ces « structures d'accueil » un remède à leur déracinement. Les soldats licenciés, réduits au vagabondage en raison des distances qui les séparaient de leurs villages d'origine, leur fournissaient un nombre considérable d'affiliés. Enfin, à côté de ces éléments populaires, elles comptaient parmi leurs membres des transfuges des classes dirigeantes : lettrés ayant échoué aux examens, fonctionnaires dégradés, notables intrigants, fils de famille dévoyés, commerçants impatients de s'enrichir par tous les moyens.
La loi et les autorités impériales réprimaient très sévèrement l'appartenance aux sociétés secrètes. On les appelait « bandits religieux » (jiaofei), « bandits des bandes » (huifei), « bandits à turbans » (fufei), « bandits à lance » (gefei), « bandits rouges » (hongfei), « bandits qui se réclament de la dynastie Ming » (hongfei), « bandits oiseaux de nuit », c'est-à-dire contrebandiers (xiaofei), « bandits du sel » (yanfei). Tous ces termes mettent en évidence leur caractère de dissidence à la fois religieuse, sociale et politique, d'opposition globale à la société confucéenne et conservatrice.
Les sociétés secrètes possédaient en effet une idéologie propre, nourrie d'emprunts aux cultes populaires et aux systèmes philosophiques ou aux religions minoritaires (taoïsme, bouddhisme, manichéisme). Elles promettaient pour l'au-delà une vie nouvelle, enseignaient des techniques d'immortalité d'origine taoïste. La secte du Lotus blanc, fondée vers 1130 par un moine, avait repris au bouddhisme le thème messianique de Milefu (Maitreya), le Bouddha rédempteur, et les influences manichéennes, notamment la notion de « lumière » (ming), étaient présentes dans son rituel. Les sociétés secrètes faisaient grand usage de rites d'initiation très élaborés (par exemple, le serment du sang dans le cérémonial d'affiliation à la Triade), des chiffres sacrés, des médiums et des devins, de l'écriture automatique avec le pinceau magique, des signes de reconnaissance, du langage secret, des recettes d'invulnérabilité, des techniques naturistes comme celle de la boxe sacrée (chez les Boxeurs, notamment). Ces pratiques magiques et religieuses constituaient un lien puissant entre leurs membres, tenus par ailleurs au secret absolu. Dans leurs réunions, la nuit et la montagne jouaient un grand rôle, à la fois physique et symbolique, par opposition à la société officielle qui s'inscrivait, elle, dans le champ diurne et dans le plan de la rizière irriguée. Les sociétés secrètes affirmaient aussi l'égalité de leurs membres et le libre accès de tous aux divers degrés de leur hiérarchie interne ; elles donnaient une place particulière aux femmes, prenant ainsi le contre-pied du modèle social confucéen, fondé sur le cloisonnement des classes (lettrés, paysans, artisans et marchands), la hiérarchie patriarcale et la subordination de la femme.
La dissidence sociale allait de pair avec la contestation idéologique. En période de crise politique ou agraire, lors des changements de dynastie (geming), elles pouvaient mobiliser des millions de paysans : ainsi à la fin des Han (jacquerie des Turbans jaunes en 184), à la fin des Song (xiie s.), à la chute des Ming (milieu du xviie s.). En période plus calme, elles se repliaient sur une sorte de banditisme égalitaire, inspiré de leur slogan « pillons les riches, aidons les pauvres » (dafu jipin). Elles tiraient de gros profits de l'attaque des greniers impériaux, des yamen, des convois officiels, des maisons des riches marchands, ainsi que de la contrebande du sel, du trafic de l'opium et, plus tard, des armes à feu ou de la piraterie, profits qui étaient partagés égalitairement. Ces activités leur conféraient le caractère de sociétés à but lucratif et d'entreprises de « reprise collective » sur les propriétaires fonciers et sur l'État bureaucratique.
Tout en se réclamant du moralisme confucéen et du principe d'harmonie sociale, les sociétés secrètes représentaient la principale force d'opposition politique. Dénonçant les fonctionnaires corrompus, les impôts abusifs et les exactions de l'armée, elles constituaient une véritable « contre-société », ayant sa propre légalité rebelle, ses tribunaux et ses prisons, son Code pénal secret. Cette fonction de dissidence politique était particulièrement importante sous les dynasties étrangères (les Yuan aux xiiie et xive s., les Qing du xviie au xxe s.) et prenait alors l'allure d'un légitimisme dynastique. Ainsi, après la chute des Ming et jusqu'à la révolution de 1911, les sociétés secrètes, notamment la Triade, firent une active propagande antimandchoue au nom du mot d'ordre « Fan Qing, fu Ming » (« Renversons les Qing, restaurons les Ming »). Elles ont donc été étroitement mêlées à toutes les grandes secousses de la Chine moderne et ont ainsi participé aux grandes révoltes paysannes du milieu du xixe siècle (la Triade a initialement collaboré avec les chefs Taiping et a organisé une série de soulèvements à Shanghai, à Amoy et à Canton entre 1853 et 1855). Leur tradition de lutte contre les Mongols et les Mandchous les préparait aussi à combattre la pénétration impérialiste, et la Triade a animé la résistance populaire à l'intervention française en Chine du Sud lors de la guerre franco-chinoise de 1884-1885. Les Barbes rouges (Honghuzi) firent de même en Mandchourie contre les troupes russes. L'insurrection anti-étrangère des Boxeurs (1898-1900) n'a donc pas été un épisode isolé.
De même, les sociétés secrètes ont encadré le mécontentement populaire à la fin de l'Empire. Bien des soulèvements tentés par les républicains du Tongmenghui (Société de la conjuration) dans les années 1900 à 1911 le furent de concert avec la Triade (plusieurs dirigeants du mouvement républicain et Sun Yat-sen lui-même lui étaient affiliés), la Bande rouge et le Gelaohui, très influent dans l'armée impériale. Après la révolution de 1911, les sociétés secrètes conservèrent leur influence, surtout chez les paysans de l'intérieur — la IIIe Internationale s'intéressa en 1926 aux Piques rouges (Hongqianghui) —, et furent encore capables de mobiliser par endroits ceux-ci contre l'occupation japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans les villes, en revanche, elles dégénérèrent précocement en gangs. C'est le cas de la Bande verte de Shanghai : le Guomindang s'en servit pour écraser le mouvement communiste en 1927, et Tchiang Kai-chek lui fut probablement affilié. La Triade, restée très active dans les treaty ports et chez les émigrés, devint elle aussi une sorte de mafia asiatique, et certaines de ses sections collaborèrent avec les Japonais en 1937-1945. Vivement combattues par les autorités de la Chine populaire, en raison de leurs liens avec Taiwan, les sociétés secrètes ne figurent plus parmi les mécanismes importants des luttes politiques et sociales chinoises.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Daniel HÉMERY : agrégé d'histoire, maître assistant à l'université de Paris-VII
Classification
Média
Autres références
-
CHINE - Hommes et dynamiques territoriales
- Écrit par Thierry SANJUAN
- 9 801 mots
- 5 médias
...la population chinoise de 220 à 435 millions d'habitants. Une grave crise économique et sociale a suivi, avec des révoltes intérieures comme celle de la société secrète des Lotus blancs, entre 1795 et 1803, et – la plus importante – celle des Taiping, entre 1850 et 1864, qui part du Guangxi et... -
CHINE - Histoire jusqu'en 1949
- Écrit par Jean CHESNEAUX et Jacques GERNET
- 44 602 mots
- 50 médias
...Xiuquan proclame l'avènement en sa personne d'une nouvelle dynastie chinoise, à caractère national ; de ce point de vue, les Taiping sont les héritiers des sociétés secrètes anti-mandchoues des xviie et xviiie siècles. Mais leur originalité est d'être en même temps influencés par l'Occident. Plusieurs... -
IL ÉTAIT UNE FOIS EN CHINE, film de Tsui Hark
- Écrit par Laurent JULLIER
- 879 mots
...conception elliptique est justifiée par le choix de raconter une tranche d'histoire bien connue du public de destination (Huang Fei-hong est un héros national). Malheur, donc, au « diable roux » de spectateur qui ignore tout du mouvement des Yihetuan (« milices de justice » à l'origine de la guerre des Boxers),... -
LOTUS BLANC, chin. BAILIANJIAO [PAI-LIEN-KIAO]
- Écrit par Kristofer SCHIPPER
- 1 153 mots
La plus importante ou, en tout cas, la plus célèbre des sociétés secrètes chinoises (il faudrait plutôt l'appeler secte proscrite), le Lotus blanc (Bailianjiao, ou Bailian hui) est un vaste mouvement syncrétiste sotériologique et mystique qui remonte au moins au xiie siècle ; à plusieurs...
- Afficher les 9 références
Voir aussi