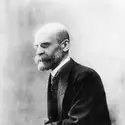TRAVAIL SOCIOLOGIE DU
Article modifié le
Entendue comme un champ académique institué, la « sociologie du travail » est d'origine française et de d’apparition récente. On peut en dresser l'acte de naissance avec la parution, en 1946, des Problèmes humains du machinisme industriel de Georges Friedmann. Ceux-ci suscitèrent l'adhésion enthousiaste d'un groupe de jeunes chercheurs qui purent, grâce à la logistique assurée par la création, cette même année 1946, d'un Centre d'études sociologiques (CES) au sein du tout jeune Centre national de la recherche scientifique (CNRS), entamer, sous la direction de Friedmann, des enquêtes « de terrain » dans l'industrie. Mais la sociologie du travail ne disposa d'un espace institutionnel propre qu'avec la création, en 1959, de la revue éponyme par quatre disciples de Friedmann : Michel Crozier, Jean-Daniel Reynaud, Alain Touraine et Jean-René Tréanton. Enfin, la publication en 1961-1962, sous la codirection de Georges Friedmann et de Pierre Naville, d'un Traité de sociologie du travail, qui fit référence pendant quarante ans, acheva la reconnaissance académique en France de cette sous-discipline. Celle-ci occupe alors une place centrale dans la sociologie française, à la mesure de la centralité accordée au travail lui-même dans le fonctionnement et la reproduction de la société. Bien plus que l'étude d'un champ particulier du social, la sociologie du travail a, dans son âge d'or des années 1960, vocation à constituer une sociologie générale. Réciproquement, sa crise présente est coextensive à la mise en cause de la centralité sociale du travail, qui a marqué les débats depuis les années 2000.
Toutefois, si le cadre intellectuel de la sociologie française du travail a été adopté ailleurs dans le monde (principalement dans l'espace latin : Italie, Espagne, Amérique latine), il n'a pas un caractère universel. Ainsi, on trouve en ses lieu et place dans les pays anglo-saxons une « sociologie industrielle » (industrialsociology), et cette nuance n'est pas sans importance. Au-delà de la « sociologie du travail » stricto sensu, il convient donc de s'interroger sur le traitement sociologique de la question du travail, ce qui nécessite de couvrir un temps et un espace plus larges.
De la question sociale à l'organisation scientifique du travail
La question du travail et la genèse de la pensée sociologique
La sociologie s'est toujours préoccupée de la question du travail. La mutation profonde, au xixe siècle, des formes techniques et du statut social du travail participe à la genèse même de la sociologie, en rupture avec l'économie politique. Au xviiie siècle, les penseurs du progrès, philosophes et économistes, étaient convaincus que la libéralisation des échanges et la suppression du despotisme suffiraient à garantir la prospérité publique et l'ordre social. Dès le début du xixe siècle, cette pensée libérale fut mise à l'épreuve de la révolution industrielle, qui générait de nouvelles classes pauvres urbaines, perçues comme mettant en péril l'équilibre général de la société. Pour nombre de penseurs sociaux de la première moitié du xixe siècle, l'économie politique se révélait donc incapable de réaliser ses promesses. Les auteurs contre-révolutionnaires furent les premiers à tenir un tel discours ; au rationalisme individualiste du xviiie siècle, ils opposèrent une conception de la société comme un être en propre, un corps organique, dont il fallait connaître les lois, sous peine de voir la terreur révolutionnaire faire retour. De Comte à Durkheim, en passant par l'organicisme social, la sociologie naissante doit beaucoup à cette pensée contre-révolutionnaire, qui rendait possible une science holiste du social.
Le nouvel ordre social qui succède à la Révolution française fait apparaître une dissociation entre les notions de « propriété » et de « travail » que les penseurs révolutionnaires auraient voulues inséparables. Le projet idéal d'une société de petits propriétaires échangeant librement les produits de leur travail se dissolvait au moment même où les conditions politiques semblaient enfin réunies pour l'accomplir. Avec la naissance de la grande industrie, les observateurs sociaux sont amenés à reconnaître un nouveau principe d'organisation sociale : celui du « salariat », forme de sujétion limitée dans le temps et l'espace du travail. Les économistes libéraux résistèrent pourtant tout au long du xixe siècle à la reconnaissance de ce principe social qui leur rappelait l'Ancien Régime. La présence de cette thématique permet, à rebours, de repérer les précurseurs de la sociologie : Tocqueville, qui, tout en s'inquiétant du risque de l'émergence d'une « nouvelle aristocratie », identifiait l'originalité historique de la sujétion salariale, à savoir son caractère limité et impersonnel ; les saint-simoniens, qui, en mettant au fondement du social l'« organisation » (et non, comme les révolutionnaires, le contrat) ont tant contribué théoriquement mais aussi pratiquement à la genèse de la conception moderne de l'entreprise comme corps social ; Marx, enfin, qui a fait du salariat le fondement de toute sa théorie, celle de l'exploitation capitaliste.
Les enquêtes sociales
Cette réflexion théorique a un pendant empirique : les « enquêtes sociales », dont les premières sont mises en œuvre en Angleterre dès la fin du xviiie siècle, alors que l'industrialisation et l'exode rural font apparaître un paupérisme urbain. En France, l'essor des enquêtes sociales doit beaucoup à l'Académie des sciences morales et politiques, créée par François Guizot en 1832 pour fournir au régime né de la monarchie de Juillet un corps intellectuel officiel. Comme en Angleterre, les médecins hygiénistes jouent un rôle majeur dans le développement de ces enquêtes, dont la plus célèbre reste celle de Louis-René Villermé sur les ouvriers du textile, laquelle suscita la première loi sociale française : celle de 1841 limitant le travail des enfants. Mais les économistes y ont aussi leur part. Ils se déclarent alors souvent en France opposés à la pensée anglaise « manchestérienne » (celle de Ricardo et de ses disciples) et expriment leurs convictions « humanitaires ». Outre Tocqueville, on peut citer Eugène Buret, mais aussi Adolphe Blanqui, disciple direct du fondateur de l'école économique libérale française, Jean-Baptiste Say, et frère du révolutionnaire Auguste. C'est seulement après le coup d'État de 1851 qu'un libéralisme économique strict s'impose. Mais apparaît alors, comme en contrepoint, une nouvelle école de pensée, qui bénéficie de la sympathie du régime du second Empire : l'« économie sociale » de Frédéric Le Play. Cet ingénieur, qui avait fréquenté les saint-simoniens dans sa jeunesse, avait ensuite adhéré à une pensée catholique sociale d'inspiration contre-révolutionnaire. Avec ses disciples, il a joué un rôle majeur dans le développement de la sociologie empirique en France en réalisant sa monumentale collection de monographies sur les « ouvriers des deux mondes ».
Cette tradition perdure après la chute du second Empire. Les leplaysiens contribuent alors aux travaux sociographiques et sociojuridiques menés dans le cadre de l'Office du travail, créé en 1891 pour aider le nouveau pouvoir républicain à créer les conditions de la paix sociale dans la société salariale. C'est dans cet espace, plus politique qu'académique, que se forgent les instruments intellectuels d'une pensée du travail à la fin du xixe siècle en France. Ce mouvement, qui aboutit en 1906 à la création d'un ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (revendication des révolutionnaires de 1848), clôt la « question sociale » au sens du xixe siècle en institutionnalisant le débat salarial par la reconnaissance de droits collectifs de la « classe ouvrière ». On trouve des correspondants de ce mouvement dans les différents pays européens : au Royaume-Uni, le socialisme « fabien » à la source du « travaillisme », dont est issue la théorie des « relations industrielles » (industrial relations) des époux Sidney et Béatrice Webb ; en Allemagne, le « socialisme de chaire », qui fournit la doctrine sociale du régime bismarckien et contribue à la genèse de la « science sociale » (Sozialwissenschaft) qui est indissociable de l'essor de la social-démocratie allemande, à l'origine, par exemple, des premiers travaux de Max Weber sur les travailleurs agricoles de Prusse orientale.
En France, ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale que la sociologie académique issue de Durkheim commence à influer sur la sphère politique, plus d'ailleurs dans le domaine de l'éducation que dans celui du travail. Le lien entre la sociologie académique et la gestion politique du travail ne s'opère en fait qu'après la Seconde Guerre mondiale. Entre-temps, un nouveau discours avait pris le devant de la scène : celui de l'« organisation du travail ». C'est en réaction à celui-ci que se développera finalement, à partir de 1945, la sociologie du travail proprement dite.
De l'organisation du travail à l'organisation scientifique du travail
L'idée d'« organisation » est issue du saint-simonisme ; l'expression « organisation du travail » est popularisée par Louis Blanc qui, dans un opuscule portant ce titre, régulièrement réédité entre 1839 et 1848, promouvait un ordre social du travail en lieu et place de l'« anarchie marchande » (ce qui inspira en partie l'expérience malheureuse des Ateliers nationaux de 1848). Au début du xxe siècle, c'est par cette expression, complétée par l'adjectif « scientifique », qu'on traduit en français le scientific management de l'ingénieur américain Frederick Taylor. Les travaux de Taylor s'inscrivent dans un mouvement de pensée général de l'époque : la recherche d'une solution rationnelle à la question sociale, fondée sur une « science du travail », nourrie des apports de la physiologie et de la psychologie expérimentale.
L'émergence de cette science du travail est indissociable de la reconnaissance du fait salarial, qui se traduit en France par la définition jurisprudentielle du « contrat de travail », distinct des contrats civils ordinaires. Est ainsi reconnu, conformément aux vues de Marx et de Tocqueville, un principe de « subordination juridique et technique » (ce sont les termes du droit) du travailleur à l'égard de son employeur. Ce principe reconnaît donc à l'employeur, en rupture avec la tradition du « métier », le droit de définir le cadre et les obligations du travail (le contenu d'une « loyale journée de travail » selon l'expression de Taylor). En contrepartie, l'employé se voit reconnaître en vertu de son statut le droit à une protection sociale, par exemple – ce point fut à l'origine de la définition du contrat de travail en France en 1898 – le droit à une couverture assurantielle en cas d'accident du travail.
Le développement du discours managérial et celui de la pensée sociale du travail sous l'égide de l'État ne sont donc pas contradictoires. Ce sont au contraire les deux faces d'une même transformation sociale : celle qui conduit au travail salarial moderne, objet de la « sociologie du travail » contemporaine.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- François VATIN : professeur de sociologie à l'université de Paris Nanterre, co-directeur du master de sciences économiques et sociales
Classification
Médias
Autres références
-
CARRIÈRE, sociologie
- Écrit par Mathilde SEMPÉ
- 1 129 mots
Le terme de carrière, issu du sens commun pour désigner les étapes de la vie professionnelle, est par ailleurs envisagé, dans sa construction savante, comme un outil de recherche. Objet d’appropriations méthodologiques différenciées au sein du champ scientifique, la notion constitue dès lors un enjeu...
-
CLASSES SOCIALES - Classe ouvrière
- Écrit par Julian MISCHI et Nicolas RENAHY
- 4 428 mots
- 1 média
... et sentiment d'appartenance local s'entremêlent puisque aires de vie, de consommation et de travail tendent à se superposer dans un même territoire. La fierté du métier, de la connaissance de l'outil de travail est partie intégrante de l'image de l'homme ouvrier, à l'usine comme en dehors du temps... -
CROZIER MICHEL (1922-2013)
- Écrit par Claude JAVEAU
- 879 mots
...principalement consacrés à l'histoire du mouvement ouvrier et à l'action des syndicats, Crozier s'est intéressé à partir de son entrée au C.N.R.S., en 1952, au rôle des employés et des petits fonctionnaires dans la structure sociale française. Il aborde cet univers sous les angles des phénomènes de la conscience... -
ÉCONOMIE SOCIOLOGIE DE L'
- Écrit par Frédéric LEBARON
- 4 596 mots
- 1 média
...révolution néoclassique », ne laisse guère de place à une problématique sociologique (autre que « résiduelle »), malgré les travaux quantitatifs de Simiand. En sociologie émergent d'autres sous-disciplines telles que la sociologie du travail, qui s'épanouit surtout dans l'après-guerre, en particulier... - Afficher les 11 références
Voir aussi
- ORGANISATION DU TRAVAIL
- SOCIOLOGIE HISTOIRE DE LA
- INDUSTRIELLE SOCIÉTÉ
- CONTRE-RÉVOLUTIONNAIRE PENSÉE
- CONTRAT DE TRAVAIL
- TRAVAIL DES ENFANTS
- OST (organisation scientifique du travail)
- TRAVAIL DROIT DU
- TÉLÉTRAVAIL
- OUVRIÈRE CLASSE
- OS & OP (ouvrier spécialisé et ouvrier professionnel)
- ENQUÊTES & SONDAGES
- EMPLOI
- IMMIGRATION
- FRANCE, histoire, de 1815 à 1871
- PENSÉE ÉCONOMIQUE HISTOIRE DE LA
- HISTOIRE ÉCONOMIQUE
- RELATIONS DE TRAVAIL
- DÉSINDUSTRIALISATION
- UBER