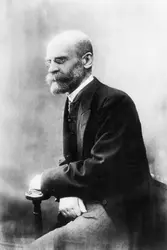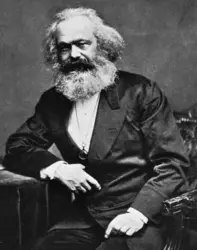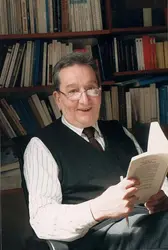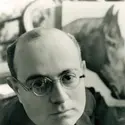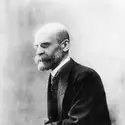SOCIOLOGIE Les grands courants
Article modifié le
Les sociologies de l'action
Depuis Max Weber (1864-1920) et la publication de son ouvrage posthume, Wirtschaft und Gesellschaft, les sociologues ont pris l'habitude de distinguer quatre types idéaux d'actions humaines dont deux relèvent prioritairement des relations sociales communautaires (Vergemeinschaftung) : l'action traditionnelle et l'action émotionnelle (Affektual), et deux des relations sociétaires (Vergesellschaftung) : l'action rationnelle en finalité, de type instrumentale (Zweckrationalität), et l'action rationnelle en valeur, de type axiologique (Wertrationalität). Une partie de la postérité wébérienne a consisté à reprendre, critiquer, développer, amender cette typologie de type « compréhensive ».
Choix rationnel et individualisme méthodologique
La théorie du choix rationnel a tenté de complexifier et parfois d'infléchir les modèles d'analyse de l'action rationnelle tels que les mettent en œuvre les économistes. Selon ces derniers, un comportement est dit rationnel dès qu'il peut être modélisé au moyen du postulat d'optimisation du rapport bénéfices/coûts. Mais, pour les sociologues du « choix rationnel », l'optimisation se fait en situation de contrainte, ce qui les conduit à redéfinir une « rationalité sociale » distincte des versions de la rationalité des sciences économiques et politiques. Cette rationalité sociale suppose des individus qui mobilisent des ressources pour atteindre des objectifs très divers, sous des contraintes variables. Lorsque ces objectifs sont « substantiels » (traduisibles monétairement), la maximisation est postulée : le calcul bénéfice/coût peut s'appliquer selon le modèle de l'homo œconomicus. Lorsque les objectifs sont « opérationnels » (non monétaires), on se trouve dans des cas de rationalité limitée ou complexe, par exemple lorsque l'accès aux ressources et aux informations nécessaires à la décision est très inégal ou lorsque des capacités sont trop inégales pour postuler le même traitement des données pour prendre les décisions.
La question de savoir si un modèle élargi de « rationalité sociale » est applicable à tous les cas concrets reste ouverte (Siegwart Lindenberg, 2001). En effet, celle-ci fait intervenir cette « rationalité axiologique » définie par Max Weber comme la relation entre l'action et l'adhésion à des valeurs. C'est la raison pour laquelle, dans le souci de mieux distinguer et relier les diverses formes de rationalité, Raymond Boudon, démarquant l'individualisme méthodologique du seul choix rationnel, a élaboré le concept de « rationalité cognitive » (1995) pour désigner le fait commun à toutes les conduites rationnelles de pouvoir être justifiées par des « bonnes raisons » qu'elles soient de type économiques (intérêt), de type moral ou éthique (valeur) ou même de type logique (cognition).
Ainsi redéfini, « l'individualisme méthodologique », incluant la théorie du choix rationnel, procède au moyen de modélisations des actions individuelles permettant d'expliquer une corrélation jugée significative ou une relation historique jugée exemplaire par les « bonnes raisons » des acteurs individuels considérés comme des types abstraits.
L'analyse stratégique : l'acteur et le système
Issu des travaux d'Herbert Simon (1947) sur la rationalité limitée et de ceux de Michel Crozier sur l'administration française et Le Phénomène bureaucratique (1964), ce courant se rattache aux sociologies de l'action dans une perspective particulière, celle des rapports de pouvoir conçu non comme de la domination, mais comme des capacités inégales d'influencer autrui au sein d'une organisation, ou mieux, d'un système d'action concret. Formalisée dans l'ouvrage L'Acteur et le système par Michel Crozier et Erhard Friedberg (1977), cette orientation a connu un grand succès auprès de tous les spécialistes et acteurs des organisations à qui elle apporte non seulement des éléments d'analyse mais aussi des méthodes et concepts liant compréhension des jeux d'acteurs et transformation du système d'action concret.
La thèse centrale sous-jacente à ce courant de recherche est que tout acteur dans un système d'action concret, considéré comme un ensemble de jeux structurés par des règles, possède des ressources – certes inégales – lui permettant de construire des zones d'incertitude à l'intérieur du système qui est toujours instable, incomplet, ouvert (du fait du postulat de la rationalité limitée). L'acteur social est donc ici conçu comme un stratège (et non optimisateur), c'est-à-dire capable de se rendre, au moins partiellement, imprévisible aux autres acteurs, pour maintenir ou accroître son pouvoir. La dynamique d'un système est donc la résultante des stratégies de ses acteurs : les connaître et les confronter, c'est pouvoir comprendre le changement et éventuellement l'infléchir dans tel ou tel sens.
Ce courant de recherche procède au moyen d'enquêtes de terrain qui peuvent être considérées comme des interventions d'un certain type : on peut faire appel au sociologue en cas de problème dans une organisation. Celui-ci aura besoin d'observer et surtout de recueillir la parole des acteurs pour reconstruire leurs stratégies et comprendre les règles des jeux de pouvoir et leurs zones d'incertitude. Cela suppose de conquérir leur confiance pour produire de la connaissance qui pourra être restituée aux acteurs qui lui ont permis de faire son analyse.
L'intervention sociologique et les mouvements sociaux
Une autre forme d'intervention sociologique est pratiquée depuis plus de vingt ans par les équipes réunies autour d'Alain Touraine. La perspective consiste ici à faire surgir d'une situation, d'un groupe localisé, d'une action collective, des explications, justifications, revendications susceptibles de comprendre et légitimer un mouvement social, au moyen d'entretiens de groupes composés de leaders ou de volontaires. L'intervention sociologique était conçue, à la suite de Mai-68, comme la contribution de sociologues « engagés » à l'accompagnement et à la légitimation, dans l'action, d'un acteur historique capable de « produire du social », « conduire le changement », « incarner l'historicité » (Touraine, 1973). C'est ce que la classe ouvrière a fait, pendant plus d'un siècle, dans les sociétés industrielles, grâce notamment à ses organisations syndicales. C'est ce qu'elle ne fait plus, à l'époque de la société postindustrielle, par suite de l'emprise de la technocratie, et de l'avènement de la globalisation financière. De nouveaux mouvements sociaux ont-ils pris le relais ? L'étude des mouvements féministes, étudiants, antinucléaires, écologistes, etc., si elle met en lumière de nouvelles formes de mobilisation, montre que ceux-ci ne débouchent pas sur une nouvelle conflictualité d'ensemble. La modernité entre ainsi en crise : rationalisation et subjectivation divergent (Touraine, 1992).
C'est pourquoi les interventions sociologiques, d'abord liées à l'analyse des mouvements sociaux, se sont reconverties en tentatives de comprendre des processus nouveaux : l'exclusion des jeunes des cités (La Galère de François Dubet, 1983), la montée du racisme (La France raciste de Michel Wieworka, 1992), le vécu des lycéens, des étudiants, des immigrés, etc. De cette trajectoire de recherche est issue une nouvelle conception de la sociologie : La Sociologie de l'expérience (Dubet, 1994) dont nous reparlerons.
La théorie de la régulation sociale de Jean-Daniel Reynaud constitue aussi une sociologie de l'action centrée sur la notion de régulation. Reynaud a su tirer un ensemble cohérent de concepts et de pistes de recherche des retombées de l'enquête menée, de 1929 à 1937, par Elton Mayo à Hawthorne et de l'ouvrage, Management and the Workers, qui en est issu. Pour fonctionner, la grande entreprise moderne a besoin d'articuler deux sortes de régulation : la régulation autonome des salariés et la régulation de contrôle de la direction. Pour parvenir à une régulation conjointe, plusieurs voies sont possibles que les sociologues doivent « découvrir » sur le terrain, en même temps qu'ils « accompagnent » l'émergence d'acteurs à partir de l'action elle-même. Ils peuvent ainsi comprendre et éventuellement faire comprendre comment prévenir les conflits, réussir des négociations, transformer les règles, mécanismes de base nécessaires pour assurer à la fois la rentabilité économique et la satisfaction sociale.
Les sociologies de l'action sociale sont diverses et n'adoptent pas la même définition de l'action. Elles ont un seul point commun : le refus d'une analyse causale de type positiviste. Elles divergent quant à la priorité à accorder aux actions individuelles « ordinaires » ou aux actions collectives exceptionnelles. Elles semblent s'accorder quant à la priorité à donner à l'acteur sur les systèmes mais elles n'ont pas la même définition de l'acteur. Elles se différencient également sur la question de la rationalité, entre des approches « cognitives » à tendance universaliste et des approches « historiques » beaucoup plus relativistes.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Claude DUBAR : professeur d'Université, université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, fondateur du Laboratoire Printemps (professions, institutions, temporalité), U.M.R. 8085 du C.N.R.S.
Classification
Médias
Autres références
-
SOCIOLOGIE CLINIQUE
- Écrit par Vincent DE GAULEJAC
- 2 761 mots
La sociologie clinique a pour objet l'analyse des processus socio-psychiques qui caractérisent les relations complexes et intimes de « l’être de l’homme et de l’être de la société », selon l’expression de l’écrivain français Roger Caillois. Elle aborde la dimension existentielle des...
-
SOCIOLOGIE COGNITIVE
- Écrit par Fabrice CLÉMENT
- 2 963 mots
- 1 média
Parler de sociologie cognitive semble anodin à une époque où la compréhension des processus cérébraux connaît des développements spectaculaires et où fleurissent des disciplines comme la psychologie cognitive, l’éthologie cognitive ou l’anthropologie cognitive. Pourtant, beaucoup de sociologues...
-
SOCIOLOGIE DE L'ART
- Écrit par Nathalie HEINICH
- 4 943 mots
- 2 médias
Selon une recherche menée en Italie à la fin des années 1990, seule 0,5 p. 100 de la production sociologique relèverait de la sociologie de l'art. Mais les bornes de ce domaine sont difficiles à définir, en raison de sa proximité, d'une part, avec les disciplines prenant traditionnellement en charge...
-
SOCIOLOGIE DE LA SANTÉ
- Écrit par Patrice PINELL
- 3 436 mots
L’importance culturelle, sociale, économique et politique prise dans tous les pays développés par les questions de prévention et de préservation de la santé, de traitement et de prise en charge des maladies chroniques et dégénératives, ainsi que par le fonctionnement, l’efficacité, le coût et la gestion...
-
SOCIOLOGIE HISTORIQUE
- Écrit par Laurent WILLEMEZ
- 3 040 mots
- 5 médias
Le partage entre histoire et sociologie peut être considéré comme un nouvel avatar de la question de l'unité des sciences de l'homme, que beaucoup de chercheurs appellent de leurs vœux mais que peu promeuvent véritablement. De fait, dans le monde académique, histoire et sociologie sont...
-
SOCIOLOGIE PRAGMATIQUE
- Écrit par Joan STAVO-DEBAUGE et Laurent THÉVENOT
- 2 515 mots
L'expression sociologie pragmatique n'est qu'une appellation d'usage couvrant un courant de recherches qui ont contribué au renouveau des sciences sociales en France depuis près de quarante ans non seulement en sociologie et en anthropologie, mais aussi en économie institutionnelle...
-
SOCIOLOGIE DU SPORT
- Écrit par Olivier LE NOÉ
- 8 566 mots
- 2 médias
La sociologie du sport constitue une discipline précieuse pour comprendre les interactions entre le sport et les dynamiques sociales. Les secousses de l’ordre sportif – qu’elles concernent des violences sexuelles, des exclusions de nations des compétitions olympiques, ou des débats sur la participation...
-
ACCULTURATION
- Écrit par Roger BASTIDE
- 8 306 mots
- 1 média
En même temps que l'anthropologie culturelle établissait la série ordonnée de ces concepts, depuis le conflit jusqu'à l'assimilation,la sociologie nord-américaine (qui est partie du relationnisme allemand et n'a découvert Durkheim que bien après) établissait à son tour une série de concepts qui... -
ACTION COLLECTIVE
- Écrit par Éric LETONTURIER
- 1 466 mots
On entend par ce terme, propre à la sociologie des minorités, des mouvements sociaux et des organisations, toutes les formes d'actions organisées et entreprises par un ensemble d'individus en vue d'atteindre des objectifs communs et d'en partager les profits. C'est autour de la question des motivations,...
-
ACTION RATIONNELLE
- Écrit par Michel LALLEMENT
- 2 646 mots
- 1 média
Les théories sociologiques ne convergent pas, loin s'en faut, lorsqu'il est question de rendre intelligibles les comportements individuels. D'inspiration psychologique, certaines estiment que les hommes demeurent avant tout les jouets de leurs passions. Dans un registre tout différent, d'autres analysent...
-
ADMINISTRATION - La science administrative
- Écrit par Jacques CHEVALLIER et Danièle LOCHAK
- 3 208 mots
Le courant sociologique. Deux branches de la sociologie ont été plus particulièrement conduites à s'intéresser aux phénomènes administratifs. D'abord la sociologie politique, dans la mesure où l'existence et le fonctionnement de l'administration publique comportent une dimension politique... - Afficher les 172 références
Voir aussi
- SOCIOLOGIE HISTOIRE DE LA
- CONNAISSANCE SOCIOLOGIE DE LA
- CAUSALITÉ, sciences sociales
- IDENTITÉ, sociologie
- PASSERON JEAN-CLAUDE (1930- )
- RATIONALITÉ
- SÉLECTION CULTURELLE & SOCIALE
- STRUCTURATION THÉORIE DE LA, sociologie
- RÉGULATION SOCIALE
- CHOIX RATIONNEL THÉORIE DU
- CONSTRUCTIVISME SOCIAL
- MOUVEMENT SOCIAL
- HOLISME
- DÉTERMINATION SOCIALE
- REYNAUD JEAN-DANIEL (1926-2019)
- BERGER PETER (1929-2017)
- LUCKMANN THOMAS (1927-2016)
- ANALYSE STRATÉGIQUE, théorie des organisations
- RÉUSSITE SOCIALE
- SCOLARITÉ
- ACTION SOCIOLOGIE DE L'