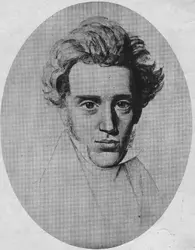KIERKEGAARD SØREN (1813-1855)
Article modifié le
Kierkegaard a eu une grosse influence sur un bon nombre de philosophes contemporains, qu'ils soient croyants ou non : Karl Jaspers, Martin Heidegger, Gabriel Marcel, Jean-Paul Sartre. Certains termes du philosophe danois comme « nausée », « angoisse », « existant » sont tombés aujourd'hui dans le langage courant. Mais, plutôt que de faire de Kierkegaard « le père de l'existentialisme », selon une formule consacrée, il importe de souligner qu'il a voulu être l'exception à laquelle l'homme actuel doit toujours se confronter. Il invite celui-ci à ne pas réduire le malheur de la conscience à une maladie, à ne pas prendre les sauvetages pour des saluts, à ne pas confondre les libérations avec la délivrance. En maintenant le pôle de l'Individu et celui de la Transcendance, il préserve le respect de la personne humaine, devenue aujourd'hui l'objet de manipulations de toute sorte, et il sauvegarde la notion de sacré en mettant le sujet à l'abri de toutes les caricatures qui prétendent la remplacer. Il donne à comprendre que l'existence est une tension entre ce qu'est l'homme et ce qu'il n'est pas, tension qui demeure par-delà toutes les synthèses dialectiques ou historiques. Bref il invite à méditer sans cesse sur ce paradoxe et sur ce scandale absolu que constitue le Dieu incarné dans la personne du Christ venant apporter à l'homme un message sans lequel celui-ci ne serait plus qu'un être errant.
Le témoin du christianisme
Le « tremblement de terre »
Søren Aabye Kierkegaard naquit à Copenhague ; il était le benjamin d'une famille de sept enfants dont beaucoup moururent jeunes. S'il ne mentionne jamais sa mère, les références à la personnalité marquante de son père sont nombreuses dans ses œuvres et dans son Journal. Michael Kierkegaard, le père de Søren, appartenait à une pauvre famille de neuf enfants ; un jour où il gardait des moutons dans la lande lugubre du Jutland, transi de faim et de froid, il osa maudire Dieu ; conscient du sacrilège qu'il avait commis, il pensa que toute sa famille subirait un effroyable châtiment et il éleva ses enfants dans cette crainte. Mais la chance finit par lui sourire et il fit fortune dans la bonneterie ; à quarante ans, retiré des affaires, il s'adonna à la réflexion philosophique et à la méditation religieuse. Ami des frères moraves, lecteur assidu des philosophes allemands, doué d'une imagination débordante, redoutable dialecticien, il faisait l'admiration de son fils qu'il éleva dans le respect d'un christianismetragique, celui du Christ ensanglanté, abandonné sur le Golgotha et hurlant : « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Lorsque Søren entra à l'université, il commença par mener une vie joyeuse avec ses compagnons d'études, fréquentant les cafés et les cercles de discussions. En 1834, il voit mourir sa mère et l'une de ses sœurs ; c'est le moment où il commence de rédiger son Journal, qui sera le compagnon de toute sa vie. Cette année est également celle d'un épisode mystérieux que Kierkegaard appelle « le tremblement de terre » et dont on a proposé de nombreuses interprétations. Il semble que celle de J. Hohlenberg soit la plus satisfaisante. Le père de Kierkegaard avait considéré son second mariage comme une sorte d'infidélité à l'égard de sa première femme qu'il aimait beaucoup ; celle qu'il avait épousée en secondes noces avait été sa servante et il en eut un premier enfant seulement cinq mois après le mariage. À la lumière de certains passages du Journal de Kierkegaard, Hohlenberg pense que les relations du père et de la servante débutèrent par un viol, secret dont le père aurait fait part à son fils un jour qu'il était ivre.
Bien que le naturel mélancolique de Søren Kierkegaard aille en s'accentuant, il continue de participer à la joyeuse vie nocturne de Copenhague ; un jour, pris de boisson, il est probablement entraîné dans un lieu de débauches, et il gardera de cette équipée un souvenir assez précis pour décider de modifier totalement son train de vie et, peut-être, pour penser qu'il a désormais « une écharde dans la chair ».
Régine Olsen
Un soir de 1837, invité chez des amis, Kierkegaard rencontre Régine Olsen, fille d'un conseiller d'État, elle a quatorze ans et lui vingt-cinq, il s'éprend d'elle aussitôt. En 1838, le père de Kierkegaard meurt et laisse à Søren une partie de son immense fortune. Pour tenir une promesse faite à son père, Søren termine ses études de théologie ; cependant il n'avait pas oublié Régine et il se fiance avec elle le 10 septembre de la même année. Le 11 août 1841, il renvoie à Régine son anneau de fiançailles. Bouleversée, la jeune fille écrit à Søren qu'elle va mourir. Kierkegaard, affolé, décide de reprendre les relations afin de ménager des transitions. Le 29 septembre, il soutient sa thèse de doctorat sur Le Concept d'ironie constamment rapporté à Socrate ; le 11 octobre, les fiançailles sont définitivement rompues. Pourquoi ce drame ? De nombreuses explications médicales, psychopathologiques, psychanalytiques ont été proposées ; mais aucune ne semble satisfaisante. Au fond, Kierkegaard a sacrifié Régine à l'amour qu'il lui portait ; elle devait demeurer pour lui la fiancée éternelle et ne pas tomber dans la catégorie générale de l'épouse qui aurait fait de lui un fonctionnaire conjugal. Et il faut bien dire que Kierkegaard a réussi puisque, pour l'histoire, Régine est restée beaucoup plus la fiancée de Kierkegaard que la femme de Fritz Schlegel qu'elle devint plus tard.
Cette rupture plongea Kierkegaard dans un profond désespoir ; il partit pour Berlin où il suivit les cours de F. Schelling, qui le déçut très vite. De retour au Danemark, il se consacre à une énorme production littéraire, tout en se faisant passer pour un dandy cynique et insouciant. En 1843 paraît L'Alternative, qui remporte un gros succès, notamment la partie intitulée « Le Journal du séducteur ». Quelques mois plus tard paraissent Deux Discours édifiants, puis Crainte et tremblement et La Répétition. En 1844, il publie Les Miettes philosophiques et Le Concept d'angoisse. En 1845, son deuxième gros ouvrage voit le jour : Stades sur le chemin de la vie.
Contre l'Église officielle
Un an plus tard se situe le pénible épisode de la polémique avec Le Corsaire. Cette feuille satirique tourne en ridicule la personne, voire l'œuvre, de Kierkegaard et publie des caricatures qui valent à celui-ci les rires des gamins qu'il rencontre dans la rue. Kierkegaard réplique dans un autre journal, le Faedrelandet, et garde de cet incident un mépris tenace à l'égard des journalistes. En 1846, il publie son troisième gros ouvrage (si l'on ne compte pas sa thèse sur l'ironie) : Post-Scriptum non scientifique et définitif aux Miettes philosophiques, dans lequel il critique la philosophie de Hegel et où il révèle qu'il est bien l'auteur des volumes antérieurs publiés sous des pseudonymes. L'incident avec Le Corsaire amène Kierkegaard à prendre conscience de la voie qu'il doit suivre : défendre le christianisme contre les chrétiens qui le caricaturent. Sa décision se trouva renforcée par un nouvel incident. Un pasteur, A. P. Adler, prétendait avoir eu une révélation du Christ et déclarait que celui-ci lui avait dicté plusieurs de ses sermons ; Adler finit par être suspendu et mis en congé. Dans son Livre sur Adler, qu'il ne publia jamais, Kierkegaard montre qu'Adler n'était qu'un homme ordinaire qui, comme beaucoup d'autres, prenait son exaltation psychologique pour une révélation surnaturelle. Kierkegaard est par là conduit à réfléchir sur ce qu'il appelle l'Extraordinaire, qui, refusant de suivre la masse, se subordonne uniquement à Dieu sans prendre l'ordre établi comme intermédiaire. Dès lors, Søren voit sa vocation se préciser : il sera le témoin du christianisme, il se situera en dehors de toute chrétienté ou même il s'opposera à elle. C'est ainsi qu'il publie en 1848 La Maladie à la mort (Le Concept de désespoir), puis, en 1859, L'École du christianisme.
En 1854 meurt Mynster, chef de l'Église danoise, que Kierkegaard connaissait de longue date, puisqu'il avait été pasteur de la famille. Au cours des funérailles solennelles, l'évêque Martensen, successeur de Mynster, donne celui-ci pour un « véritable témoin de la vérité ». Kierkegaard est indigné et finit par publier des articles où il rappelle que le Christ est mort nu, couvert de crachats, abandonné de tous et qu'il n'a pas eu droit à des obsèques grandioses accompagnées de beaux discours. Le public se scandalise, mais Kierkegaard poursuit son attaque contre l'Église officielle. Il publie neuf numéros d'une courte feuille intitulée L'Instant, dans laquelle il s'en prend violemment aux prêtres-fonctionnaires qui font une carrière dans le christianisme.
Le 20 octobre 1855, il s'écroule dans la rue ; transporté à l'hôpital, il y meurt trois semaines plus tard. À son enterrement l'assistance fut nombreuse, mais le clergé était absent, à l'exception du doyen du diocèse et du frère de Søren, Peter Kierkegaard, qui prononça le discours d'usage.
En 1859 paraissait le Point de vue explicatif de mon œuvre écrit en 1848 ; la publication posthume du Journal contribua à mieux faire comprendre l'œuvre de Kierkegaard.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean BRUN : agrégé de l'Université, docteur ès lettres, professeur de philosophie à l'université de Dijon
Classification
Média
Autres références
-
CRAINTE ET TREMBLEMENT, Søren Kierkegaard - Fiche de lecture
- Écrit par Francis WYBRANDS
- 802 mots
- 1 média
C'est en 1841, la même année que Marx, que Søren Kierkegaard (1813-1855) soutient sa thèse de doctorat, sur Le Concept d'ironie chez Socrate. En 1843, quelques mois après L'Alternative, paraissent, le même jour, le 16 octobre, La Répétition et Crainte et tremblement, où la...
-
ANGOISSE EXISTENTIELLE
- Écrit par Jean BRUN
- 2 552 mots
- 1 média
...métaphysiques des données biographiques et qui se complaisent dans les descriptions lyriques de symptômes. Il n'en est pas moins vrai que, comme le souligne Kierkegaard, l'angoisse peut être aussi la plus haute école de l'homme, à la condition qu'elle le conduise vers les hauteurs et non dans les extases vers... -
DANEMARK
- Écrit par Marc AUCHET , Frederik Julius BILLESKOV-JANSEN , Jean Maurice BIZIÈRE , Régis BOYER , Georges CHABOT , Encyclopædia Universalis , Lucien MUSSET et Claude NORDMANN
- 19 522 mots
- 14 médias
Enfin, il faut faire une place à part à Søren Kierkegaard (1813-1855), qui anticipe, dans une œuvre passionnée et angoissée, les acquis de l'existentialisme moderne et qui exige l'authenticité, l'engagement au service d'une subjectivité sans faille, le tout à la recherche d'un Dieu vivant.... -
DIEU - Problématique philosophique
- Écrit par Jacques COLETTE
- 5 678 mots
...aboutissement conduit à annuler cette méconnaissance, ce qui ne se peut faire qu'en récusant cette transformation. Contre Hegel, Schelling et Feuerbach, Kierkegaard s'attache à produire un concept de la différence absolue, de la transcendance de Dieu qui repose non sur une philosophie positive, mais sur... -
ESTHÉTIQUE - Histoire
- Écrit par Daniel CHARLES
- 11 897 mots
- 3 médias
De la pensée de Kierkegaard, on peut dire qu'elle s'oppose à celle de Hegel avec autant d'âpreté que celle de Nietzsche s'oppose à celle de Kant. Dans l'esthétisme tel que le dépeint l'auteur d'Ou bien... ou bien (1843), l'histoire devient mythe : la subjectivité... - Afficher les 17 références
Voir aussi