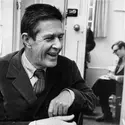MALLARMÉ STÉPHANE (1842-1898)
Article modifié le
Musique mentale
À l'automne de 1871, il est enfin nommé à Paris. Il y trouve un milieu littéraire et artistique plus vaste que celui que lui offrait Avignon avec la compagnie des félibres. Il se plonge avec bonheur dans cette vie dont l'absence, à Tournon, à Besançon, lui avait été pénible. Vie d'amitiés, avec Manet, avec Villiers de L'Isle-Adam, avec Verlaine, avec tous ceux qui, à partir de 1877, se retrouveront le mardi dans le petit appartement de la rue de Rome. Vie de rencontres à l'allure mondaine, avec des écrivains et des plumitifs, des artistes et des tâcherons. Vie de démarches auprès des journaux et des éditeurs, de Lemerre, par exemple, qui refuse et le Faune et la traduction des poèmes d'Edgar Poe. Vie consacrée enfin à des travaux rémunérateurs, accomplis avec probité et sans concessions : une adaptation parfois libre d'un ouvrage anglais de mythologie, une éphémère revue mondaine, des ouvrages pédagogiques ; soit : Les Dieux antiques (1880), La Dernière Mode (huit livraisons de septembre à décembre 1874), Les Mots anglais (1877).
Ce dernier livre, ouvrage de philologie, ne rappelle pas seulement que, pour vivre, Mallarmé dut être professeur. Il évoque aussi cette thèse de linguistique à laquelle Mallarmé a longuement songé sans peut-être écrire autre chose que les quelques pages qui nous restent. Le travail du poète a longtemps été accompagné, en sourdine, par une réflexion sur la parole. L'image d'une science se profile, entrevue, à l'horizon.
Mais Paris est aussi, à partir, semble-t-il, de 1878, l'occasion de découvrir le concert symphonique, la musique, les « riches musiques » de l'orgue et de l'orchestre. Mallarmé restera toujours un amateur privé de connaissances techniques. Mais il n'a sans doute pas tort, ce musicien de métier qui lui écrit : « Savoir entendre et définir nettement les lignes extérieures de la mélodie et les profondeurs incommensurables de l'harmonie sont des qualités rares, que les poètes tels que vous sont seuls – en privilégiés – à posséder. » Le compliment touche juste : il n'y aurait pas grand sens à dire que la musique a influencé Mallarmé. C'est tout au contraire parce que le poète avait pratiqué son art d'une certaine manière qu'il peut percevoir dans la musique autre chose qu'un prétexte au discours du sentiment. Car, dans la symphonie, ce n'est pas l'expression qui intéresse Mallarmé. Au milieu des wagnerolâtres trop souvent préoccupés de souligner combien la musique sert le texte, l'anecdote et le commentaire moral qui l'enveloppe, le poète a un recul : ce n'est pas la légende que retient son attention. La musique est pour lui organisation de figures dans un temps, glissements et contrastes, coups d'ailes et retombées.
On comprend comment peut devenir un fidèle des concerts symphoniques celui qui, dès 1865, notait à propos de son Hérodiade : « J'ai, du reste, là, trouvé une façon intime et singulière de peindre et de noter des impressions très fugitives. Ajoute, pour plus de terreur, que toutes ces impressions se suivent comme dans une symphonie, et que je suis souvent des journées entières à me demander si celle-ci peut accompagner celle-là, quelle est leur parenté et leur effet. » Ce que Mallarmé découvre sans pouvoir le nommer, c'est peut-être le contrepoint : non plus la succession déductive des idées, mais leurs simultanéités décalées, tout un jeu d'accords, d'échos et de fuites.
Musicien, il l'était déjà, dès que son poème avait tourné le dos à l'art oratoire. Il ne le deviendra pas davantage, ne songera jamais, semble-t-il, à apprendre l'art de composer. Car, comme le théâtre, la musique devient mentale : c'est le livre qui est appelé à réaliser son essence pure. Le poème est une musique sans instruments. « De la musique visible », disait Arthur Symons, ami de Yeats et excellent traducteur de Mallarmé. Il faudrait suggérer plutôt : de la musique inouïe.
Car le mot n'est pas vaine sonorité. Les sons mêmes qui le composent, transmués en lettres, apparaissent déjà comme objets spirituels. Presque toujours absent de la musique instrumentale, le sens est cette étrange opération qui d'un groupe de sons fait naître une « notion ». Non pas, on l'a vu, que le poème se dissolve en un sens global et résumé, une idée, à moins que l'on ne prête à ce dernier mot la valeur qu'il a chez Mallarmé : figure, forme. « Idée même et suave », dit le poète. Jean-Pierre Richard suggère « essence concrète ».
Ces expressions paradoxales indiquent assez de quelle difficulté est, encore pour nous, la pensée de Mallarmé. Une « idée » est « suave » ; on la goûte, avec la bouche. Une « essence » est « concrète ». Il nous faut nous déshabituer de ces distinctions séculaires qui opposent la sensation à la pensée, le visible à l'invisible, le corps à l'âme ; il nous faut essayer de prendre à la lettre le mot « imaginaire », où persiste, dans le fictif, l'image. Si Mallarmé a perçu la musique comme une réalité à la fois sensible et spirituelle, et non comme un discours expressif, un peu plus subtil que celui des mots, c'est peut-être, dans une démarche inverse, par une méditation sur l'objet musical que nous pourrions saisir quelque chose de son intuition.
La question demeure de savoir comment, en son temps, il a pu être compris de ceux qui le vénéraient, de ces jeunes poètes qu'à partir de 1886, à cause du manifeste de Moréas, on appelle « symbolistes ». Que Mallarmé ait d'emblée paru comme un des parrains, voire le parrain, du mouvement, c'est un fait incontestable : révélé à un certain public par le roman de Huysmans, À rebours, et par Les Poètes maudits, de Verlaine, il se voit sollicité, par toutes les revues qui se lancent alors, de fournir articles ou poèmes inédits. Mais il y aurait abus de langage à le considérer comme symboliste, et plus encore à vouloir le définir en partant d'une certaine idée du symbole. Pour lui-même, il évite le mot « symboliste » jusque dans un article de 1892, intitulé Crise de vers, où il décrit les récentes transformations de la poésie française. Quant au mot « symbole » ; il ne l'emploie qu'avec précaution et sans marquer pour lui de religieux respect : il est même question, dans l'étude sur Richard Wagner, de « hasardeux symboles » qui ne semblent guère dignes qu'on se prosterne devant eux.
Il reste, par un paradoxe, que les grands poèmes écrits ou révélés à partir de 1885, la Prose pour des Esseintes et plusieurs sonnets, dont le célèbre sonnet en i, dit aussi, abusivement, « Le Cygne », représentent pour beaucoup de lecteurs les textes majeurs du symbolisme, et ont quelque peu fait pâlir les poèmes d'Henri de Régnier, de Francis Viélé-Griffin, de Gustave Kahn et de quelques autres à qui le qualificatif de symboliste convient de manière irréfutable.
Il reste aussi que, de l'abondante production à visées théoriques qui fleurit dans les revues du mouvement, se détachent impérieusement, difficiles et superbes, les poèmes en prose que publia Mallarmé sous le modeste nom d'articles. La continuité est en effet visible entre les poèmes en prose écrits à Tournon, les traductions, en prose, des poèmes de Poe, et les Divagations publiées en 1897 ; notons que ce volume reprend justement les premiers poèmes en prose, à côté de textes comme Crise de vers, le Mystère dans les lettres ou la superbe conférence sur Villiers de L'Isle-Adam. C'est peut-être dans cette prose que l'on saisit le mieux le travail proprement musical sur la phrase, les infinies variations du rythme, la composition dramatique, et tout le jeu, à travers les comparaisons éparpillées, des motifs en fuite perpétuelle. D'un certain point de vue, par exemple, il pourrait être dit que Crise de vers a pour sujet, ou « motif général », l'orage, comme La Gloire, expressément qualifié de « poème », s'organise autour d'un soleil couchant. À côté de ces textes qui scintillent à l'infini, la prose commune des symbolistes semble une vaine ornementation, l'expression inutilement chantournée de quelques idées simples.
Dans Divagations, les idées d'apparence la plus abstraite, sur le langage, la littérature ou l'économie politique, sont étonnamment mises en scène, rendues perceptibles. C'est toujours un théâtre qui est proposé, non pas un théâtre qui serait une imitation du réel, mais un spectacle mental où l'acteur concret se transforme en figure. C'est aussi peut-être un ballet, pourvu que l'on admette, comme le dit Mallarmé, que la danseuse n'est pas une femme et qu'elle ne danse pas. On pourrait recourir à une autre métaphore, celle d'une géométrie en mouvement, qui ne se résout pas en concepts, mais persiste à imposer des figures. Cette singulière manière de prendre la pensée, on ne la retrouve peut-être que chez certains poètes d'autres pays, poètes qui ont pu ne pas connaître Mallarmé par cœur, mais qui donnent l'impression de l'avoir deviné comme il avait deviné la musique. Mais y aurait-il un sens à soutenir que Mallarmé a exercé une influence sur Yeats, Hofmannsthal ou Alexandre Blok ?
Réduire les Divagations à un recueil d'idées littéraires, c'est prendre La Divine Comédie pour un traité de théologie. C'est refuser d'apprendre à voir.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean-Louis BACKES : ancien élève de l'École normale supérieure, professeur de littérature comparée à l'université de Caen
Classification
Médias
Autres références
-
CORRESPONDANCE 1854-1898 (S. Mallarmé) - Fiche de lecture
- Écrit par Yves LECLAIR
- 974 mots
- 1 média
Stéphane Mallarmé (1842-1898), « poète maudit » selon Verlaine, issu du Parnasse, figure de proue (malgré lui) du mouvement symboliste, traducteur d’Edgar Poe, critique d'art, voua sa vie entière à la quête de la Beauté idéale. Pour lui, la « poësie » en eût été l'expression ou le rêve absolu,...
-
DIVAGATIONS, Stéphane Mallarmé - Fiche de lecture
- Écrit par Patrick BESNIER
- 1 030 mots
- 1 média
Publié l'année précédant la mort de Stéphane Mallarmé (1842-1898), le volume de Divagations recueille, sous forme d'anthologie, l'essentiel de ses écrits en prose. À plusieurs reprises déjà, le poète avait choisi cette forme : Album de vers et proses (1887-1888), Pages (1891)...
-
L'ACTION RESTREINTE. L'ART MODERNE SELON MALLARMÉ (exposition)
- Écrit par Yves MICHAUD
- 1 133 mots
L'art de l'âge moderne avait fini par être écrasé sous sa propre vulgate. L'expositionL'Action restreinte. L'art moderne selon Mallarmé, au musée des Beaux-Arts de Nantes du 9 avril au 3 juillet 2005 (catalogue de Jean-François Chevrier, Musée des Beaux-Arts de Nantes-Hazan,...
-
POÉSIES, Stéphane Mallarmé - Fiche de lecture
- Écrit par Pierre VILAR
- 985 mots
- 1 média
Les quarante-neuf pièces qui composent les Poésies de Stéphane Mallarmé (1842-1898), dont le titre dans sa simplicité désigne sans l'éclairer la nature seulement et radicalement poétique, indépendamment de tout thème ou discours « qui parlerait trop haut », ont marqué la modernité d'une...
-
ALÉATOIRE MUSIQUE
- Écrit par Juliette GARRIGUES
- 1 302 mots
- 4 médias
...recherches essentiellement littéraires (alors que les compositeurs américains sont surtout influencés par des recherches picturales). Des écrivains comme Stéphane Mallarmé ou James Joyce ont en effet totalement repensé la notion de forme en ne concevant plus l'œuvre dans un déroulement linéaire, avec... -
ARTS POÉTIQUES
- Écrit par Alain MICHEL
- 5 906 mots
- 3 médias
...rejeter les arts poétiques (ce sera le cas pour Verlaine, Lautréamont). Mais il les influence aussi jusqu'à nos jours. Par exemple, il nous conduit jusqu'à Mallarmé qui apparaît d'abord comme l'héritier du symbolisme. Il chante le « démon de l'analogie », mais non sans quelque ironie. Sa véritable poétique... -
BALLET
- Écrit par Bernadette BONIS et Pierre LARTIGUE
- 12 615 mots
- 21 médias
...Mérode. On ne danse plus. Carlotta Zambelli exceptée. Mais ce triste moment de décadence sera pourtant marqué par l'incomparable réflexion de Stéphane Mallarmé dans Crayonné au théâtre : « La danseuse n'est pas une femme qui danse, pour ces motifs juxtaposés qu'elle n'est pas une femme, mais une... -
BÉNICHOU PAUL (1908-2001)
- Écrit par Françoise COBLENCE
- 1 920 mots
...tout autant l'idéal poétique que les perspectives politiques. Toujours souverain, le poète maudit l'est désormais dans la solitude, et l'on conçoit que Mallarmé puisse représenter l'ultime accomplissement de cette tendance, le point où la parole confine au silence et se livre dans une obscurité qui maintient... - Afficher les 27 références
Voir aussi