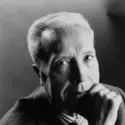STYLE
Article modifié le
Le discours de la stylistique
On ne tentera pas d'esquisser l'histoire de la stylistique. D'autant que généralement elle ne porte que sur le style de la langue ou du discours littéraire et non sur l'ensemble des arts. C'est la limite qu'elle s'imposait déjà sous son ancien nom de rhétorique. Car la rhétorique est une technique du langage considéré comme un art. Elle est à la fois descriptive et normative : grammaire de l'expression littéraire, elle détermine les moyens que le langage met à la disposition de l'écrivain et de l'orateur ; instrument de critique, elle pose les règles propres à chaque genre, qui fixent la composition, le vocabulaire, la syntaxe et les figures, et elle juge les œuvres en fonction de ces règles. La stylistique moderne, animée par le même souci de positivité que la linguistique à laquelle elle se rattache, renonce aux fonctions normative et critique. Mais, si elle s'interdit de juger les œuvres, elle ne renonce pas à leur examen. Du même coup elle se partage entre deux disciplines, qui répondent aux deux conceptions du style que nous avons distinguées « : d'une part ce que Pierre Guiraud appelle une stylistique de l'expression, d'autre part une stylistique de l'individu. La première, descriptive, met en lumière le pouvoir ou les propriétés de la langue, la seconde, génétique, traite de l'art singulier de l'écrivain. Ainsi Bally, auteur de la première Stylistique parue en 1905, étudie le génie de la langue : considérant que sa fonction est d'exprimer la pensée et les sentiments, il assigne à la stylistique l'étude des moyens que le lexique et la syntaxe apportent pour l'expression des sentiments. Par contre, Spitzer, promoteur de la New Stylistics, étudie le génie d'un auteur, tel qu'il apparaît dans sa langue, c'est-à-dire dans le système des procédés que son œuvre met en jeu et qui assure l'expression de la pensée aussi bien que de l'affectivité. Ce qui reste commun à ces deux entreprises, c'est l'idée que la stylistique est liée à la fonction sémantique de la langue, et par conséquent au discours – au texte – où cette fonction s'exerce. Comme dit Jakobson, la grammaire de la poésie – étude des moyens d'expression poétique en puissance dans la langue – est inséparable de la poésie de la grammaire – étude des effets obtenus dans le texte par le recours à ces moyens. Si l'on s'attache aux propriétés stylistiques de la langue, « on ne peut les expliquer par le seul mécanisme de la langue, mais uniquement par celui du discours » (T. Todorov et O. Ducrot), donc en considérant au moins « l'aspect verbal » des textes, lequel réfère immédiatement à l'aspect sémantique. Dès lors, si l'opposition entre les deux visées demeure irréductible, elle ne l'est pas entre leurs procédures ; car, si l'on veut élaborer une stylistique de la langue, ce ne peut être qu'en tant que la langue est une possibilité de discours, et donc sur les discours qu'elle autorise et qui sont des œuvres singulières ; inversement, cette singularité est autorisée par la langue où elle trouve à se manifester, et son examen en appelle à une théorie de cette langue : l'étude des effets implique l'étude des moyens.
C'est à partir de là que l'on peut étendre la notion de style à tous les arts, comme l'a tenté Gilles Granger. Cette notion s'explicite alors dans les termes de code et de message qu'a imposés le structuralisme. Le message, c'est à la fois l'œuvre et ce qui est signifié par elle : le sens, ou plutôt, si l'on suit Guillaume, l'effet de sens qui résulte, dans le texte et par le contexte, de l'actualisation d'une des possibilités de sens que la langue confère au signe. Le code, c'est le système des moyens convenus par lesquels le message est transmis, et donc des contraintes qui, pour l'émetteur et le récepteur, constituent ces moyens. Le style est une propriété du message, dans la mesure où il est codé. Comme dit Guiraud : « Il n'y a d'effets de style que dans le message et par rapport au message ; mais cet effet est conditionné par des valeurs qui ont leur source dans le code » (La stylistique). Ces valeurs qui s'attachent à chaque signe sont des possibilités de sens. On examinera rapidement comment ces deux notions sont reprises chez Granger par une stylistique générale. Que le style appartienne au message – et par exemple, comme le dit Jakobson, que la fonction poétique du langage soit définie par « son orientation vers le message » –, Granger l'explicite en disant que « le style appartient essentiellement aux significations » (Essai sur la philosophie du style), les significations étant ici définies comme des ratés ou les résidus du sens, « ce qui, dans une expérience, échappe à une certaine structuration manifeste » (ibid.) et ne se laisse pas réduire au statut d'objet de savoir : le message, lorsqu'il a du style, porte donc sur ce que le langage scientifique ne peut totalement maîtriser, bien qu'on s'efforce de le coder. Car il y a un rapport nécessaire du style avec le code, que Granger explicite ainsi : là où ne joue qu'un seul code, dont la grammaire est impérative et exhaustive, comme dans le cas du morse, pas de style ; la condition de tout style, c'est la pluralité des codes. Cette pluralité apparaît partout où existent des éléments hors code, « où le code de base ne régit qu'une partie de la substance à laquelle il donnera forme » (ibid.). Ces traits libres sont alors organisés par ce que les linguistes nomment des sous-codes, comme ceux qui régissent les registres ou les accents de la parole. Granger en appelle à d'autres sous-codes. « Ces éléments hors code sont organisés soit en systèmes a priori qui viennent renforcer la langue, comme les contraintes métriques ou celles qui définissent les genres, soit en systèmes libres, extemporanément constitués et lisibles a posteriori dans le message » (ibid.). A priori ou a posteriori, selon qu'ils sont établis par la coutume ou inventés par le créateur comme ces gênes exquises que s'impose Valéry, ces codes sont des surcodes, dont on peut observer l'action « en décelant des régularités de distribution des éléments dans le message, qui enjambent pour ainsi dire les unités régies par l'organisation sémantique et syntaxique » (ibid.). C'est de ce surcodage que naît l'effet de style.
Ce qui intéresse Granger c'est, à partir de cette définition, la possibilité d'une étude proprement scientifique du style dans la perspective d'une théorie des jeux. Nous ne saurions le suivre sur ce chemin ; mais nous pouvons noter deux conséquences de cette conception, que lui-même souligne. La première c'est que la notion de style trouve un champ d'application beaucoup plus vaste que les arts du langage, et même l'ensemble des arts : un champ où se situent tous les objets produits par le travail humain, pour autant que ces objets échappent par quelque côté à une structuration et à un codage manifestes, mais où ce qui les surdétermine, ce qui leur confère ce surcroît ou cette marge de sens que Granger appelle signification (et que je préfère appeler expression, ou expressivité) donne lieu à une surstructuration ou un surcodage moins manifeste et moins efficace. Les seuls objets sans style sont les produits stéréotypés de l'industrie moderne, entièrement ordonnés au concept qui préside à leur fabrication. Et encore... Selon Olivier Revault d'Allonnes, tout objet, y compris l'objet standard, est un style à lui tout seul ; parce qu'il répond à des normes idéologiques et parfois esthétiques – le fonctionnalisme en est une – qui lui ajoutent une connotation et qui introduisent un surcodage ; ainsi peut-on parler du style d'une peinture ou d'un monument, mais aussi de celui d'une automobile ou d'un appareil téléphonique. Une peinture, par exemple, si elle n'est pas simplement un graphisme didactique, la transposition littérale d'un texte, exprime plus, ou autre chose, que le discours univoque, et la production de cet effet est liée au surcodage : au système de moyens et de contraintes qu'impose la peinture (par exemple les exigences de la représentation du volume sur un plan) et/ou que s'impose le peintre (par exemple les exigences de sa palette ou de sa touche). Ce lien de l'expressivité au métier – de la signification au surcodage –, qui ne me semble pas complètement explicité chez Granger, est réciproque : l'expression requiert la technique et est produite par elle ; ainsi la fantasmatique du créateur s'insinue en quelque sorte dans l'exercice du métier ; c'est la même chose de dire l'angoisse ou la jubilation et de privilégier tel ou tel trait pictural.
Aussi bien cette analyse recoupe-t-elle celle d'un historien de l'art comme E. H. Gombrich, à cette différence près que Gombrich parle de moyens d'expression là où Granger parle de codes. Toute création, dit-il, met en œuvre un vocabulaire, un système de schémas, comme le canon ou le modèle perspectif pour la peinture, qui oriente la vision du peintre – « l'artiste a tendance à voir ce qu'il peint plutôt qu'à peindre ce qu'il voit », et « le pouvoir est la condition du vouloir » (L'Art et l'illusion) – et aussi bien la vision du spectateur ; le style réside dans ces moyens d'expression. Ce vocabulaire de l'art, tacitement convenu dans la culture entre l'émetteur et le récepteur, est exactement le lieu du surcodage » : codes a priori lorsque le schéma est stéréotypé, imposé dans les exercices d'atelier ; codes a posteriori lorsque ce schéma est remodelé, sinon inventé par l'artiste lui-même ; et c'est alors que le style, de collectif, devient personnel, jusqu'à ce que cet a posteriori soit récupéré et « a priorisé » par l'académisme.
Cette mise en évidence de l'initiative de l'artiste conduit au second point, à savoir « la fonction individuante du style ». Car c'est là l'essentiel. Tant que le surcodage met en œuvre des codes a priori, c'est-à-dire des moyens et des normes institués et enseignés, le style, impersonnel, qui en résulte n'est pas vraiment un style. La vérité du style est d'être singulier ; et il l'est lorsque le surcodage est a posteriori, lorsqu'il est propre au message et à l'auteur. D'où l'intérêt qu'il y a à bien observer « la gradation de l'a priori à l'a posteriori, ou, si l'on veut, de la convention à la création extemporanée » (Granger, ibid.). Une science plus fine peut le faire, elle peut affronter l'individuel, alors qu'une science plus grossière s'en tient au général et n'invoque le style que comme instrument classificatoire pour un survol de l'histoire. Il pourrait paraître présomptueux d'invoquer la science là où il s'agit d'expérience esthétique, de la saisie d'un effet de style qui singularise l'objet. Car sans doute la perception naïve suffit-elle à saisir l'individuel – cette fleur, ce caillou : objets qui n'ont pas de style ; peut-être même saisit-elle la présence du style sur les objets qui en ont un, et qui tiennent de lui leur individualité. Mais elle ne saurait rendre compte de ce qui produit cet effet, c'est-à-dire de la multiplicité des structures concurrentes organisées par un surcodage. Selon que ces codes sont plus ou moins a priori, on peut parler de degré d'individuation. Et dans tous les cas le style suppose et caractérise un travail : le travail qui produit un objet, qui le surdétermine ou le surstructure par un surcodage. À ce travail du créateur peut répondre un travail du récepteur qui repère les codes pour déchiffrer le message. Mais cette pratique déjà « scientifique » n'est pas requise de l'amateur : il lui suffit, pour jouir de l'œuvre, d'être sensible à l'effet du surcodage ; l'œuvre lui propose « une expérience prégnante et individuée », individuée dans la mesure même où le style a individué l'œuvre (Granger).
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Mikel DUFRENNE : ancien professeur à l'université de Paris-X
Classification
Autres références
-
STYLE (arts)
- Écrit par Frédéric ELSIG
- 2 059 mots
La notion de style appelle des définitions différentes selon les disciplines. En histoire de l'art, elle s'articule sur deux niveaux interdépendants : l'attributionnisme (traduction réductrice de connoisseurship) et l'histoire des formes. Sur le plan pratique, elle désigne la manière...
-
ALAṂKĀRA-ŚĀSTRA
- Écrit par Pierre-Sylvain FILLIOZAT
- 2 014 mots
-
CONTRE SAINTE-BEUVE, Marcel Proust - Fiche de lecture
- Écrit par Guy BELZANE
- 1 253 mots
..., et notamment dans Le Temps retrouvé, qui n'est pas loin d'adopter la forme de l'essai auquel Proust avait songé dès l'origine. Ainsi, en refusant de considérer l'œuvre comme le reflet de la vie, mais en plaidant pour une analyse avant tout stylistique, Proust n'oppose pas seulement... -
CRÉATION LITTÉRAIRE
- Écrit par Gilbert DURAND
- 11 579 mots
- 3 médias
...de sonorités et de sens qui sont des créations. Si tout écrivain ne s'impose pas un rythme – la barre de mesure du musicien –, au moins se donne-t-il un style : le style c'est plus que l'homme, c'est le mouvement d'un désir qui dépasse l'homme. C'est ce mouvement d'écrire, et de lire, qui finalement... -
CRITIQUE LITTÉRAIRE
- Écrit par Marc CERISUELO et Antoine COMPAGNON
- 12 922 mots
- 4 médias
Mais si la contextualisation historique n'est pas pertinente, la stylistique l'est-elle plus ? La notion destyle appartient au langage ordinaire et il faut d'abord l'affiner. Or la recherche d'une définition du style, comme celle de la littérature, est inévitablement polémique. Elle repose toujours... - Afficher les 27 références
Voir aussi