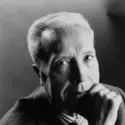STYLE
Article modifié le
Style et subjectivité
Cette analyse montre que le style est produit par un travail et qu'il singularise à la fois la production de ce travail et l'expérience qu'il suscite chez le consommateur du produit. On peut exprimer cette idée en disant que le style se mesure à l'expressivité de l'œuvre, à ce surcroît de sens qui sollicite l'expérience vive du récepteur, et qui doit être éprouvée par le sentiment. Mais faut-il lier cet effet de sens à un surcodage ? Peut-on parler de surcode ? Qu'il y ait une multiplicité de codes, cela va sans dire ; mais il n'y a pas de surcode : ou bien ce ne sont pas encore des codes, ou bien ce sont des codes comme les autres, par exemple ceux qui spécifient la pratique d'un art : à côté du code perceptif, les codes de l'inscription spatiale, de l'image fixe sur la toile ou de l'image mobile sur l'écran ne sont pas des surcodes propres à la peinture ou au cinéma ; ce sont tous simplement les codes propres à ces arts ; ils préexistent à la création. Et les codes a posteriori ? Leur dénomination paradoxale signifie qu'ils ne sont pas reçus du dehors, antérieurement à l'entreprise créatrice ; ils consistent en des moyens nouveaux inventés par le créateur. Mais il n'y a de code qu'institué : tant que ces moyens ne sont pas énoncés, reconnus, convenus, ils ne peuvent constituer un code. De plus, il n'y a de code que structurant : or l'a posteriori ne peut pas surorganiser l'a priori, mais bien le transgresser ; la novation ne restructure qu'à condition de déstructurer d'abord. Et l'art contemporain nous propose plus d'exemples de déstructuration que de restructuration... Si l'on doit pourtant considérer l'œuvre comme un système, c'est comme un système singulier, qui peut échapper à la systématique et qu'il faut distinguer du code. Ainsi Metz, opposant l'étude du langage cinématographique à l'analyse du film, écrit : « Tout code est un système [...], mais l'inverse n'est pas vrai : certains systèmes ne sont pas des codes, mais des systèmes singuliers [...], chaque film est traité comme un texte singulier dans l'exacte mesure où l'on cherche à mettre au jour son système singulier » (Langage et cinéma).
Le code en tant que tel ne suffit cependant pas à définir le style, qui appartient au message ; il faut encore considérer l'usage qui est fait du code. Le système singulier ne comporte donc pas seulement un choix entre les codes disponibles (dans l'exemple du cinéma, code de l'analogie iconique, des mouvements de la caméra, de la ponctuation), donc des refus et aussi des inventions, mais surtout une manière personnelle d'user des codes. Ce qui est systématique ici, c'est la marque d'une subjectivité dans le geste créateur : ce n'est pas le pinceau, c'est la touche ; ce n'est pas la langue, c'est l'accent. Nous revenons à l'analyse de Barthes : dans le travail qui met le code en œuvre s'insinue et se révèle un être au monde singulier, une vision du monde qui est aussi bien un fantasme. Dès lors le style n'a une fonction individuante que parce qu'un individu le crée.
Deux questions se posent encore. Pourquoi et comment indiquer un style collectif lorsqu'on veut classer les œuvres en périodes ou en genres ? C'est qu'on met alors l'accent sur les moyens ou les codes qui sont institués à un moment donné pour un type d'œuvres données et qui sont généralement utilisés par les artistes ; on décide de négliger la façon singulière et parfois subversive dont ils peuvent être utilisés, et on privilégie au contraire les utilisations les plus dociles, les plus impersonnelles. On définit bien alors le style par le système des codes et par le métier qui s'y conforme, mais anonymement et sans déroger aux règles. Cependant, le lexique et la syntaxe de l'art ainsi déterminés produisent dans les œuvres un effet de sens, et il se peut qu'on en réfère ce sens à une subjectivité qui l'a vécu et le communique à une autre. Mais cette subjectivité est générique. Le style gothique n'évoque pas tel maître d'œuvre, il évoque un certain « style de vie » que le récepteur assigne à l'homme gothique ; ce nom anonyme désigne une certaine conscience qui habite et anime le monde gothique où l'amateur est, par l'œuvre, convié à pénétrer. Que cet homme ait été reproduit à un nombre indéfini d'exemplaires est sans importance. Ce n'est pas avec lui comme individu que s'établit la communication, mais avec son monde particulier dès qu'est expérimenté l'effet de sens produit par le style. Peu importe aussi que ce monde puisse être ouvert par d'autres œuvres, en nombre aussi indéfini ; l'essentiel est qu'il soit découvert comme le contenu authentique du style. Le style, si on en reste à repérer les moyens par lesquels est produit le sens, n'est pas clairement défini, il faut encore recueillir ce sens et l'expérimenter par le goût.
Mais toutes les œuvres, même fabriquées sur le même patron, ne livrent pas également un sens : le système des moyens est une condition nécessaire, mais non suffisante. Et tant qu'on découvre dans les œuvres un sens encore général vécu par une subjectivité anonyme, on définit un style et non le style. Peut-être d'ailleurs découvre-t-on ce style sur les œuvres qui ont du style. En sorte que se pose toujours une seconde question : qu'en est-il du style quand il désigne une valeur, un absolu comme dit Focillon, quand il est à conquérir ? Or, on passe aisément du style comme expression de la singularité au style comme qualité. Ainsi Proust : « Cette qualité inconnue d'un monde unique et qu'aucun autre musicien ne nous avait jamais fait voir, peut-être est-ce en cela, disais-je à Albertine, qu'est la preuve la plus authentique du génie, bien plus que dans le contenu de l'œuvre elle-même » (La Prisonnière). Avoir du style, c'est pour une œuvre la même chose que pour l'individu avoir de la personnalité : s'affirmer comme être d'exception, manifester sa différence. Et c'est ici que le vrai style se moque du style, que le système des moyens qui définit un style collectif est transgressé ou subverti par la novation. Comment le style se révèle-t-il alors ? D'abord comme maîtrise du métier, ensuite comme puissance du sens : maîtrise de la technique qui permet... faut-il dire une maîtrise du monde ? On sait avec quelle prédilection Malraux développe ce thème : ce qui caractérise au moins l'art moderne, c'est qu'à la volonté de transfiguration (imitez la belle Nature, disait-on au xviie siècle, signifiant par là : embellissez la nature que vous imitez) il substitue une volonté d'annexion du monde. Mais s'agit-il d'annexion ou d'accueil ? La vision du monde que l'œuvre révèle est moins ordonnée à la volonté de puissance qu'au sentiment. En tout cas, c'est elle qui constitue le sens. Accéder au style, c'est livrer un message singulier, c'est dire quelque chose qui n'a jamais été dit, dans un langage étranger à toute langue, par la vertu d'un sensible à nul autre pareil. Car, si le style réside à la fois dans la maîtrise et l'expressivité, c'est que le secret de l'art est de communiquer le sens à même le sensible, dans la manipulation du matériau : c'est la même chose pour Van Gogh d'avoir une touche tourmentée et de dire un monde tourmenté, c'est la même chose pour Valéry de privilégier le mot ombre et de dire un monde où l'on est voué à vivre sans que la pensée puisse jamais se refermer sur elle-même.
Il faut enfin se demander comment le passage de la singularité à la valeur – à l'absolu de la valeur – peut être franchi. Lorsque l'expression de l'être-soi n'est ni indiscrète ni arbitraire, lorsque la singularité est assez authentique pour se hausser à l'universel. Non point l'universel de la rationalité qui se révèle à ce que tous peuvent suivre un raisonnement, mais l'universel de la sensibilité qui fait que tous peuvent accéder à un monde. L'universel ne va pas sans la nécessité. Cette nécessité dans le sensible – dans la chair et le sens de l'objet – mesure la qualité de l'œuvre, et non d'une subjectivité. Elle requiert à la fois l'invention et la maîtrise des moyens, mais aussi que s'exprime dans l'œuvre, par ces moyens, un visage singulier de la Nature vécu par le sujet créateur. Ce sujet est là pour le vivre : pour répondre à un appel lancé par la Nature. L'universel a sa caution dans la Nature. Et, si le style est la marque de l'ouvrier sur son ouvrage, c'est dans la mesure où l'ouvrier laisse cette marque être celle de la Nature qui l'inspire.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Mikel DUFRENNE : ancien professeur à l'université de Paris-X
Classification
Autres références
-
STYLE (arts)
- Écrit par Frédéric ELSIG
- 2 059 mots
La notion de style appelle des définitions différentes selon les disciplines. En histoire de l'art, elle s'articule sur deux niveaux interdépendants : l'attributionnisme (traduction réductrice de connoisseurship) et l'histoire des formes. Sur le plan pratique, elle désigne la manière...
-
ALAṂKĀRA-ŚĀSTRA
- Écrit par Pierre-Sylvain FILLIOZAT
- 2 014 mots
-
CONTRE SAINTE-BEUVE, Marcel Proust - Fiche de lecture
- Écrit par Guy BELZANE
- 1 253 mots
..., et notamment dans Le Temps retrouvé, qui n'est pas loin d'adopter la forme de l'essai auquel Proust avait songé dès l'origine. Ainsi, en refusant de considérer l'œuvre comme le reflet de la vie, mais en plaidant pour une analyse avant tout stylistique, Proust n'oppose pas seulement... -
CRÉATION LITTÉRAIRE
- Écrit par Gilbert DURAND
- 11 579 mots
- 3 médias
...de sonorités et de sens qui sont des créations. Si tout écrivain ne s'impose pas un rythme – la barre de mesure du musicien –, au moins se donne-t-il un style : le style c'est plus que l'homme, c'est le mouvement d'un désir qui dépasse l'homme. C'est ce mouvement d'écrire, et de lire, qui finalement... -
CRITIQUE LITTÉRAIRE
- Écrit par Marc CERISUELO et Antoine COMPAGNON
- 12 922 mots
- 4 médias
Mais si la contextualisation historique n'est pas pertinente, la stylistique l'est-elle plus ? La notion destyle appartient au langage ordinaire et il faut d'abord l'affiner. Or la recherche d'une définition du style, comme celle de la littérature, est inévitablement polémique. Elle repose toujours... - Afficher les 27 références
Voir aussi