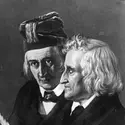SUBLIMATION, psychanalyse
Article modifié le
Invoquer la « capacité de sublimation » pour expliquer en quoi tel individu a échappé à la névrose, comment tel grand homme s'est trouvé produire telle œuvre géniale, n'est-ce point une façon bien dérisoire de répéter la question du pourquoi de la destinée – comme si à cette question une autre réponse était possible, hors l'accomplissement de la vie ? N'est-ce point – pour reprendre l'expression de Nietzsche à propos de la théorie kantienne des « facultés » – effectuer une simple « réponse de comédie » ? La psychanalyse, à laquelle semble revenir de nos jours le privilège d'utiliser cette notion, a-t-elle pu faire autre chose qu'enregistrer le constat de Hölderlin :
Les mortels vivent de salaire et de travail ; dans [l'alternance du labeur et du repos tous sont heureux ; pourquoi donc ne s'endort-il [jamais,l'aiguillon que je porte en mon sein ?
Aussi bien la sublimation se caractérise-t-elle tout d'abord comme un certain type de mutation rapide et admirable. Tel le passage de l'état solide à l'état gazeux, sans phase liquide intermédiaire : les propriétés du corps sublimé demeurent intactes ; bien plus, l'opération apparaît comme un procédé de purification, visant à libérer le corps de ses parties hétérogènes.
Le terme, à la veille du développement de la chimie, était ainsi prédestiné à une transposition dans le registre moral. L'initiative devait en revenir au poète – et commerçant – hambourgeois Brockes, auteur d'une théodicée de la vie quotidienne, Les Plaisirs terrestres en Dieu, dont furent nourris les romantiques allemands. Mais Goethe, le premier, sut dépasser cet usage tout métaphorique, en vue de caractériser la création poétique : les états d'âme, les sentiments, les événements ne sauraient être rapportés au théâtre avec leur naturel originaire ; ils doivent être « travaillés, accommodés, sublimés » (verarbeitet, zubereitet, sublimiert). De même, Victor Hugo, dans La Bouche d'ombre, s'autorise de l'origine chimique du terme, pour réclamer :
La sublimation de l'être par la flamme,de l'homme par l'amour.
La sublimation paraît ainsi une certaine forme de catharsis, celle de l'auteur et non du public, un travail difficile et nécessaire, une conversion de l'être entier à ce qu'il a d'essentiel et de plus vrai.
Esquisser une théorie de la sublimation, ne serait-ce pas alors à bien des égards réassumer l'héritage hégélien, dont on sait d'ailleurs qu'il fut notamment transmis à Freud par l'intermédiaire de James Marck Baldwin, dès 1897 ? De fait, le mouvement de la dialectique, qualifié par Hegel d'aufheben, un critique comme Mure lui donne pour équivalent l'anglais to sublime. Et comment ne pas reconnaître que de la notion anthropologique d'Esprit Freud propose une nouvelle version ? L'Esprit hégélien conçu comme « pouvoir magique de convertir le négatif en être », s'avère « d'autant plus grand qu'est plus grande l'opposition à partir de laquelle il retourne en soi-même ». De même, l'énergie pulsionnelle, susceptible de se conserver tout en niant ses buts primitifs, acquiert par cette négation une puissance d'autant plus haute.
Néanmoins – et telle est la divergence essentielle – la théorie de la sublimation se donne chez Freud un contenu spécifique ; elle s'appuie sur ce que son auteur qualifie cependant lui-même de « mythologie », à savoir une théorie des pulsions. La sublimation consiste à substituer à un but et à un objet sexuels primitifs de nouveaux buts et de nouveaux objets, « éventuellement » plus élevés dans l'estime des autres hommes.
On ne saurait donc comprendre la sublimation indépendamment d'une conception génétique et historique de la subjectivité, pas plus qu'on ne pourrait en constituer la théorie si l'on faisait abstraction du « jugement de valeur » qu'elle enveloppe. Ce dernier, comme on s'efforcera de le montrer, implique la référence de toute conception de la sublimation au champ de l'art et de la religion, référence attestée par la parenté même des termes français « sublime » et « sublimation ». Notons ici leurs correspondants allemands Erhabene et Sublimierung, pour souligner à quel point le sublime paraît tout autant le germe que la fin dernière de ce procès d'arrachement perpétuel à soi et de vibration à la limite du tolérable qui caractérise pour nous la sublimation.
De la purification des traces à la parousie mythique
De l'usage chimique Freud retient la notion de dialyse ; mais d'emblée le concept est rendu solidaire d'une théorie de la mémoire. Et dix ans avant les Trois Essais sur la théorie de la sexualité (1905), les lettres à Fliess laissent présager l'évolution ultérieure, dans une double référence aux registres de l'éthique et de l'esthétique. Plus précisément, la sublimation est alors conçue non seulement comme principe de purification des souvenirs dans l'élaboration des fantasmes, mais encore comme « privilège » des « grands » hommes, capables seuls de conférer leurs lettres de noblesse aux ombres surgies du passé. Que le désir vise au cœur de la réalité l'inexistence comme telle, c'est en même temps dire sa nature nostalgique. Le souvenir voit alors son existence réduite à celle d'un « signe », clignotant étrange issu de traces mnésiques, caractérisées par l'extrême labilité tant de leur teneur que de leur mode d'ordination.
Cependant, certains signes s'avèrent plus efficaces que d'autres, ou plutôt les inscriptions sont susceptibles d'un travail de transposition plus ou moins heureux. Certes, le souvenir est déjà sublimé dans la mesure où il donne lieu, non à une impulsion, mais à un fantasme ; néanmoins, il faut encore établir une hiérarchie entre les fantasmes, puisque certains d'entre eux ont le pouvoir de prémunir contre les conséquences de l'histoire propre du sujet. Ainsi Goethe, prêtant à Werther son propre amour pour Lotte Kästner, parvient à trouver une issue à son désir de mort passionnel en s'identifiant fantasmatiquement à Jérusalem, dont il avait appris la mort tragique. Goethe a « vraisemblablement joué » avec l'idée de suicide, dit Freud, ce dont on trouve confirmation dans le récit autobiographique Poésie et Vérité : l'admiration du poète pour « la grandeur et la liberté d'esprit » avec laquelle l'empereur Othon se donna la mort engendra chez lui une si haute idée de cet acte que la tentative vaine et répétée d'imitation qu'il en fit déboucha sur un éclat de rire. Et la vie, pour reprendre l'expression de Hegel, se mit à « supporter la mort », c'est-à-dire cette crucifixion démente des désirs inassouvis pour un plus libre épanouissement du désir. Dans cet engrenage d'un désir de mort sur un désir de mort sublime s'effectue ainsi la première sublimation, celle où l'instance d'éternité révèle au désir sa carence constitutive, touchant l'obtention d'une satisfaction immédiate.
Goethe résolut donc de vivre ; mais pour que ce rire puisse perdre de son caractère abrupt, il fallait qu'il puisse s'inscrire dans la continuité de l'existence, de sorte que la claire conscience du burlesque fût transformée en raison de gaieté. « Pour pouvoir vivre avec sérénité, écrit Goethe, il me fallait accomplir une tâche poétique, où serait exprimé tout ce que j'avais ressenti, pensé et rêvé sur ce point essentiel. » Aussi bien la tragi-comédie du désir prétend-elle se ressaisir elle-même, dans une œuvre qui en exprime non point tant la réalité historique que la vérité.
La création artistique ne saurait, en effet, résulter d'un retour au passé ; c'est bien plutôt la résurrection de ce même passé impuissant à soutenir son être et effectuant une ultime et dérisoire tentative pour échapper au néant, en se liant dans une « forme » universelle, celle de la réalité effective d'une œuvre. Qu'est-ce alors que la création, sinon la parousie éclatante de ce qu'aurait été, tel un vieux mythe, le premier amour ou la première amitié ? Cités à deux reprises par Freud, les vers de la dédicace du Faust prennent à cet égard une valeur exemplaire :
Vous voici donc à nouveau, formes vacillantes,Qui apparûtes naguère à mes regards encore [troubles.Tenterai-je, cette fois, de vous saisir et fixer ? [...]Comme une vieille légende à demi effacée,Remontent à votre suite les premières amitiés[et le premier amour.
Cependant – Freud le disait lui-même – les propos de Goethe pourraient servir d'exergue à toute analyse. « Trouver l'objet sexuel n'est en somme que le retrouver. »
Mais encore faut-il expliquer comment l'objet ne peut se constituer que dans cet écart décisif qui, du souvenir immatérialisant, conduit au rêve typique : les origines du processus de sublimation sont à chercher dans la période de latence sexuelle chez l'enfant. À cet égard, les Trois Essais sur la théorie de la sexualité peuvent être considérés comme la première tentative systématique d'ancrage historique des pulsions sexuelles : il s'agit, en effet, de mettre en évidence les différents courants constitutifs de ce qui est recouvert du terme générique de « sexualité ». L'hétérogénéité des objets et des buts pulsionnels marquée au niveau de l'étude des perversions trouve son fondement génétique dans le repérage d'une triple source de l'excitation sexuelle : la réitération dans l'accomplissement d'une fonction non sexuelle, l'excitation violente, mécanique ou non, enfin le simple jeu des pulsions de voir et de tourmenter, dont l'opération semble indépendante de l'activité sexuelle localisée. C'est ce qu'il est d'usage de désigner comme la théorie de l' étayage des pulsions sexuelles sur les fonctions non sexuelles, la théorie des zones érogènes, et celle de l'autoérotisme. Mais notons bien ici les mécanismes qui nous intéressent au premier chef : la répétition, l'effraction brusque engendrant une rupture sans précédent, enfin l'attraction et la concentration des forces pulsionnelles faisant suite à leur divergence originelle.
Les caractéristiques de la sexualité infantile, on s'efforcera de le montrer, relèvent ainsi d'une théorie du sublime, au sens où – comme l'a souligné Burke – la terreur en est le « principe fondamental ». Est, en effet, terrible ce qui d'une façon ou d'une autre met en danger de mort, c'est-à-dire éveille les passions les plus fortes, puisque liées à la conservation de soi. Si l'excitation brutale semble dangereuse, toute dépendance à l'égard d'autrui le sera encore davantage. Bien plus, chez le sujet qui en prend conscience, l'obscurité des forces en jeu dans l'émotion sexuelle peut seulement renforcer le sentiment de crainte et de douleur éprouvé. Ce sublime courant dont l'impétuosité l'entraîne irréversiblement vers l'autre, que le sujet en garde à jamais l'empreinte, quoi de moins étonnant ?
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Baldine SAINT GIRONS : maître de conférences en philosophie à l'université de Paris-X-Nanterre
Classification
Média
Autres références
-
AGRESSIVITÉ
- Écrit par Pierre KAUFMANN
- 3 103 mots
...laquelle, « une fois modérée et domptée, et inhibée quant à son but », la pulsion de destruction dirigée contre les objets doit permettre au moi de satisfaire ses besoins vitaux et de maîtriser la nature – en bref, telle est la forme sous laquelle la pulsion de mort entrera dans les voies de la sublimation. -
INCONSCIENT (notions de base)
- Écrit par Philippe GRANAROLO
- 3 276 mots
...prendra le nom platonicien d’« Éros » dans l’ultime construction freudienne. Quant à la seconde réponse, elle consiste en la mise en évidence par Freud de la « sublimation » : « On appelle capacité de sublimation cette capacité d’échanger le but qui est à l’origine sexuel contre un autre qui n’est... -
CORPS - Le corps et la psychanalyse
- Écrit par Monique DAVID-MÉNARD
- 3 972 mots
...décharge, est assimilé au bouclage de ce trajet qui de l'objet revient vers le corps. Non sans cohérence, il s'ensuit que la satisfaction est toujours sublimatoire. Que la décharge soit, sans plus, le bouclage de la pulsion, cela ne va pas de soi ; cela suppose que le moment de l'érogénéité soit conçu... -
FOLKLORE
- Écrit par Nicole BELMONT
- 12 230 mots
- 1 média
...déformant et en les masquant, afin de rendre licite une expression interdite qui veut se faire jour. Il faut alors distinguer ce processus de celui de la sublimation, qui dérive une pulsion sexuelle vers des buts non sexuels (création artistique, investigation intellectuelle), et, par conséquent, il serait... - Afficher les 14 références
Voir aussi