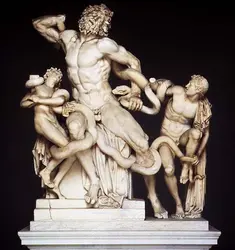SUBLIME
Article modifié le
« Sublime » transcrit le latin sublime, neutre substantivé de sublimis, qui lui-même traduit le grec to hupsos. La formation du mot latin s'explique mal, mais le sens est tout à fait clair : sublimis (de sublimare, élever) signifie : haut dans les airs, et par suite, au sens physique comme au sens moral, haut, élevé, grand. Ce qui traduit parfaitement le grec hupsos, si l'on songe par exemple que ho hupsos, dès la première diaspora en terre hellénique, désigne le Dieu de la Bible : le Très-Haut.
Comme catégorie rhétorique ou critique, le sens de « sublime » paraît s'être fixé au cours du ier siècle après J.-C. Le mot et ses dérivés (sublimitas) sont présents chez Pline et Quintilien. Mais le plus ancien document concernant le sublime – et, pour nous, le texte fondateur de la tradition du sublime – est le traité Perihupsous d'un critique grec du ier siècle, longtemps attribué à tort à Longin, philosophe et rhéteur du iiie siècle, ministre de Zénobie reine de Palmyre, exécuté par les Romains en 273.
Ce texte, redécouvert à la Renaissance, puis traduit et introduit par Boileau en 1674, joue un rôle singulier dans le mouvement de pensée qui, à partir de la querelle des Anciens et des Modernes (les Réflexions sur Longin de Boileau sont de 1693), et en passant par la philosophie anglaise (Shaftesbury, Hutcheson), devait aboutir à la fondation de l' esthétique, en 1750, par Baumgarten. Dès lors, comme l'atteste entre mille exemples l'opuscule rédigé par Kant en 1764, Observationssur les sentiments du beau et du sublime, le concept de sublime, qui entre en concurrence avec celui du beau, tend à devenir en matière de théorie du goût et de philosophie de l'art le concept dominant, jusqu'à ce que Hegel, dans ses leçons de Berlin sur l'esthétique ou sur la religion, lui conteste ce privilège. Mais, par là, il faut bien le reconnaître, Hegel ne sanctionne pas seulement d'un diktat « arbitraire » un motif philosophique majeur, qui ne resurgira plus désormais que de façon sporadique (chez Nietzsche par exemple) ou déguisée (chez Heidegger) ; il entérine, dans l'époque des restaurations esthétiques et politiques consécutives à l'effondrement de l'Empire, la fin d'un engouement ou d'une mode : « sublime » est peut-être le mot sous lequel s'est placée, par excellence, en Europe la seconde moitié du xviiie siècle, Révolution française et romantisme compris : « sublime » aura désigné la vertu et les élans du sentiment ou du cœur, les émotions de la pensée (Diderot, Rousseau), une nouvelle sensibilité contradictoire (le delightfullhorror de Burke), la fin visée par l'architecture monumentale utopique (la « sublime image » de Boullée), la rêverie mélancolique sur les ruines d'un grand passé (Hubert Robert), le courage civique et la mort héroïque imitée de l'antique (les condamnés de la Terreur), le jeu théâtral selon Talma. Le Marat assassiné de David est sublime, mais aussi le Nouveau Monde que découvre Chateaubriand, ou les projets de fête en l'honneur de l'Être suprême. Ce siècle qu'on dit futile, ou frivole, est tenaillé par la grandeur. C'est peut-être la raison pour laquelle c'est Flaubert, dans les années 1880, qui dira l'immense déception du sublime. On trouve dans Bouvard et Pécuchet ce passage impitoyable :
« Ils abordèrent la question du sublime.
Certains objets sont d'eux-mêmes sublimes, le fracas d'un torrent, des ténèbres profondes, un arbre battu par la tempête. Un caractère est beau quand il triomphe, et sublime quand il lutte.
– Je comprends, dit Bouvard, le Beau est le Beau, et le Sublime est le très beau.
Comment les distinguer ?
– Au moyen du tact, répondit Pécuchet.
– Et le tact, d'où vient-il ?
– Du goût !
– Qu'est-ce que le goût ?
On le définit un discernement spécial, un jugement rapide, l'avantage de distinguer certains rapports.
– Enfin le goût c'est le goût, – et tout cela ne dit pas la manière d'en avoir. »
La tradition du sublime
Écrivant ces lignes, Flaubert évacuait une vieillerie devenue scolaire : le sublime avait cessé d'être un concept vivant. Ce faisant, néanmoins, et comme toujours avec une sûreté infaillible, Flaubert condensait en quelques mots toute – ou presque toute – la théorie du sublime. Il en retraçait même la généalogie. Il disait que :
– le sublime est un sentiment qui naît au spectacle grandiose de la nature ou de la force morale de l'homme ;
– le sublime est un beau superlatif ;
– pour le distinguer, comme cela vaut du reste pour tout jugement esthétique, il faut une faculté spéciale, mais inexplicable ou tout au moins énigmatique : le goût, c'est-à-dire ce que Boileau et Fénelon, comme du reste toute leur époque, nommaient précisément le « je-ne-sais-quoi ».
Et l'on pourrait montrer, de fait, qu'à partir du xviie siècle toute la théorie esthétique, c'est-à-dire la théorie du jugement de goût et de la sensibilité, s'est construite sur ces attendus.
S'agissant du sublime, toutefois, cela resterait insuffisant. Car ce qu'il s'agit de comprendre, ce n'est pas du tout qu'il y ait eu une esthétique du sublime, mettons de Boileau à Schelling ou Schopenhauer (voire au Hugo de la Préface de Cromwell), dont de très bons ouvrages retracent l'histoire. Mais c'est plutôt que le sublime, et la question de son rapport avec le beau, ait été l'enjeu d'une interrogation proprement philosophique, où, au-delà d'une éventuelle science de la sensibilité (l'esthétique), c'est le statut même de l'œuvre d'art en sa vérité et le problème de la destination de l'art qui sont en cause. Ce qu'atteste, nous le verrons, le geste brutal de Hegel à l'égard du sublime. Mais ce que dénote encore, plus près de nous, une certaine résurgence, que le mot soit prononcé ou non, du motif du sublime, soit dans la philosophie allemande de l'art de la première moitié du xxe siècle (Benjamin, Heidegger, Adorno), soit dans la réflexion critique contemporaine.
La tradition du sublime est un long commentaire de Longin. Cette tradition n'est assurément pas homogène. Pourtant, il serait difficile de soutenir qu'il y a eu deux lectures de Longin, l'une plutôt rhétorique (et morale), l'autre plutôt philosophique. C'est qu'on a toujours su au fond que le traité de Longin n'est pas simplement un ouvrage de rhétorique, de poétique, voire de critique, même s'il en a toutes les apparences. Boileau le dit très bien à sa manière : « Il faut savoir que par sublime Longin n'entend pas ce que les orateurs appellent le style sublime, mais cet extraordinaire et ce merveilleux, qui frappe dans le discours et qui fait qu'un ouvrage enlève, ravit, transporte. » D'où, au reste, la difficulté qu'il y a à définir le sublime et la sorte d'extase – c'est le mot de Longin – qu'il provoque. D'où également l'insistance mise sur la distinction entre le style sublime, qui se définit d'ailleurs essentiellement par la simplicité, et la chose sublime. D'Alembert : « ... il n'y a point proprement de style sublime, c'est la chose qui doit l'être : et comment le style pourrait-il être sublime sans elle, ou plus qu'elle ? » C'est pourquoi, dit-il encore : « Le sublime doit être dans le sentiment ou dans la pensée, et la simplicité dans l'expression. »
Ce qu'on devine ou qu'on reconnaît dans Longin, c'est en fait que :
– le sublime a à voir avec la vérité, et pas seulement, comme le beau, avec l'apparence. Comme le dit La Bruyère : « Le sublime ne peint que la vérité ; [...] il est l'expression ou l'image la plus digne de cette vérité. »
– le traité de Longin est suspendu à cette unique question, que l'on peut formuler ainsi si l'on joue sur les deux sens du mot « fin » : quelle est la fin de l' art ? (que Longin, de fait, traite exclusivement de l'art du langage n'interdit nullement la portée très générale de son propos, comme c'est du reste le cas dans la Poétique d'Aristote).
C'est-à-dire, d'une part : que vise l'art, et pas seulement du reste l'art oratoire ? À quelles conditions le grand (l'élevé) est-il possible dans l'art ? Ou bien encore : qu'est donc l'art en son essence s'il est destiné à la grandeur ? Mais c'est-à-dire aussi, d'autre part : l'art n'est-il pas achevé ? L'art, qui fut capable de grandeur, en est-il encore aujourd'hui capable ? (comme ce sera la règle dans la tradition du sublime, Longin se place dans une posture proprement moderne, déplorant la fin du grand art, et, pour cette raison, menant exclusivement son interrogation sur les exemples du grand art ancien : Homère, les Tragiques, Pindare, Thucydide et Platon, caractérisés désormais comme inaccessibles).
En d'autres termes, pour ces raisons conjointes, on perçoit tout au long de la tradition, même si c'est le plus souvent de façon obscure, que Longin s'est en réalité interrogé sur l'essence de l'art et que « sublime » est le mot qui porte cette interrogation.
Qu'est-ce qui, dans le traité de Longin, autorise ce soupçon ?
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Philippe LACOUE-LABARTHE : professeur émérite de philosophie à l'université Marc-Bloch, Strasbourg
Classification
Médias
Autres références
-
UN SUBLIME XIXe SIÈCLE : LA PEINTURE SOUS LA RESTAURATION ET LA MONARCHIE DE JUILLET (expositions)
- Écrit par Adrien GOETZ
- 1 521 mots
Le xixe siècle n'est pas tout entier au musée d'Orsay dont les collections commencent en 1848. Ce xixe siècle est celui de la montée de l'industrie, des trains qui remplacent les canaux, de l'aluminium concurrençant la fonte, des impressionnistes, de l'affaire Dreyfus : c'est le « stupide...
-
AFFECTIVITÉ
- Écrit par Marc RICHIR
- 12 231 mots
...peuvent « entraver » la liberté de l'esprit, ce n'est que dans le moment de leur irruption, leur détente incitant à schématiser le temps dans le temps. De la sorte, ils peuvent être dits « sublimes », c'est-à-dire ouvrir, du cœur de leur caractère sensible, sur l'illimité, et, par là, sur l'abîme du suprasensible.... -
ARTS POÉTIQUES
- Écrit par Alain MICHEL
- 5 906 mots
- 3 médias
-
CORNEILLE PIERRE (1606-1684)
- Écrit par Paul BÉNICHOU
- 5 567 mots
- 1 média
...transporte et les enthousiasme, elle aussi qui les durcit contre eux-mêmes quand elle se voit menacée par les mouvements naturels de l'instinct. L'élan du sublime où le moi affirme sa propre grandeur et l'injonction du devoir à laquelle il se plie procèdent du même mouvement glorieux. Psychologiquement,... -
CRITIQUE DE LA FACULTÉ DE JUGER, Emmanuel Kant - Fiche de lecture
- Écrit par François TRÉMOLIÈRES
- 1 040 mots
...expression, n'en a pas moins reçu un considérable écho : c'est que la pensée critique offre une reformulation en profondeur des grandes questions du temps. Ainsi du sublime, qui dans le goût des Lumières avait progressivement supplanté le beau. Comment expliquer l'alliance paradoxale du plaisir, caractéristique... - Afficher les 16 références
Voir aussi