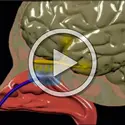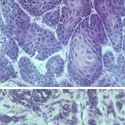TABAC
Article modifié le
La production du tabac
Aperçu botanique
Originaire des pays chauds, exemple type des plantes rudérales, mais susceptible de prospérer sous des climats très divers, le tabac se cultive depuis le 60e degré de latitude nord (Finlande et Suède) jusqu'au 40e degré de latitude sud (Australie). Sa durée de végétation relativement courte (de deux à cinq mois) lui permet de trouver sur la plus grande partie du globe une période suffisamment longue pour parvenir à maturité.
Dans la famille des Solanacées, le genre Nicotiana, groupe, entre autres, tous les tabacs cultivés. Le genre fut décrit par Tournefort pour la première fois en 1719 : plante à tiges herbacées (annuelles) ou sous-ligneuses (pérennantes) ; feuilles isolées et entières ; inflorescence complexe, cymes plus ou moins ramifiées ; calice tubuleux ; corolle en tube, limbe à cinq lobes ; cinq étamines sur la corolle ; ovaire à deux ou quatre loges entouré à la base d'un nectaire, stigmate en forme de tête aplatie ; capsule à deux ou quatre valves bifides ; graines très petites (de 1 200 à 400 m de longueur, de 700 à 300 m de largeur), à téguments au relief sinueux ; embryon charnu.
Deux espèces, groupant un très grand nombre de variétés, nombre qui ne cesse de croître, sont cultivées pour la consommation : N. rustica et N. tabacum.
Nicotine et autres alcaloïdes du tabac
Parmi divers autres alcaloïdes, la nicotine confère au tabac ses caractères propres : elle est l'alcaloïde principal de cette plante et représente de 0,5 à 1,4 p. 100 du poids sec. Isolée par Posselt et Reimann en 1828, sa synthèse fut réalisée en 1913 par Pictet. Les divers alcaloïdes du tabac subissent de nombreuses transformations au cours du séchage, de la fermentation et de la combustion. Ces transformations, encore assez mal connues, sont d'une importance majeure puisqu'elles influent grandement sur la saveur et sur la force des tabacs consommés.
L'action pharmacologique de la nicotine est bien connue et l'on sait qu'elle porte surtout sur les ganglions du système neurovégétatif.
La nocivité des alcaloïdes du tabac explique les vertiges, nausées, vomissements que le fumeur débutant éprouve souvent. Plus sérieuses que ces désagréments impliquant l'appareil digestif sont les atteintes à la fonction cardio-vasculaire : troubles de l'excitabilité cardiaque, tachycardie. Elles annoncent le risque de crises angoreuses et d'infarctus du myocarde.
La nicotine est présente dans chaque partie de la plante, mais très inégalement répartie (de 0,2 p. 100 dans la racine à plus de 5 p. 100 dans la feuille) ; les feuilles restent les parties les plus riches en nicotine, quoique la teneur en alcaloïde soit extrêmement variable selon qu'il s'agit de plantes porte-graines (teneur plus faible) ou de plantes écimées. D'une façon générale et schématique, la teneur en nicotine croît avec la hauteur des feuilles sur la tige de façon assez régulière, et dans la feuille elle-même de la base vers le sommet et de la côte vers les bords. Cette teneur est essentiellement fonction de la variété envisagée : il y a des tabacs riches en nicotine. Le climat et la densité des plants jouent aussi un rôle prépondérant à cet égard, mais c'est au niveau du séchage et de la fermentation que se décide de façon décisive la teneur définitive du tabac commercialisé.
Étapes de la production
Culture
Le tabac cultivé compte un grand nombre de variétés, très différentes les unes des autres par le goût, l'arôme, la combustibilité, la structure ou l'aspect. Ces variations déterminent des « crus » que l'on sélectionne et que l'on mélange de façon à obtenir pour un usage déterminé un produit homogène et constant.
La graine de tabac a besoin d'humidité : elle s'imbibe d'eau et gonfle jusqu'à un seuil de saturation à partir duquel des échanges compliqués s'établissent avec le milieu environnant. La germination nécessite un temps doux plutôt chaud, l'optimum s'établissant entre 25 et 30 0C. Par la suite, de la germination à la floraison, deux périodes principales se détachent : pendant la première période, l'accroissement du système foliaire va de pair avec l'allongement de la plante ; pendant la seconde période, le phénomène d'allongement s'accentue avec la montée des fleurs. La plupart des tabacs sont annuels et fleurissent chaque année, excepté certaines espèces qui doivent attendre la deuxième année pour présenter une floraison normale.
Le développement harmonieux de la plante nécessite des sols légers, argilo-siliceux ou argilo-calcaires ; le rôle joué par le type de sol semble dû surtout à ses qualités mécaniques et à la dimension des particules : les terres légères, bien aérées, susceptibles de laisser l'eau circuler facilement sans retenue excessive, permettent un bon développement de la plante, la formation de feuilles larges, fines, souples et élastiques. Les matières organiques et l'humus sont d'un apport précieux, en rendant plus compactes les terres trop légères et plus meubles les terres trop lourdes, en augmentant la capacité de rétention de l'eau dans tous les cas.
Le tabac est une plante exigeante, et ses besoins journaliers en éléments fertilisants sont d'autant plus importants que sa période de végétation est très courte. Les principales matières fertilisantes absorbées sont l'azote, l'acide phosphorique, la potasse et la chaux. Mais le tabac n'épuise pas véritablement le sol puisqu'une grande partie des éléments absorbés servent à la formation des racines, tiges, feuilles d'épamprement qui retournent normalement au sol.
L'avidité relative de la plante impose fréquemment un assolement, qui peut être biennal ou triennal, avec le blé d'hiver et la betterave fourragère ; elle impose aussi l'emploi d'engrais qui doivent cependant être utilisés avec soin et prudence : l'excès comme le défaut d'éléments tels que chaux, potasse, phosphates, corps nitrés peuvent avoir de graves inconvénients pour la quantité et pour la qualité de la production.
L'époque de plantation joue un rôle souvent déterminant : on sème le tabac de façon à pouvoir le repiquer dans de bonnes conditions ; c'est donc la date de transplantation qui détermine la date d'établissement des semis. Ceux-ci sont réalisés au début du printemps en France, souvent plus tôt aux États-Unis (fin janvier en Floride), tandis qu'à Cuba on sème en octobre pour pouvoir cultiver pendant la saison sèche (de novembre à avril). Les semis restent généralement couverts sous toile jusqu'à la levée du douzième jour et les plants ne seront repiqués en pleine terre que deux mois plus tard environ. Ils portent à ce moment de six à huit feuilles et leur taille varie de 8 à 13 centimètres. Les champs de culture sont préparés, fumés, et l'emplacement des plants déterminé de façon rigoureuse ; la compacité d'une plantation influe en effet fortement sur la teneur en nicotine des feuilles : celle-ci augmente à faible compacité et diminue si les plants sont serrés. Pendant toute la durée de la culture, la plantation est soigneusement protégée contre les attaques microbiennes ou virales : passage aux pesticides, aux antibiotiques, sarclage, terreautage sont répétés fréquemment pour éviter les maladies (mosaïque, frisolée, mildiou, black fire, tobacco wildfire). Au début de juillet intervient l'épamprement (suppression des basses feuilles), puis l'écimage et enfin l'ébourgeonnement ; certains pieds, en raison de leur qualité, sont réservés comme porte-graines.
Récolte et séchage
La récolte pose des problèmes délicats, les feuilles de chaque plante ne parvenant pas toutes à maturité à la même époque. Suivant les cas et selon la destination de la feuille, on devance légèrement la maturité (feuilles de cape de Java) ou on la prolonge (tabac corsé). En France, la récolte se fait feuille à feuille, de la base vers le sommet, le plus souvent en trois temps. D'une façon générale, les tabacs corsés sont récoltés très mûrs, les tabacs légers un peu avant maturité, les tabacs d'Orient et de Virginie à maturité avancée, les tabacs de cape de cigare avant maturité. Après la récolte, les feuilles, soigneusement triées, sont suspendues dans des séchoirs : la dessiccation commence. Elle se décompose en deux phases principales pendant lesquelles on observe le jaunissement de la feuille, puis la dessiccation proprement dite par évaporation. La première phase, pendant laquelle la feuille meurt peu à peu, comporte la transformation de l'amidon en sucres et la décomposition des protéines et des pigments ; une perte importante de matière sèche a lieu à ce moment. La dessiccation proprement dite commence alors : brusque, elle permet d'obtenir des tabacs peu foncés (type virginie bright) ; lente, elle permet le brunissement complet de la feuille. Le séchage peut s'opérer de quatre façons différentes parfois alternées : séchage à l'air libre et au soleil (sun curing), en séchoir (air curing), à feu direct (fire curing), à feu indirect, à l'air chaud (flue curing). On notera que les tabacs « blonds » sont généralement séchés en séchoir.
On dépend alors les feuilles pour les livrer à un long triage (par qualités) d'où ressortent des manoques, liasses de vingt-cinq feuilles environ, qui sont soumises à fermentation.
La fermentation
Après le séchage, le tabac reste sans goût et trop peu sec pour pouvoir se conserver longuement. La fermentation va s'opérer sur des masses de fermentation assez importantes dont la température centrale s'élève peu à peu et atteint parfois 60 0C. On peut aussi poursuivre une fermentation modérée (tabacs d'Orient) ou une fermentation très lente (virginie flue cured).
Dans tous les cas, la fermentation entraîne une diminution des taux de nicotine (généralement de 15 à 30 p. 100), d'acide azotique et des sucres et l'apparition d'acides gras et d'alcools-esters qui confèrent au tabac ses facteurs aromatiques. Plusieurs théories ont été proposées pour expliquer les modifications chimiques dues à la fermentation : oxydation simple des composés de la feuille (Nessler ; Boekhont et de Vries 1909) ; action d'agents microbiens spécifiques pour chaque qualité de tabac (Suchsland, 1891) ; ou catalyse, en présence de l'oxygène aérien, de diastases oxydantes. Aucune de ces hypothèses ne semble suffire isolément à expliquer les processus de fermentation. Il semble plus probable que la conjonction de ces trois actions s'opère généralement au cours de celle-ci. La fermentation reste une opération relativement lente, qui suppose une constante surveillance (élévation des températures centrales et périphériques des masses) et nécessite une main-d'œuvre importante (retournements des masses et aération).
Le stade industriel
Un grand nombre d'opérations vont transformer le tabac pressé et emballé en scaferlati (tabac haché). Il faut composer les mélanges à hacher (jusqu'à trente espèces différentes, plus de dix pour les gauloises françaises), écabocher les pétioles, époularder, mouiller, mettre au repos, écoter (supprimer la nervure principale), capser, c'est-à-dire présenter les feuilles au hachoir selon une orientation correcte.
Après le hachage, le tabac trop humide et dépourvu de goût doit être torréfié, puis subir un refroidissement destiné à diminuer le goût du four. Il est alors définitivement empaqueté pour être expédié à l'usine où il sera transformé en cigarettes ou en cigares.
Certains tabacs blonds sont trop fragiles pour subir un brusque mouillage et la torréfaction consécutive : l'humidification se fait alors en laissant séjourner le tabac en atmosphère humide, ou encore par pulvérisation. Le plus souvent, on procède à deux opérations supplémentaires : le sauçage, destiné à aromatiser les feuilles par adjonction du « casing », qui comporte de la glycérine, de la réglisse, du sucre de raisin ou d'érable, et le flavoring, qui ajoute un parfum spécial dû à une sauce de rhum et d'essences variées : orange, anéthol, pêche, cacao...
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Olivier JUILLIARD : écrivain
- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis
Classification
Médias
Autres références
-
INTRODUCTION DU TABAC EN FRANCE
- Écrit par Bernard VALADE
- 222 mots
- 1 média
Appelée tabaco aux Antilles et en Amérique, petun au Brésil, l'herbe rapportée de ce dernier pays en 1556 par un moine cordelier, André Thivet, serait restée un simple objet de curiosité si Jean Nicot, lors de son ambassade au Portugal, n'en avait fait parvenir des grains, en 1561, à Catherine de...
-
AGNOTOLOGIE
- Écrit par Mathias GIREL
- 4 993 mots
- 2 médias
– au-delà du cas paradigmatique que Proctor explore dans Golden Holocaust, celui del’industrie du tabac, sur lequel existent les archives publiques les plus nombreuses, ces exemples montrent comment, dans certains contextes, on peut « jouer » la science contre la science, utiliser les formalismes,... -
APPALACHES
- Écrit par Jacqueline BEAUJEU-GARNIER , Encyclopædia Universalis et Catherine LEFORT
- 5 990 mots
À l'ouest, la Virginie est renommée pour ses vergers de pommiers et son importante production de tabac à cigare. Pratiquée sur des exploitations de petite taille, cette culture prend aussi une place prépondérante dans l'ensemble du piémont central, mais le tabac y est de moins bonne qualité : la région... -
ARÔMES
- Écrit par Gaston VERNIN
- 1 089 mots
- 1 média
Ensemble de composés volatils odorants émanant d'un aliment et perçu par la voie rétronasale lors de son absorption. Les arômes représentent une composante de la saveur, résultant elle-même de l'ensemble des sensations gustatives et olfactives. Ces molécules, dont la proportion globale...
-
CANCER - Cancer et santé publique
- Écrit par Maurice TUBIANA
- 14 762 mots
- 8 médias
...épidémiologiques ayant démontré, à l'échelle de la population, l'importance prééminente de facteurs extérieurs à l'organisme sont celles qui concernent le tabac. Entre 1930 et 1950, devant l'extraordinaire augmentation de la fréquence du cancer du poumon, les cancérologues suspectèrent les gaz d'échappement... - Afficher les 21 références
Voir aussi
- PRIVILÈGE DU ROI
- IMPÔT, histoire
- MARYLAND
- VIRGINIE & VIRGINIE-OCCIDENTALE
- GOUDRONS
- SEITA (Société d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes)
- TABAGISME PASSIF
- ÉVIN LOI (1991)
- ADDICTION
- CAROLINE DU NORD & CAROLINE DU SUD
- KENTUCKY
- EMPHYSÈME PULMONAIRE
- TOXICOMANIES
- NICOTINE
- DÉPENDANCE, toxicologie
- CIGARETTE
- MONOPOLE DES TABACS
- PIPE
- CIGARE
- RESPIRATOIRE PATHOLOGIE
- MONOXYDE DE CARBONE ou OXYDE DE CARBONE (CO)
- BRONCHITE CHRONIQUE
- FACTEURS DE RISQUE CARDIO-VASCULAIRE
- TABAGISME
- POUMON CANCER DU
- TROUBLES MENTAUX ou TROUBLES PSYCHIQUES