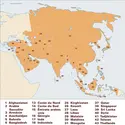- 1. Caractéristiques physiques et humaines
- 2. Chinois et Occidentaux
- 3. Une colonie japonaise
- 4. La république de Chine
- 5. De l'isolement international à la reprise de liens informels
- 6. Les prémices de la démocratisation
- 7. Politique et société contemporaine
- 8. Le développement économique
- 9. La littérature
- 10. Le cinéma
- 11. Bibliographie
TAÏWAN [T'AI-WAN]
Article modifié le
Politique et société contemporaine
L’année 1988, qui s’ouvre avec le décès du président Chiang Ching-kuo, à la tête de l’État depuis 1978, inaugure une nouvelle période de l’histoire de Taïwan marquée par la démocratisation du régime et de la société. Ce processus est engagé par Lee Teng-hui, vice-président puis successeur de Chiang Ching-kuo et premier président d’origine taïwanaise du pays et du Parti nationaliste chinois (Kuomintang, KMT), sur la base de la libéralisation amorcée dans les années 1980.
La mise en place d’une société démocratique à Taïwan
La démocratisation du système politique : 1988-1992
La démocratisation du régime n’est obtenue que de haute lutte, avec le soutien des réformateurs du KMT, sous la pression populaire et de mouvements politiques et sociaux de plus en plus nombreux, et contre une opposition résolue de la vieille garde d’origine continentale du KMT qui craint la fin de son pouvoir et de l’identité chinoise du pays. La levée de la loi martiale en juillet 1987, l’autorisation de voyager en Chine populaire en novembre 1987, la légalisation des partis politiques d’opposition, notamment le Parti démocrate progressiste (Minzhujinbudang, DPP en anglais) fondé en 1986 par des membres du mouvement Dangwai(« hors parti »), puis la libéralisation de la presse en 1988 avaient ouvert l’espace politique et social. Il restait toutefois, d’une part, à garantir les libertés d’expression et d’opinion, assurées en 1992 par la révision de l’article 100 du Code pénal sur la sédition qui permet la libération des derniers prisonniers politiques, le retour des opposants exilés à l’étranger et la fin de la censure, et d’autre part, à régler l’inadéquation de la représentation politique de la population dans le cadre d’institutions établies avant 1949.
La démocratisation réelle du système n’a ainsi lieu qu’après la convocation, en 1990, d’une conférence des affaires nationales ouverte aux partis d’opposition. Celle-ci s’accorde sur le lancement de changements constitutionnels et la transformation des organes représentatifs du régime, annonçant l’élection au suffrage direct des principaux dirigeants locaux (municipalités de Taipei et de Kaohsiung et province de Taïwan, en 1994), puis du président de la République (en 1996), et surtout le départ des députés élus sur le continent chinois avant 1949 et en poste indéfiniment depuis lors. Elle s’accompagne du renouvellement intégral, en décembre 1991, de l’Assemblée nationale (forme de Chambre haute aux pouvoirs restreints), puis, en décembre 1992, de l’Assemblée législative (le Yuan législatif) élue au suffrage universel direct par la population du territoire effectivement sous contrôle de la république de Chine (RDC), soit l’île de Taïwan et ses îlots associés (principalement Penghu, Ludao et Lanyu), et les archipels de Kinmen et de Matsu en bordure du Fujian.
Sur le plan des relations avec Pékin, bien que la République populaire de Chine (RPC) revendique toujours la souveraineté sur Taïwan, rejette toute reconnaissance de la RDC, menace l’île de ses missiles et offre depuis le début des années 1980 une réunification sur le seul modèle d’« un pays, deux systèmes » (yi guoliangzhi), des changements majeurs de la position taïwanaise sont effectués sous la direction de Lee Teng-hui entre 1989 et 1992, qui vont poser les fondements des interactions et du dialogue entre les deux parties pour les décennies suivantes. La fin de la revendication par Taipei de représenter toute la Chine et son acceptation du modèle allemand de double reconnaissance des États divisés par des tierces parties sont suivies par la promulgation, en 1991, des « lignes directrices pour l’unification nationale » (guojiatongyigangling), qui maintiennent l’objectif officiel d’unification avec la Chine et l’affirmation du principe d’une Chine unique, tout en en énonçant les conditions préalables (dont la négociation sur un pied d’égalité, la démocratie, la similarité des systèmes et niveaux socioéconomiques, et le respect des droits et intérêts de la population de Taïwan) et, enfin, par la cessation de la « période de mobilisation nationale pour la suppression de la rébellion communiste » qui permet la reconnaissance de facto du régime communiste chinois.
Sur cette base, des premiers échanges entre Taipei et Pékin par l’intermédiaire de deux organisations semi-gouvernementales – la Fondation pour les échanges à travers le détroit (Haixiajiaoliujijinhui, Straits Exchange Foundation, SEF) pour Taïwan et l’Association pour les relations à travers le détroit (Haixialiang’anguanxixiehui, Association for Relations Across the Straits, ARATS) pour la Chine –, permettent en 1992 d’établir la fiction d’un accord sur l’interprétation par chacune des parties du principe de la Chine unique (plus tard appelé de façon controversée le « Consensus de 1992 »), et la signature d’une première série d’accords techniques lors d’une rencontre au sommet qui se tient à Singapour en 1993 entre les deux délégations.
L’ère démocratique : de 1993 à nos jours
Aboutissement de décennies de conflits et de négociations entre, d’une part, la population taïwanaise et ses aspirations démocratiques et, d’autre part, les forces de l’État autoritaire nationaliste chinois – décennies marquées notamment par le développement, dans les années 1970, d’une classe moyenne revendicatrice de ses droits politiques et par une succession de mouvements politiques, culturels et sociaux d’opposition au régime –, le renouvellement intégral des instances législatives marque l’entrée de Taïwan dans l’ère démocratique. Pour la première fois de son histoire, la société taïwanaise peut, dans son entier, élire ses dirigeants et représentants nationaux, et est à même de porter librement un regard sur son passé et de déterminer démocratiquement son avenir.
Sur le plan socioculturel, la démocratisation du régime ouvre les portes à la réévaluation de l’histoire et de la culture propre de Taïwan, négligées ou réprimées par les politiques de sinisation du KMT, y compris des cultures autochtones austronésiennes, de la période de colonisation japonaise et de la culture populaire en langues vernaculaires. L’entrée en démocratie n’efface toutefois pas un certain nombre de legs douloureux de la période dictatoriale (notamment des victimes du « massacre du 2-28 » et de la « terreur blanche »), d’inégalités sociopolitiques, économiques et culturelles héritées des politiques du KMT, qui favorisent la minorité continentale arrivée de Chine entre 1945 et 1955 (les waishengren), ou de questions d’architecture constitutionnelle. Mais les libertés civiles encouragent les débats publics sur les injustices passées, et l’essor des questions nationales et ethniques auparavant occultées. Les décennies suivantes sont occupées par ces questions, relevant en partie d’une justice transitionnelle incomplète, dont la résolution éveille des sentiments et des craintes complexes, notamment au sein des partisans du KMT, et qui est limitée en outre par l’opposition de la RPC à toute évolution politique de Taïwan hors de l’orbite symbolique de la nation chinoise.
Empêtrées dans un habit constitutionnel taillé pour une autre entité politique et une autre histoire (la Chine républicaine), les années 1990-2000 sont alors scandées par une série d’ajustements et d’amendements constitutionnels destinés à faire correspondre les structures de l’État de la RDC à la réalité taïwanaise. Cela entraîne notamment la suppression du niveau administratif provincial (1998) puis de l’Assemblée nationale (2005), sans toutefois parvenir à un équilibre des pouvoirs satisfaisant, dans le cadre d’un régime semi-présidentiel et d’un système électoral facilitant les conflits institutionnels entre les instances de l’exécutif et du législatif. Parallèlement, au niveau de l’opinion publique, la démocratisation a comme conséquences la formation graduelle d’une nouvelle communauté politique définie par l’exercice démocratique et soucieuse de son indépendance et de son autodétermination, et d’une nouvelle identité nationale taïwanaise de nature civique et territoriale.
Sur le plan électoral, la démocratie n’entraîne pas la fin du pouvoir du KMT. D’abord, sous la direction de Lee Teng-hui, élu président par l’Assemblée nationale en 1990, puis réélu au suffrage universel direct en 1996 mais aussi sans discontinuer au Yuan législatif jusqu’en 2016, le KMT va longtemps conserver sa mainmise sur les scrutins nationaux, aux deux exceptions près des élections présidentielles de 2000 et 2004. La victoire du candidat du DPP Chen Shui-bian à l’élection présidentielle de 2000, à la faveur d’une triangulaire, marque ainsi une étape majeure de la vie politique avec la première transition démocratique et la perte du pouvoir du KMT sur l’État.
Elle lance aussi une première recomposition importante du paysage politique taïwanais avec l’émergence, en 2001, de deux nouveaux partis issus du KMT, le Parti du peuple(Qinmindang, People First Party, PFP) et l’Alliance solidarité Taïwan (Taïwan tuanjielianmeng, Taiwan Solidarity Union, TSU, soutenue par l’ancien président Lee Teng-hui), et l’émergence de deux camps opposés, le camp bleu de tendance pro-unificationniste et favorable à l’intégration économique et culturelle avec la Chine (regroupant le KMT, le PFP et le Nouveau Parti[Xindang, NP] issu en 1993 d’une première scission au sein du KMT), et le camp vert taïwano-centré et soutenant l’indépendance de Taïwan (DPP et TSU). La réélection de Chen en 2004, avec pour la première fois une majorité absolue pour le DPP au niveau national mais avec tout juste 50,11 % des suffrages, se fait sur la base d’une campagne orientée sur l’identité taïwanaise, et entérine les changements identitaires et sociaux amorcés dans les années 1990. Une seconde transition démocratique est opérée avec l’élection de Ma Ying-jeou et le retour du KMT à la tête de l’État en 2008, puis une troisième avec la victoire de la candidate du DPP Tsai Ing-wen à la présidentielle de 2016, confirmant la stabilité et la maturité des institutions et pratiques démocratiques dans le pays, et assurant une alternance des politiques de l’État.
Du point de vue électoral, le pays a longtemps eu tendance à se diviser entre un Sud (autour des villes et comtés de Chiayi, Tainan, Kaohsiung et Pingtung) dominé par le DPP, un Nord (Taipei, New Taipei, où la majorité des électeurs continentaux résident) et les régions Hakka (Taoyuan, Hsinchu, Miaoli) largement contrôlées par le KMT, comme la côte Est peu peuplée où se concentrent les populations autochtones austronésiennes, et un Centre (autour de la région de Taichung) oscillant entre les deux camps. Les évolutions démographiques et politiques des années 2010 ont en partie changé la donne avec une série de victoires des candidats verts et assimilés aux scrutins locaux et nationaux, notamment dans le Nord, attestant de la diffusion croissante des positions nationalistes et sociales du DPP et de sa plus grande crédibilité comme parti de gouvernement parmi l’électorat jeune et centriste.
L’évolution politique et sociale de Taïwan depuis les années 1990
Les années Lee Teng-hui (1988-2000)
Après 1993, les années Lee Teng-hui sont essentiellement marquées par une politique menée au centre et, en dépit d’une compétition électorale féroce, par un compromis de fait entre le KMT et le DPP sur le recentrage des politiques de l’État sur Taïwan, la démocratisation des institutions du pays, y compris la police et l’armée, et, graduellement, la mise sous le boisseau de l’objectif d’unification avec la Chine au profit de la reconnaissance officieuse de l’existence de deux États distincts. La localisation, ou taïwanisation, des instances de l’État et du KMT, amorcée sous Chiang Ching-kuo, est approfondie, tandis que le pays s’ouvre davantage sur l’international et sa région, tant aux plans politique, économique que culturel, et que le gouvernement engage une campagne publique pour obtenir sa représentation au sein de l’ONU, alors que le nombre des États qui reconnaissent diplomatiquement la RDC diminue régulièrement (de 71 en 1969 à 28 en 1990, et 13 en 2023) sous les pressions politiques et l’attractivité financière de Pékin.
Des politiques sociales d’envergure sont également lancées progressivement (assurance santé, couverture sociale, système de retraite), tandis que, suivant les succès économiques du pays et l’enrichissement de la population, les questions sociales et environnementales, jusqu’alors sacrifiées au nom des priorités du développement industriel, remontent au premier plan. Les années 1990 sont aussi caractérisées par la prise de conscience de la composition multiethnique et multiculturelle de Taïwan, avec la reconnaissance des « quatre grands groupes ethniques » (si da zuqun : autochtones austronésiens, Hoklo [Minnan], Hakka, continentaux), l’inscription des droits des autochtones (2,5 % de la population) dans la Constitution, mais aussi la revalorisation de leurs cultures et de la réalité du métissage entre les peuples autochtones et les immigrants du continent chinois qui caractérise l’histoire du pays depuis le xviie siècle. Lee promeut l’idée d’une communauté de destin taïwanais ancrée dans l’expérience politique et historique unique de l’ensemble de la population, regroupant les autochtones et les « Taïwanais de souche » (benshengren : Hoklo et Hakka) tout autant que les « néo-Taïwanais » (xin Taiwan ren) issus des familles exilées de Chine après 1945 ou de l’immigration plus récente d’Asie du Sud-Est (cinquième « groupe ethnique ») ou d’ailleurs. La large victoire (54 %) de Lee à la première élection au suffrage universel du président en 1996, face à une candidature ouvertement indépendantiste du DPP et des candidats représentant la vieille garde du KMT, lui donne une légitimité accrue dans la poursuite de ses politiques modérées, et la défense de l’identité politique et culturelle de Taïwan.
Dans les rapports avec la Chine, après les premiers progrès du dialogue et l’instauration de contacts semi-gouvernementaux réguliers entre les deux rives, les années 1995-1996 sont marquées par de graves tensions, incluant des tirs de missiles chinois à proximité des côtes taïwanaises pour sanctionner la visite privée de Lee Teng-hui à l’université Cornell aux États-Unis et empêcher la tenue de l’élection présidentielle de 1996, poussant Washington à déployer deux porte-avions dans la zone pour soutenir Taipei. Une deuxième rencontre au sommet SEF-ARATS a bien lieu en 1998, mais sans résultat concret, avant que les contacts soient suspendus en 1999 par Pékin, à la suite de la définition par Lee Teng-hui des relations Taïwan-Chine comme des « relations spéciales entre deux États » (teshu de guoyuguoguanxi), qui formule la reconnaissance de la réalité politique à travers le détroit et la nécessaire prise en compte de la souveraineté de la RDC à Taïwan. Ils ne reprendront qu’avec l’élection de Ma Ying-jeou en 2008, Pékin refusant de dialoguer avec le DPP tant que celui-ci ne reconnaît pas le « principe de la Chine unique ».
Parallèlement, les relations économiques entre les deux rives se développent de façon spectaculaire tout au long des années 1990 et 2000, soutenues par la relocalisation d’une partie de l’industrie taïwanaise en Chine, accompagnée d’un large nombre d’entrepreneurs (taishang) et de cadres moyens et supérieurs taïwanais qui alimentent le développement des secteurs chinois d’exportation et de haute technologie, tandis que les voyages touristiques sur le continent se multiplient.
La présidence de Chen Shui-bian (2000-2008)
Au-delà de l’importance symbolique et pratique de l’accès au pouvoir de l’opposition après cinquante-cinq ans de gouvernance ininterrompue du KMT à Taïwan, les années Chen Shui-bian sont marquées par une certaine continuité des politiques de Lee Teng-hui accompagnée d’un renforcement de la taïwanisation de l’État et d’une identité nationale distincte. Sans grande expérience administrative et confronté à une assemblée législative toujours contrôlée par le KMT, le gouvernement DPP se retrouve rapidement dans une situation de quasi-cohabitation, et sa capacité à mettre en œuvre son programme progressiste est de fait soumise à des accords ad hoc avec l’opposition parlementaire.
Dans la suite de Lee, Chen Shui-bian défend la souveraineté de Taïwan et le droit à l’autodétermination des Taïwanais, et affirme l’existence d’« un pays de chaque côté du détroit » (yi bian yi guo). Mais, sur le plan de la diplomatie et des relations avec la Chine, la marge de manœuvre de Chen est étroitement limitée par les menaces et les pressions de Pékin contre toute avancée vers une indépendance formelle, surtout après sa réélection en 2004. Le passage d’une loi autorisant les référendums en 2003, l’organisation de référendums nationaux en 2004, puis l’annonce de la suspension des lignes directrices pour l’unification nationale en 2006 renforcent les inquiétudes des États-Unis, protecteurs de l’indépendance de facto de Taïwan, concernant un risque de conflit dans le détroit, ceux-ci exerçant des pressions intenses pour contenir toute déclaration indépendantiste unilatérale.
À compter de 2005, les tensions politiques, intérieures ou avec la Chine, s’accentuent avec la mise en place d’une collaboration active entre le KMT et le Parti communiste chinois qui annonce la création d’un front commun contre le DPP et l’indépendance de Taïwan, dans la foulée de la promulgation par Pékin d’une loi antisécession qui formalise la menace d’intervention militaire face à toute velléité d’indépendance de jure. Pour autant, et malgré l’absence de dialogue officiel entre les deux rives, l’administration Chen poursuit les contacts avec la Chine pour libéraliser les relations entre le détroit, notamment autour de la question des liaisons aériennes directes réclamées par les hommes d’affaires taïwanais.
Sur le plan économique, paradoxalement, la présidence Chen est ainsi caractérisée par une ouverture croissante des relations commerciales interdétroit et la poursuite des délocalisations industrielles sur le continent, sous l’égide des taishang et des conglomérats industriels taïwanais. Combinées à l’éclatement de la bulle Internet au début des années 2000, aux effets immédiats sur une économie tirée par les exportations, ces délocalisations entraînent des restructurations économiques qui, malgré une solide croissance de 4 % en moyenne annuelle, se traduisent par une stagnation des revenus, alimentant le mécontentement de l’électorat.
Les politiques sociales et environnementales engagées dans la décennie précédente se poursuivent dans la direction d’un État plus présent et régulateur, tout en restant loin des modèles sociaux-démocrates européens. Les libertés publiques et de la presse, et la libéralisation des mœurs continuent à se développer, transformant Taïwan en une des sociétés les plus ouvertes, tolérantes et internationalisées de la région. Le développement des institutions muséales et culturelles, la valorisation du patrimoine et des traditions taïwanaises, tout comme l’essor des pratiques artistiques et littéraires classiques et contemporaines, nourrissent un riche paysage culturel. Dans un climat politique de plus en plus polarisé, les dernières années du mandat de Chen sont toutefois entachées par des accusations de corruption, pour lesquelles il est mis en examen dès 2008 et condamné à dix-sept ans et demi de prison en 2010.
La présidence de Ma Ying-jeou (2008-2016)
La victoire éclatante de Ma Ying-jeou à l’élection présidentielle de 2008 avec 58 % des suffrages s’explique autant par le rejet de l’image de corruption de son prédécesseur que par le désir des Taïwanais d’abaisser les tensions avec Pékin et Washington, et de normaliser les relations économiques avec la Chine. Premier continental à être élu président démocratiquement, Ma fait une campagne axée sur son attachement à Taïwan, la restauration de la compétence administrative, la relance rapide de l’économie et le pragmatisme dans les relations avec la Chine. Dans les faits, derrière le slogan « pas d’unification, pas d’indépendance, pas de recours à la force », les politiques de Ma s’appuient sur un rapprochement économique, culturel et politique graduel avec la Chine dans un objectif ultime d’unification. Il opère ainsi un retour à l’idéologie nationaliste chinoise du KMT d’avant 1993 et refonde la politique chinoise de Taïwan sur la reconnaissance du prétendu « consensus de 1992 » et de la formule d’« une Chine, différentes interprétations » (yi zhonggebiao). Répondant aux souhaits de Pékin, ce changement permet la reprise du dialogue officiel entre les deux capitales à travers les entités semi-gouvernementales dès 2008 puis, en 2014, de façon directe entre des membres des deux gouvernements. Il entraîne la baisse des tensions dans le détroit et la signature de plus d’une douzaine d’accords économiques et techniques, incluant l’ouverture des liaisons aériennes directes en 2008 (plus de 800 vols par semaine en 2014), l’accueil de touristes chinois à Taïwan (croissant jusqu’à un pic à 4,1 millions en 2015), l’autorisation d’investissements industriels chinois dans l’île et la signature d’un accord-cadre de libre-échange en juin 2010.
Pendant le premier mandat de Ma, l’essentiel de l’action gouvernementale se concentre sur les relations avec la Chine, considérée comme la clé de toutes les opportunités économiques et politiques de l’île, au détriment des relations avec les autres pays, et des politiques économiques et sociales intérieures. Mais les problèmes grandissants de l’économie taïwanaise, frappée par la récession mondiale de 2009 et des inégalités de revenus toujours plus criantes, associés à la multiplication de crises administratives et de scandales de corruption touchant le gouvernement et le KMT, écornent durablement l’image et la crédibilité du président. Ma est réélu en 2012 (avec 51,5 % des voix), avec le soutien affiché de toutes les grandes entreprises ayant investi en Chine ainsi que celui de Pékin, mais la faible croissance, le peu d’impact positif des accords avec la Chine sur la majorité de la population et le sentiment d’une administration gouvernementale déconnectée de la réalité des Taïwanais entraînent une profonde crise de confiance envers lui et une chute drastique de sa popularité jusque dans le camp bleu. La poursuite d’une politique accélérée de rapprochement avec la Chine, par le biais de nouveaux accords de libre-échange dans le secteur des services et des marchandises, est de plus en plus mal perçue par la population. Les tentatives bureaucratiques de resinisation de l’éducation et de la culture, et l’usage à des fins partisanes de la police, des instances judiciaires et des médias par le gouvernement suscitent l’opposition et créent un décalage croissant entre les cercles du pouvoir, de nouveau essentiellement d’origine continentale, et le reste des Taïwanais.
Par ailleurs, l’autorisation des investissements et du tourisme chinois à Taïwan a multiplié les contacts entre les deux populations sans que cela ne développe le sentiment d’appartenir à une communauté d’intérêt ou d’identité. À l’inverse, ces échanges participent à la prise de conscience par les Taïwanais des différences culturelles, historiques, politiques et sociales profondes qui les séparent des Chinois, exacerbant la montée de la nouvelle identité nationale, tandis que la pression politique et les menaces militaires de Pékin renforcent leur sentiment d’aliénation envers la Chine. Les sondages d’opinion témoignent de la hausse croissante de l’identité taïwanaise, tant politique que culturelle, aux dépens de l’identité chinoise, non seulement sous les mandats de Chen Shui-bian, mais plus encore à partir de 2008 : en 2014, 60,6 % des répondants se disaient taïwanais, 3,5 % chinois, et 32,5 % taïwanais et chinois, un niveau qui sera dépassé en 2020 avec un sommet à 64,3 % s’identifiant comme seulement taïwanais.
Durant ces années, si la crainte d’une intervention militaire de Pékin pousse les Taïwanais à favoriser dans leur immense majorité le maintien du statu quo actuel, soit une séparation de fait avec la Chine, ils sont de plus en plus nombreux à souhaiter une indépendance à terme plutôt qu’une unification future avec la RPC. C’est particulièrement le cas des jeunes générations, dont le cadre national et sociétal de référence est entièrement taïwanais et démocratique. Cela s’accompagne par ailleurs d’un intérêt élevé pour l’étranger, notamment pour les États-Unis et le Japon, pays de destination traditionnels des Taïwanais pour les études, le tourisme ou le travail, mais aussi l’Europe et toute la région Asie-Pacifique, la Chine étant plutôt perçue comme un choix opportuniste ou forcé pour avancer sa carrière. Les récentes évolutions de l’opinion publique manifestent ainsi continuellement l’élargissement du fossé entre les aspirations nationales des Taïwanais et les projets irrédentistes de Pékin, au-delà des interactions économiques et personnelles régulières entre les deux sociétés.
L’opposition à la politique sino-centrée de Ma Ying-jeou se cristallise dans le mouvement des Tournesols (taiyanghuayundong, ou mouvement étudiant du 18 mars, 318 xueyun), en mars 2014. Tournant majeur de l’évolution sociopolitique du pays, il constitue le point culminant d’un nombre grandissant d’actions de la société civile contre les politiques sociales, économiques, médiatiques, environnementales et chinoises de Ma Ying-jeou depuis 2008. Suscité par la tentative d’un passage en force de l’accord de libre-échange sur les services avec la Chine (Haixialiang’anfuwumaoyixieyi ou Cross-Strait Service Trade Agreement, CSSTA), ce mouvement va aboutir à l’occupation pacifique pendant trois semaines du Parlement taïwanais par un groupe d’étudiants et d’activistes exigeant le respect par le KMT des procédures et de l’esprit démocratiques, très vite soutenu par un sit-in quasi permanent de manifestants devant le Parlement. Le mouvement obtient dans les sondages le soutien de plus de 60 % de la population, qui craint une domination des grands groupes chinois sur le secteur des services taïwanais, essentiellement composé de PME. Après des tentatives de radicalisation du conflit, une issue est trouvée, contre le souhait de Ma, à travers une coopération entre le président KMT du Parlement, Wang Jin-pyng, et le DPP, suspendant ad vitam aeternam tout examen législatif du CSSTA en échange de l’évacuation du Parlement. L’issue du mouvement met fin en pratique au programme pro-unification du gouvernement, et annonce la domination politique d’une ligne taiwano-centrée pour les années à venir. La défaite cuisante du KMT aux élections locales de novembre 2014 confirme sa perte de légitimité. Même le sommet historique entre Ma Ying-jeou et Xi Jinping, en novembre 2015 à Singapour, officiellement en tant que président respectif du KMT et du Parti communiste chinois, sera perçu comme un simple coup médiatique sans bénéfices pour Taiwan, renforçant l’image d’un KMT trop prêt à accéder aux désidératas du PCC au nom d’un nationalisme chinois largement minoritaire à Taiwan.
La présidence de Tsai Ing-wen (2016-2024)
La large victoire de la candidate du DPP, Tsai Ing-wen, à l’élection présidentielle de janvier 2016, avec 56,1 % des voix, confortée par l’obtention d’une majorité des sièges au Parlement par son parti – une première historique –, traduit au niveau électoral l’adhésion croissante à un discours progressiste et d’autodétermination au sein de la population. Le rejet explicite par Tsai du soi-disant « Consensus de 1992 » au profit d’une réorientation de la politique internationale vers les États-Unis, le Japon et l’Asie du Sud-Est, accompagné d’une politique plus sensible aux inégalités sociales et aux valeurs démocratiques, incarne la voie distincte taïwanaise à laquelle les nouvelles générations s’identifient. L’élection de Tsai, première femme cheffe d’État à Taiwan, et d’un nombre record de candidates de tous partis au Parlement, manifeste de façon spectaculaire l’évolution des mentalités de plus en plus éloignées du patriarcat et du paternalisme traditionnels des sociétés de culture sinitique. Avec une grand-mère paiwan (peuple autochtone austronésien), issue d’une famille hakka mais essentiellement éduquée en chinois mandarin, Tsai représente également bien les mélanges et trajectoires historiques du peuple taïwanais. Célibataire, brillante étudiante (doctorat à la London School of Economics) et haut fonctionnaire proche de Lee Teng-hui, elle symbolise enfin parfaitement l’accession des femmes taïwanaises à une vie choisie et à une carrière autonome au plus haut niveau.
Du côté du KMT, si la déroute s’explique en partie par des tensions profondes entre ses différentes factions et une campagne électorale désastreuse, l’écart croissant entre son idéologie nationale chinoise et la réalité du pays met le parti, d’une façon plus urgente encore que dans les années 1990, face au choix de se taïwaniser ou de se marginaliser au niveau national. Son soutien électoral se concentre chez les plus de 50 ans et dans les régions rurales, montagneuses ou peuplées en majorité de continentaux, de Hakkas et d’autochtones, tandis que les jeunes d’origine continentale adoptent largement une identité taïwanaise et démocratique, selon le modèle classique de socialisation des troisièmes générations de descendants d’immigrés dans la majorité nationale.
Le retour au pouvoir du DPP entraîne immédiatement la rupture par Pékin des relations intergouvernementales avec Taïwan, puis un mélange de mesures coercitives et incitatives de la part de la Chine (limitation du nombre de touristes chinois, suppression des achats ciblés de marchandises taïwanaises, débauche des alliés diplomatiques de la RDC, menaces militaires, traitements de faveur pour les entrepreneurs taïwanais en Chine, etc.). Plutôt que de contraindre Tsai à adopter la politique interdétroit du KMT, ces décisions renforcent l’image d’une Chine agressive et dangereuse au sein de la majorité des Taïwanais qui soutient le rejet du « Consensus de 1992 ». D’autres défis, souvent occultés par les administrations précédentes, se présentent par ailleurs devant le DPP qui doit encore faire ses preuves en tant que parti de gouvernement : restructuration industrielle après les vagues de délocalisation vers la Chine ; croissance des inégalités de revenus générée par la mondialisation et les politiques néolibérales ; équilibre des finances publiques et des fonds de pension ; infrastructure des transports publics ; transition énergétique et environnementale ; justice transitionnelle pour documenter et réparer les crimes et malversations commis sous la dictature du KMT ; déficit démographique (taux de fécondité égal ou inférieur à 1,2 depuis 2005). Dans le cadre de tensions accrues avec Pékin, la décision de Tsai Ing-wen de renforcer les capacités industrielles et militaires nationales, et de mettre en place des politiques axées sur le long-terme s’appuyant d’abord sur de hauts fonctionnaires favorisant la stabilité, la rigueur financière et les petits pas a généré déceptions et résistances dans son camp comme chez ses opposants. Deux décisions prises lors de son premier mandat l’illustrent : d’une part, l’allongement des cotisations et la réduction des retraites des fonctionnaires, jusque-là très généreuses et financées à travers l’impôt, qui touchent durement un électorat longtemps favorisé par le KMT, mais qui reçoivent le soutien de la majorité du pays et surtout des jeunes générations dont les salaires sont souvent bien inférieurs aux retraites publiques ; d’autre part, la reconnaissance du droit au mariage des couples homosexuels, non directement par une loi à cet effet mais par le biais d’une décision de la Cour suprême taïwanaise jugeant inconstitutionnelle sa restriction aux seuls hétérosexuels, un jugement pris par une majorité de juges nommés par Tsai malgré une opinion publique qui y était encore opposée, comme l’indique un référendum consultatif sur la question tenu lors des élections locales de 2018.
Celles-ci marquent le creux de la popularité de Tsai et manifestent une complexification du paysage électoral. Alors que les maires sortants DPP du nord du pays sont réélus, les municipalités de Taichung et de Kaohsiung basculent pour le KMT sous l’impulsion d’une vague nationale d’enthousiasme pour Han Kuo-yu, candidat à la mairie de la métropole méridionale. Ce dernier semble avoir réussi l’impossible : allier un discours pro-unification et conservateur, et une image taïwanisée proche du peuple. Le choc de sa victoire et le passage de plusieurs référendums soutenus par le KMT ébranlent le camp vert et la jeunesse progressiste. Ils s’expliquent toutefois autant par une mobilisation réussie des factions locales qui ont toujours été favorables au KMT et la personnalité unique de Han qui est parvenu à attirer une grande partie de l’électorat désabusé de la politique, en particulier les perdants de la mondialisation qui se méfient des élites technocratiques du DPP comme du KMT. Les années suivantes montrent que ces succès ne sont qu’éphémères, Tsai et le DPP reprenant la main grâce à une série d’événements favorisant leur politique et leur discours national. Le 2 janvier 2019, un discours de Xi Jinping aux Taïwanais déniant toute validité à la lecture du « principe de la Chine unique » favorisée par le KMT (yi zhonggebiao,« une Chine avec chacun son interprétation ») donne à Tsai Ing-wen l’opportunité d’apparaître comme la seule à même de défendre la souveraineté et la sécurité de Taïwan. Quelques mois plus tard, alors que les politiques économiques et sociales du DPP commencent à faire sentir leurs effets positifs, et que Tsai Ing-wen remporte de nouveau une primaire difficile, la répression du mouvement démocratique à Hongkong met un terme définitif à toute illusion sur les promesses de respect par Pékin du modèle d’« un pays, deux systèmes ». Le pari du choix de Han Kuo-yu comme candidat du KMT à la présidentielle six mois après son élection à la magistrature de Kaohsiung se conclut, d’abord, par une réélection magistrale de Tsai avec 57,1 % des voix en janvier 2020 et le maintien de la majorité parlementaire du DPP, confirmant le rejet de la ligne du KMT par les jeunes générations et les électeurs du milieu qui se tournent de plus en plus vers des partis tiers, comme le Parti du peuple taïwanais (Taiwan minzhongdang) nouvellement créé par le maire sans étiquette de Taipei, Ko Wen-je, puis par la destitution, par les urnes, de Han de son poste de maire par un électorat sanctionnant son opportunisme.
Le deuxième mandat de Tsai Ing-wen suit largement les politiques entamées depuis 2016, dont les succès se confirment. Il est aussi marqué par trois phénomènes concurrents : l’aggravation des pressions militaires chinoises sur Taïwan, le renforcement de la guerre commerciale et du conflit politique entre la Chine et les États-Unis, et la crise de l’épidémie de Covid-19 qui démarre le mois même de sa réélection. Ensemble, ils ont pour effet de mettre en relief l’importance économique et stratégique de l’île, centre névralgique de l’industrie mondiale des semi-conducteurs, de stimuler l’économie taïwanaise bénéficiant de la relocalisation de ses industries de pointe, de la réorganisation des circuits d’échanges mondiaux et de la demande suscitée par la généralisation des activités « en ligne », et de démontrer la compétence de l’administration sanitaire (avec l’un des taux de décès liés à la Covid-19 les plus bas au monde) et économique du gouvernement dirigé par le Premier ministre Su Tseng-chang (en poste de 2019 à 2023), ainsi que la résilience du pays face aux chocs extérieurs. Sur le plan stratégique, le renforcement de l’alliance militaire de facto avec les États-Unis, et l’émergence du Japon comme partie prenante de la protection du statu quo dans le détroit de Taiwan, encore accélérés par la guerre d’Ukraine à compter de 2022, caractérisent cette période, mettant toujours davantage la sécurité du pays dans le périmètre de défense américain, alors que la Chine multiplie les provocations et préparations militaires pour une éventuelle invasion de l’île.
Les élections locales de 2022 servent de nouveau de soupape de frustration à un électorat déçu des mesures de compensations financières liées à la baisse d’activité des services due aux restrictions sanitaires, et ce, malgré une croissance du PIB, tirée par les exportations, de 4,1 % en moyenne entre 2020 et 2022. Mais elles illustrent aussi, en dépit d’une abstention record, une satisfaction populaire envers les gouvernements locaux dirigés par le KMT dont les sortants sont presque tous réélus. Pour ce parti, le choix d’un candidat pour le scrutin présidentiel de 2024 et d’une plateforme électorale nationale qui attire la majorité de la population à l’identité taïwanaise marquée, sans toutefois abandonner son idéologie sino-centrée, se présente comme un nouveau test. Le DPP fait, lui, face au défi de remporter une troisième élection présidentielle de suite, exploit encore jamais accompli dans l’histoire démocratique taïwanaise, avec à sa tête le vice-président, ancien Premier ministre et ancien maire de Tainan, Lai Ching-te, et de conserver sa majorité législative. Un troisième candidat, comme Ko Wen-je, pourrait influencer le résultat final, à la présidence et au Parlement, de même que les actions de Pékin et de Washington dans leur lutte pour l’hégémonie dans le Pacifique occidental.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Philippe CHEVALÉRIAS : docteur en études chinoises (Institut national des langues et civilisations orientales, Paris), maître de conférences en langue et civilisation chinoises à l'université Charles-de-Gaulle Lille 3
- Évelyne COHEN : chercheur de troisième cycle à l'université de Paris-VII
- Jean DELVERT : docteur ès lettres, professeur émérite à l'université de Paris-Sorbonne
- François GODEMENT : maître de conférences à l'Institut national des langues et civilisations orientales, maître de recherche à l'Institut français des relations internationales
- Adrien GOMBEAUD : journaliste
- Frank MUYARD : maître de conférences, responsable du centre de Taipei de l'Ecole française d'Extrême-Orient
- Angel PINO : professeur émérite des Universités, université Bordeaux Montaigne
- Isabelle RABUT : professeure émérite à l'Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco)
- Pierre SIGWALT : docteur de troisième cycle en études sur l'Extrême-Orient et l'Asie-Pacifique, consultant-formateur Chine, journaliste
- Charles TESSON : critique de cinéma, maître de conférences en histoire et esthétique de cinéma, université de Paris-III-Sorbonne nouvelle
- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis
Classification
Médias
Autres références
-
TAÏWAN, chronologie contemporaine
- Écrit par Universalis
-
SHIMONOSEKI TRAITÉ DE (17 avr. 1895)
- Écrit par Vincent GOURDON
- 184 mots
L'annexion de Formose par le Japon est réalisée par le traité de Shimonoseki (17 avril 1895) qui achève la courte guerre sino-japonaise de 1894-1895. Elle marque la véritable entrée du Japon dans le cercle restreint des puissances impérialistes de la fin du xixe siècle. Longtemps fermé...
-
ASIE (Structure et milieu) - Géographie physique
- Écrit par Pierre CARRIÈRE , Jean DELVERT et Xavier de PLANHOL
- 34 880 mots
- 8 médias
Taiwan, 35 970 km2, qu'un détroit peu profond, vraisemblablement un fossé tectonique, sépare de la Chine, est une île très montagneuse : le point culminant atteint 3 997 m dans le Yushan et le tiers de l'île a plus de 1 000 m d'altitude. Le relief dissymétrique dessine une concavité vers le Pacifique... -
ASIE (Géographie humaine et régionale) - Dynamiques régionales
- Écrit par Manuelle FRANCK , Bernard HOURCADE , Georges MUTIN , Philippe PELLETIER et Jean-Luc RACINE
- 24 799 mots
- 10 médias
Pendant la colonisation japonaise, la Corée etTaïwan se modernisent : infrastructures, quelques industries lourdes, développement agricole, instruction publique, formation d'une classe de technocrates. Une fois l'indépendance acquise et les troubles de la « guerre froide » dissipés, la réforme agraire... -
CHIANG CHING-KUO (1909-1988)
- Écrit par Yves SUAUDEAU
- 493 mots
- 1 média
Fils de Chiang Kai-chek (Tchiang Kai-chek) qui l'envoie, adolescent, suivre les cours de l'université Sun Yat-sen à Moscou, Chiang Ching-kuo (Jiang Jingguo) ne regagne la Chine qu'en 1937, soit dix ans après la rupture intervenue entre son père et Moscou. En Union soviétique, le jeune Chiang est entré...
- Afficher les 27 références
Voir aussi
- DENSITÉ DE POPULATION
- ANTICOMMUNISME
- BLOCS POLITIQUE DES
- TYPHONS
- HOLLANDAIS EMPIRE COLONIAL
- FRANCO-CHINOISE GUERRE (1884)
- CANONNIÈRE POLITIQUE DE LA
- EXTRÊME-ORIENT
- ALLIANCES MILITAIRES CONTEMPORAINES
- GUERRES D'INDÉPENDANCE & INSURRECTIONS PATRIOTIQUES
- CHEN SHUI-BIAN (1950- )
- DÉMOCRATISATION
- TAÏWANAISE LITTÉRATURE
- ZHANG WOJUN ou CHANG WO-CHUN (1902-1955)
- CHEN JIYING ou CH'EN CHI-YING ou TCH'EN KI-YING (1908-1997)
- BAI XIANYONG (1937- )
- LI ANG (1952- )
- MARIAGE HOMOSEXUEL
- CEINTURES OROGÉNIQUES PÉRIPACIFIQUES ou CERCLE DE FEU DU PACIFIQUE
- CHINE, géographie
- SINO-AMÉRICAINES HISTOIRE DES RELATIONS
- MOUVEMENT SOCIAL
- TREMBLEMENT DE TERRE
- CHINE, histoire : l'Empire, des Yuan à la Révolution de 1911
- CHINE, économie
- ZHENG CHENGGONG [TCHENG TCH'ENG-KONG] ou KOXINGA (1624-1662)
- LIU MINGCHUAN [LIEOU MING-TCH'OUAN] (1836-1896)
- LIU YONGFU [LIEOU YONG-FOU] (1837-1917)
- GOTO SHIMPEI (1857-1929) proconsul de Taïwan (1898-1906)
- CHUNGYANG SHANMO
- MANJI PSEUDO-SOCLE DE
- PESCADORES ARCHIPEL DES, chin. PENGHU [P'ENG-HOU]
- MA YING-JEOU (1950- )
- TSAI MING-LIANG (1957- )
- CROISSANCE ÉCONOMIQUE
- EXPORTATIONS
- GUOMINDANG (GMD) ou KUOMINTANG ou KOUO-MIN-TANG (KMT)
- JAPON, histoire, de l'ère Meiji à 1946
- ÉCHANGE, économie
- DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE
- IMPÉRIALISME CULTUREL
- POÉSIE CHINOISE
- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, économie
- CHINOISE LITTÉRATURE, XXe et XXIe s.
- RELATIONS ÉCONOMIQUES INTERNATIONALES
- COMMERCE DES ARMES
- JAPONAIS, langue
- CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE
- TAÏWAN CINÉMA DE
- ZHU TIANXIN (1958- )
- WEI TE-SHENG (1969- )
- ANG LEE (1954- )
- TSAI ING-WEN (1956- )
- SYAMAN RAPONGAN (1957- )
- LUO YIJUN (1967- )
- WUHE (1951- )
- LI YONGPING (1947-2017)
- ZHANG GUIXING (1956- )