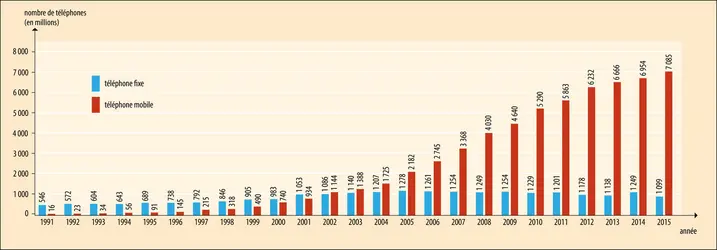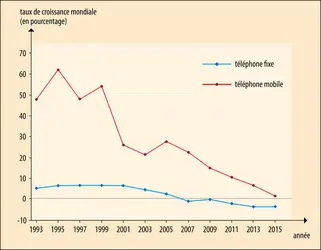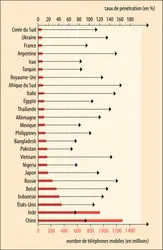- 1. La téléphonie sans fil à la conquête du monde
- 2. La téléphonie sans fil s’ouvre aux données
- 3. L’expansion des réseaux de données sans fil
- 4. Le téléphone mobile, « couteau suisse » du sans-fil
- 5. Le micro-ordinateur portable et autres objets communicants
- 6. Vers une connectivité universelle
- 7. Bibliographie
TÉLÉCOMMUNICATIONS La communication sans fil
Article modifié le
La téléphonie sans fil s’ouvre aux données
Dès que le sans-fil a pris son essor dans les pays européens, les commodités qui firent le succès des petits téléphones mobiles (compacité, facilité d’utilisation, taux de couverture des réseaux important, mobilité durant les communications) allaient vite déborder du seul domaine de la téléphonie grâce aux SMS (Short Message Service), ces messages courts – ou « textos » – qui, à partir de la fin des années 1990, ont fini par constituer, à côté du téléphone, une source importante de revenus pour les opérateurs. Mais, c’est surtout, en 1999, le succès du iMode au Japon (des services multimédias spécialement ciblés pour les mobiles) qui convainc les opérateurs et les industriels du monde entier que la transmission/commutation de données – soit directement de mobile à mobile (dans le cadre d’un service de SMS enrichis du multimédia), soit pour accéder à Internet voire à la télévision – est appelée à se développer. Ces services représenteraient à terme un marché plus important que le simple téléphone.
Ce mouvement s’est affirmé à partir des années 2000, avec le succès d’une nouvelle génération de téléphones portables appelés smartphones. Ces derniers, outre la fonction téléphone, permettent de consulter le courrier électronique et Internet, entraînant une croissance importante du trafic de données.
Or les réseaux 2G, qui établissent entre les abonnés en communication des chemins ou circuits (technique dite à commutation de circuits) qu’ils sont seuls à utiliser pendant la durée de l’appel, sont mal adaptés à la commutation de données. Ces dernières, pour être traitées efficacement, nécessitent la mise en œuvre d’une autre technique qui a été mise au point pour Internet : la commutation de paquets. En traitant une connexion à Internet comme si c’était un appel téléphonique, les réseaux 2G ne peuvent pas tirer parti du caractère sporadique, marqué de fréquents silences (pendant lesquels la liaison reste inutilisée, mais occupée), des données circulant sur une liaison Internet. Ainsi, sur les réseaux 2G, les connexions à Internet sont limitées en débit (autour de 10 kbit/s) et en nombre (pour ne pas pénaliser le trafic téléphonique).
D’où le lancement des systèmes 3G, spécialement étudiés pour pouvoir commuter à volonté des circuits (voix) ou des paquets (données), selon les besoins. Prévus pour 2002, ils n’ont en fait été déployés qu’à partir de 2005 du fait de l’éclatement de la bulle Internet en 2001. Ce retard à faire évoluer les réseaux 2G afin d’y greffer la commutation de données pour servir dans de meilleures conditions la nouvelle demande.
Une première évolution, dite 2,5G, apparaît en 2001. C’est le GPRS (General Packet Radio System), une technique qui, par une simple évolution logicielle des commutateurs de services mobiles et des stations de base des réseaux GSM (cf. Télécommunications – Les transmissions radio), permet d’agréger un à huit canaux d’une cellule radio, selon les besoins (priorité étant cependant laissée au trafic téléphonique) pour la commutation/transmission de données en mode paquets. La ressource ainsi mobilisée peut être partagée entre tous les mobiles d’une même cellule radio. En parallèle, plusieurs protocoles – notamment le WAP (Wireless Application Protocol) – sont créés ou adaptés pour que l’accès à l’Internet mobile se plie aux conditions particulières des réseaux cellulaires (faible débit, temps de latence élevé, mobilité durant les sessions). Des portails Internet avec des services spécialement destinés aux usagers mobiles sont créés. Les SMS peuvent être enrichis d’images fixes ou de clips vidéo : ils sont alors appelés MMS (Multimedia Messaging Service). Mais, pour accéder à ces services, le public doit s’équiper de nouveaux téléphones compatibles GPRS.
Avec le GPRS, l’accès à Internet depuis un mobile devient quatre fois plus rapide (40 kbit/s en moyenne). En 2004, une deuxième évolution du GSM, baptisée EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), dite encore 2,75G, permet d’atteindre 120 kbit/s.
À partir de 2005, avec le déploiement des réseaux 3G, le débit de données par utilisateur est porté jusqu’à environ 384 kbit/s. Mais, à peine arrivés, ces nouveaux réseaux connaissent déjà une première évolution, dite 3,5G, avec les HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) et HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) testés en France en 2006. Elle permet d’atteindre des débits moyens de 1,1 Mbit/s pour le sens descendant (réseau vers terminal) et 128 kbit/s dans le sens montant, valeurs qui seront doublées par la suite.
La croissance de la demande pour l’Internet mobile et tous les services associés (courriel, messagerie en ligne, réseaux sociaux et la myriade de sites commerciaux) connaît une nouvelle accélération à partir de 2007 avec l’arrivée du modèle iPhone de la société américaine Apple (qui inaugure ainsi une nouvelle génération de smartphones dont l’écran tactile couvre toute la face avant du terminal), puis avec le succès des tablettes graphiques tactiles à partir de 2010. D’où le déploiement d’une quatrième génération de réseaux (4G) à partir de 2012, pour laquelle on a transposé au sans-fil les techniques développées pour l’Internet fixe.
Avec la 4G, on change d’échelle pour aborder le mobile large bande puisque les débits par terminal peuvent atteindre 30 à 300 Mbit/s. Cela confère des temps de réponse plus courts aux requêtes, et donc une plus grande fluidité à la navigation Internet. Cela ouvre aussi à de nouvelles applications multimédias : jeux, télévision haute définition. Même s’il s’agit là de débits crêtes (le débit moyen dépendant du nombre d’utilisateurs simultanés et du trafic téléphonique, qui reste prioritaire), les conditions de confort deviennent alors comparables, sinon identiques, à ce qu’elles sont avec une liaison ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line).
Dans les réseaux 4G, la communication de type Internet entre abonnés et serveurs représente le trafic le plus important. À partir des années 2010, on voit apparaître des objets connectés (il s’agit de terminaux spécialisés équipés de l’interface IP, ce qui les rend connectables au réseau Internet) avec lesquels l’abonné peut interagir (télésurveillance, mise en route du chauffage à distance et autres capteurs de toutes sortes). Et puis apparaissent des réseaux autonomes de capteurs (stations météorologiques par exemple) qui envoient automatiquement leurs mesures à des serveurs à travers Internet. Il s’agit dans ce cas de communication de machine à machine (machine to machine communication ou M2M). Le trafic M2M se développe rapidement, au fur et à mesure que les objets connectés se répandent, ce qui fait craindre une saturation rapide des réseaux 4G. Une nouvelle norme devrait apparaître dans les années 2020, la 5G, permettant des débits encore plus élevés, de l’ordre de 1 à 2 Gbit/s, voire 5 Gbit/s. Elle fera appel à de nouvelles bandes de fréquences radio et devra permettre la connexion sans fil à Internet de la myriade d’objets communicants (Internet of things) dont on prévoit l’arrivée.
Pour satisfaire la demande, cette évolution a conduit à faire coexister dans la majorité des pays des réseaux de différentes générations, ce qui n’a pas été sans complications techniques tant chez les fournisseurs de réseaux que chez les fabricants de terminaux. Le parc mondial de matériels a ainsi évolué au fur et à mesure de l’expansion du sans-fil. Jusqu’en 2008, la croissance s’est faite essentiellement avec les réseaux 2G. Ceux-ci ont connu leur apogée en 2011, pour ensuite commencer une lente décroissance avec la montée en puissance des réseaux 3G puis 4G : lorsque la couverture géographique d’un pays approche 100 p.100, la densification du réseau est en général assurée avec des matériels 3 et 4G. En 2014, 60 p. 100 des abonnés (en très grande majorité dans les pays en développement) étaient encore desservis par les réseaux 2G contre 40 p. 100 pour les 3G et 4G. Les projections montrent une évolution de ces proportions vers, respectivement, 30 p. 100 et 70 p. 100 en 2020. L’Internet mobile à haut débit tend à devenir la norme.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Alexandre COTARMANAC'H ECHEVARRIA : ancien élève de l'École polytechnique, ingénieur du corps des télécommunications
- René WALLSTEIN : ingénieur consultant
Classification
Médias
Autres références
-
4G, télécommunications
- Écrit par René WALLSTEIN
- 1 573 mots
Le déploiement en France du réseau de communications sans fil de quatrième génération pour les terminaux mobiles, la 4G, engagé en 2012 en direction des entreprises, s’est poursuivi et amplifié en 2013 vers le grand public. La France, comme ses voisins européens, suit ainsi le mouvement initié à...
-
ANTENNES, technologie
- Écrit par Jean-Charles BOLOMEY
- 5 198 mots
- 7 médias
Les possibilités offertes par la propagation des ondes électromagnétiques dans les milieux naturels sont exploitées à des fins multiples : radiodiffusion, télévision, radar, télécommunications, radionavigation...
Dans toutes ces applications, l'antenne désigne ce composant indispensable au...
-
ATMOSPHÈRE - La couche atmosphérique terrestre
- Écrit par Jean-Pierre CHALON
- 7 817 mots
- 7 médias
...La présence de couches ionisées (particules chargées électriquement) est une autre caractéristique de l’atmosphère qui a retenu depuis longtemps l’attention des spécialistes en télécommunications, en raison de leur aptitude à propager certaines ondes électromagnétiques sur de longues distances. -
BARAN PAUL (1926-2011)
- Écrit par Encyclopædia Universalis
- 368 mots
Ingénieur électricien américain, Paul Baran a inventé le concept de réseau distribué et, parallèlement aux travaux de l'informaticien britannique Donald Davies, la transmission de données par paquets. Ces inventions ont fourni les bases d'Internet.
Paul Baran naît le 29 avril 1926...
- Afficher les 47 références
Voir aussi
- MICRO-ORDINATEUR
- TRANSMISSION, télécommunications
- RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE
- TÉLÉTRAVAIL
- MULTIMÉDIA
- FOURNISSEUR D'ACCÈS INTERNET
- COMMERCE ÉLECTRONIQUE
- GSM (Global System for Mobile Communications)
- INTERNET MOBILE
- RADIOTÉLÉPHONIE
- GPRS (General Packet Radio Service)
- ADSL (asymmetric digital subscriber line)
- PAYS EN DÉVELOPPEMENT (PED)
- WIFI (Wireless Fidelity)
- RÉSEAUX SANS FIL, télécommunications
- BLUETOOTH
- WIMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access)
- TÉLÉPHONE
- COMMUTATION, télécommunications
- ORDINATEUR PORTABLE
- MMS (Multimedia Messaging Service)
- TÉLÉPHONIE SUR IP
- NUMÉRIQUE TRANSMISSION
- MICROPROCESSEUR
- TERMINAL, informatique et télécommunications
- RÉSEAU, télécommunications
- PAQUETS TRANSFERT PAR, télécommunications
- DÉBIT, télécommunications
- TÉLÉPHONE MOBILE
- CODE-BARRES
- SMARTPHONE
- TABLETTE TACTILE ou TABLETTE NUMÉRIQUE