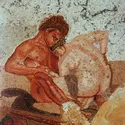TERAYAMA SHŪJI (1935-1983)
Article modifié le
Dans le Japon de l'après-guerre et jusqu'à sa mort, Terayama Shūji fut souvent celui par lequel le scandale arriva. Enfant terrible, il chercha sans cesse, face au réel, la la provocation poétique. Il passe d'ailleurs très tôt « de l'autre côté du miroir » : son père disparaît à la fin de la guerre, sa mère, serveuse dans une base américaine, l'abandonne ; recueilli par un parent, il vivra dès lors derrière un écran de cinéma et dans les coulisses d'un théâtre. Nourri de films américains, il écrit à Humphrey Bogart, une de ses stars préférées.
Mais sa première identité, il la trouve dans la composition de tanka, courts poèmes de cinq vers de 5, 7, 5, 7, 7 syllabes. Son intérêt pour l'œuvre du poète Ishikawa Tokuboku (1885-1912) qui renouvela, par l'emploi du langage parlé, cette forme traditionnelle, rend compte de l'importance fondamentale pour Terayama du jeu de la langue, expression de la « modernité ». En 1954, il reçoit le prix « Poésie nouvelle » au festival Tchekhov. Malade, il restera ensuite cloué au lit pendant près de quatre ans. Il assouvit alors une passion dévorante de la lecture, celle des auteurs étrangers, français en particulier : Sade, Lautréamont, Jules Verne, Artaud, Jarry... Son imagination et sa pensée s'en nourrissent si fort qu'on l'a quelquefois accusé de plagiat ! Il a pourtant toujours su les assimiler à son univers propre : ainsi de l'influence qu'exerça Fellini sur son œuvre de cinéaste.
Il appartient à des groupes étudiants de théâtre comme « Les Barbes de verre » (1955) et vit désormais à Tōkyō, où il écrit : Territoire oublié (1955), Mai, pour moi (1957), et une anthologie de la poésie intitulée : Livres au ciel (1958). En 1959, il commence à écrire avec succès pour la radio. Un de ses textes, Chattologie, deviendra son premier film, en 8 mm (1960). Il signe alors ses premiers scénarios pour la Shōchiku : Le Lac séché réalisé par Shinoda Masahiro, Adieu flingue ! ; une pièce, Le sang dort debout, ainsi qu'une réalisation pour la télévision.
En 1961, il s'attache à regrouper l'avant-garde. Lui-même passe à la réalisation de courts métrages expérimentaux comme La Cage (16 mm, 1962) et travaille beaucoup pour la télévision : Ippiki (Le Corps d'une bête) ou Pauvre papa, ce n'est pas le tueur qui l'a assassiné, c'est le chant de l'oiseau à une plume. En 1963, il affronte un problème de société : les fugues d'adolescents. En dehors de ses innombrables œuvres pour la radio — Parfois, tel un enfant sans mère (1964), ou La Femme du Dieu-Chien (1965) —, il écrit une pièce, Étude des vampires (1964), et publie un important recueil de poèmes autobiographiques, Cache-cache pastoral (1965), qu'il mettra en images en 1974. Son premier roman, Aa ! Koya (Devant mes yeux le désert), paraît en 1966. L'année suivante, il crée sa propre troupe de théâtre et une intense activité théâtrale commence pour lui. Il fonde donc Tenjosajiki (ou les « Places du plafond ») en référence au film Les Enfants du paradis. Pour Tenjosajiki, il monte Le Bossu du département d'Aomori, Le Crime du gros patapouf Ooyama, La Marie-Vison. Le recours au fantastique, à l'anormal, au monstrueux renvoie toujours chez Terayama, de la « fiction des planches » à celle, plus cruelle encore, de la « réalité ». Avec Jetons les livres et sortons dans la rue !, il renoue par le biais du théâtre avec l'obsession de la fugue. Il en fera un film en 1971. En 1968, au festival du théâtre d'avant-garde, il présente Les Mille et Une Nuits de Shinjuku, Barbe Bleue, Le Petit Prince, L'Enfant-Loup. Pour le cinéma, il écrit Premier Amour, version infernale que réalise Hani Susumu. Il publie beaucoup : La Guerre dans la rue, Album photo du théâtre japonais, L'oreille du roi est une oreille d'âne, La Petite Sirène, La La Nostalgie via les idées, I, II, etc. En 1969, ses heurts avec les partisans du théâtre-situation (Jōkyō gekijō) de Kara Jūro, son ancien complice, le conduit au poste de police. Mais, cette année-là est surtout celle de ses premières représentations en Europe (La Marie-Vison, Le Dieu-Chien), celle de l'ouverture d'un petit théâtre à Shibuya, un des quartiers chauds de la jeunesse et celle de la publication de sa revue théorique : Théâtre souterrain. En 1970, La Mama de New York joue La Marie-Vison. À propos de ses nouvelles pièces, il déclare : « Dans Notre Époque montée sur un éléphant de cirque, j'ai voulu détruire les frontières entre la scène et le public, théâtraliser la ville. » Dans cet esprit, il présente Jashūmon en 1971, au festival de Nancy. Il poursuit ses expérimentations avec Lettres d'un aveugle, qui se déroule dans l'obscurité complète : « un espace sans dieu(x), c'est le sentiment que je veux donner », commente-t-il. Le cinéma n'est pas de reste : après avoir réalisé deux de ses films les plus connus, L'Empereur Tomato-ketchup (1970) et La Guerre du ciseau, du papier et de la pierre (Jankenpon sensō, 1970), Terayama essaie de faire éclater, par la « performance », le dispositif cinématographique. Dans Rolla, un acteur crève — à la lettre — l'écran et dans Le Jugement, les spectateurs sont invités à y planter des clous. Après ces courts métrages tournés en 16 mm, il tente de restituer avec Cache-cache pastoral la personnalité d'un jeune homme divisé entre le rêve et la réalité. Dans rue, il fait encore scandale avec Toc, toc ! 1978 est pour lui une année de tournée internationale avec Instructions aux serviteurs ; il écrit aussi Third pour le jeune réalisateur Higashi Yoichi. En 1979 il redouble d'activité théâtrale : Reming, Chasse à l'enfant, Le Château de Barbe Bleue, Le Temps où j'étais un jeune loup, Introduction de la jeunesse au suicide, La Fin du voyage, Qui a découpé le petit chat ?... Avec le spectacle La Place du spectateur, il continue à s'interroger sur cet étrange phénomène qu'est le spectacle. En 1981, il monte Cent Ans de solitude mais devra renoncer à une adaptation cinématographique. Comme en témoignent ses déclarations et les titres mêmes de certaines œuvres — Le Labyrinthe d'herbe (1979), film-sketch ou Le Labyrinthe et la mer Morte (1976), essai, ou bien À propos du labyrinthe mystérieux (1976), court métrage — le labyrinthe, métaphore de l'inconscient, n'a cessé de hanter son œuvre foisonnante.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Josiane PINON : maîtrise de droit, université de Paris-I, licenciée de japonais, Institut national des langues et civilisations orientales
Classification
Autres références
-
ÉROTISME
- Écrit par Frédérique DEVAUX , René MILHAU , Jean-Jacques PAUVERT , Mario PRAZ et Jean SÉMOLUÉ
- 19 777 mots
- 6 médias
En cette époque de normalisation de l'image, le Japon se signale par quelques films audacieux.Shuji Terayama signe en 1970 un premier manifeste désabusé sur la prise de pouvoir. L'Empereur Tomato-Ketchupest est un enfant qui gouverne un royaume dont la constitution prévoit que « tous les enfants... -
JAPON (Arts et culture) - La littérature
- Écrit par Jean-Jacques ORIGAS , Cécile SAKAI et René SIEFFERT
- 22 460 mots
- 2 médias
...underground), se répandirent les décors saike (pour psychedelic). Jette les livres, sortons dans la rue (Showosuteyomachi ni deyō), lançait en 1971 Terayama Shūji (1934-1983). Il garda ce même titre pour un livre et pour un film, et sans cesse partagea son activité entre le cinéma, le théâtre et l'écriture,...
Voir aussi