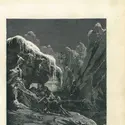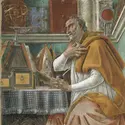TERTULLIEN (155 env.-env. 225)
Article modifié le
L'œuvre
Ouvrages apologétiques
En dépit de l'arbitraire inhérent à toute classification de l'œuvre de Tertullien, il est cependant commode de grouper ses traités selon les fonctions qu'il leur assignait ou selon le but principal qu'il leur fixait. À condition malgré tout de ne pas perdre de vue que la plupart d'entre eux sont circonstanciels et ambivalents : suscités ou provoqués par telle ou telle situation particulière, ils ont souvent pour fin de combattre l'adversaire (païen ou hérétique), tout en instruisant les chrétiens.
Tertullien commença sa carrière, en 197, par une sorte de triptyque destiné aux païens, d'où se détache son chef-d'œuvre littéraire, l'Apologétique(Apologeticum). Reprenant certains thèmes abordés précédemment (Aux païens [Ad nationes]), mais dans un esprit différent, en adoptant une perspective plus large, il montre l'absurdité des calomnies répandues par les païens sur les chrétiens ; reprenant l'offensive, il stigmatise leurs propres croyances, l'impiété même de leurs rites religieux, les contradictions des philosophes, et, corrélativement, il prouve le bien-fondé de la foi chrétienne ; il termine en demandant pour les chrétiens plus de justice au cours des procès qui leur sont intentés. Si dans l'Apologétique Tertullien recourt déjà à l'argument du « témoignage de l'âme », il lui consacre, sous ce titre (De testimonio animae), un traité spécial qui constitue le troisième volet de son triptyque apologétique. Empruntant à la philosophie l'une de ses preuves de l'existence de Dieu (par connaissance naturelle et « instinctive » du divin), l'apologiste a eu le mérite de la présenter comme une véritable expérience métaphysique que chacun peut faire pour son compte. Plus tard, en 212, Tertullien devait encore prendre la défense des chrétiens persécutés et revendiquer en particulier la liberté de culte, dans une lettre adressée à Scapula, proconsul d'Afrique (Ad Scapulam).
Traités concernant la « discipline »
Par « discipline » (disciplina fidei), Tertullien entend les règles qui doivent guider la vie morale du chrétien, mais aussi la doctrine sacramentaire et ecclésiologique, tandis que la « règle de foi » (regula fidei) récapitule l'essentiel de la Révélation. Les écrits sur la discipline tiennent une grande place dans l'ensemble de son œuvre, mais il convient de bien distinguer entre ceux qu'il composa étant encore catholique et ceux qu'il rédigea sous l'influence montaniste, voire après sa rupture avec l'Église.
Au premier groupe (197-206 env.) appartiennent : la consolation Aux martyrs (Ad martyras), qui invite les chrétiens déjà emprisonnés à supporter les épreuves qui les attendent : le traité Sur les spectacles (De spectaculis), dans lequel Tertullien dénonce le caractère idolâtrique et immoral des jeux du cirque, du stade, de l'amphithéâtre ; la méditation Sur la prière (De oratione), premier commentaire que nous possédions du Pater Noster ; le traité Sur le baptême(De baptismo), particulièrement important pour l'histoire de la liturgie sacramentaire, écrit pour réfuter les arguments d'une secte gnostique qui rejetait le baptême ; le traité Sur la patience (De patientia), dont la conception reste profondément marquée par la philosophie stoïcienne ; le traité Sur la pénitence(De paenitentia), où sont distinguées, d'une part, la pénitence prébaptismale, à laquelle tout catéchumène doit se soumettre pour se présenter au baptême, d'autre part, la « seconde pénitence » qui consiste en une « confession publique » des fautes graves et ne peut être accordée qu'une fois ; le « sermon » Sur la toilette des femmes (De cultu feminarum), qui invite les chrétiennes à se vêtir simplement, à renoncer aux fards et aux bijoux, car la coquetterie est une véritable injure faite au Créateur, puisqu'elle est refus du naturel voulu par lui ; enfin, la lettre À sa femme (Ad uxorem), portant sur la question si souvent débattue dans la primitive Église des secondes noces et des mariages « mixtes » (entre païens et chrétiens), celles-là comme ceux-ci paraissant à Tertullien peu compatibles avec la discipline chrétienne. Dans tous ces ouvrages, le rigorisme du théologien est déjà manifeste ; un tel état d'esprit toutefois n'est pas alors exceptionnel : la philosophie païenne et les religions orientales prêchaient volontiers l'ascétisme.
Mais à partir de 207 environ, sous l'influence montaniste, Tertullien professe une discipline plus rigoriste encore. Il revient tout d'abord sur le problème du mariage, dans l'Exhortation à la chasteté (De exhortatione castitatis), puis à nouveau dans La Monogamie (De monogamia), pour condamner, sans ambiguïté cette fois, les secondes noces et exalter les mérites de la virginité et de la continence ; de même, une question naguère abordée incidemment fait l'objet d'un ouvrage entier, Le Voile des vierges (De virginibus velandis), dans lequel Tertullien demande aux jeunes filles de porter le voile, hors de chez elles, comme les femmes mariées. Autre sujet qui le préoccupa beaucoup : l'attitude des chrétiens pendant les persécutions ; après avoir admis, d'après Matthieu x, 23, la possibilité de fuir devant elles, Tertullien revint sur cette tolérance, dans le Scorpiace, adressé aux gnostiques (comparés à des scorpions, d'où le titre du traité : « remède contre la piqûre du scorpion ») parce qu'ils ne jugeaient pas nécessaire l'épreuve du martyre, et surtout dans un ouvrage ouvertement montaniste, La Fuite en cas de persécutions (De fuga in persecutione, 213). Dans son traité Sur le jeûne (De jejunio), dirigé contre ceux que désormais il appelle les « psychiques », c'est-à-dire les catholiques, il justifie avec passion les observances ascétiques de la discipline montaniste ; enfin, examinant une nouvelle fois les questions pénitentielles (Sur la pudeur [De pudicitia], écrit sans doute en 217), Tertullien est le premier à opposer aux péchés « rémissibles » les péchés « irrémissibles » (idolâtrie, meurtre, fornication). Parallèlement, le Carthaginois définissait la place des chrétiens dans la cité, en leur interdisant tous les métiers qui de près ou de loin touchent à l'idolâtrie, ainsi que le service militaire (Sur l'idolâtrie [De idololatria], dont la date est discutée ; Sur la couronne [De Corona]).
Écrits de controverse doctrinale
Reste un troisième ensemble d'ouvrages portant essentiellement sur la « règle de foi » : Contre les juifs d'abord (Adversus Judaeos, env. 198), et surtout contre les gnostiques et les marcionites.
Au cours de ces polémiques antihérétiques, Tertullien fit l'expérience des longues discussions, souvent stériles, généralement sans vainqueur ni vaincu. Pour éviter précisément d'avoir à suivre l'adversaire dans le dédale des subtilités dialectiques, il recourut volontiers à un argument qui lui paraissait simple, direct, efficace : le célèbre argument de la « prescription », dont on a souvent prétendu (mais à tort) qu'il était emprunté à la procédure juridique. En réalité, il s'agit d'une démarche discursive, fondée en bien des cas sur un syllogisme implicite, en particulier sur l'idée que l'orthodoxie, antérieure à l'hérésie, possède le privilège d'être en possession de la vérité : un traité entier, Les « Prescriptions » contre toutes les hérésies (De praescriptionibus adversus haerese omnes, vers 200), est consacré à justifier ce type de raisonnement. Mais Tertullien ne pouvait s'en tenir là : s'il ne voulait pas donner l'impression de fuir l'affrontement, il lui fallait « descendre dans l'arène », combattre l'un après l'autre tous les arguments des hérétiques. Son traité Sur l'âme (nature, facultés, origine, immortalité de l'âme), écrit vers 210, est destiné à réfuter les doctrines philosophiques et celles des gnostiques qui souvent en dérivent. Mais la masse la plus imposante est celle de sa trilogie : Contre Marcion(Adversus Marcionem), La Chair du Christ et La Résurrection des morts. Les cinq livres du Contre Marcion, dont la rédaction s'est échelonnée sur une dizaine d'années (200-210 env.), sont consacrés à dénoncer le dualisme de l'hérétique et à prouver le bien-fondé de la « règle de foi » : le Dieu de l'Ancien Testament est identique à celui du Nouveau (liv. I) ; le Créateur n'est autre que le Dieu de bonté du Nouveau Testament (liv. II) ; le Christ incarné est le Sauveur annoncé par les prophètes et envoyé par le Créateur (liv. III) ; il n'y a pas de contradictions entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et les tentatives de Marcion pour rejeter l'Ancien, ne conserver que le seul Évangile de Luc et faire son choix parmi les Épîtres pauliniennes sont absolument injustifiées (liv. IV-V). La Chair du Christ et La Résurrection des morts sont deux traités étroitement liés : le premier réfute le docétisme, le second vise tous ceux qui nient la résurrection eschatologique. À côté de l'importance matérielle et surtout dogmatique de cette trilogie, la satire Contre les valentiniens (Adversus valentinianos, env. 210) apparaît beaucoup plus légère : las des longues polémiques, Tertullien tentait de désacraliser le mythe gnostique en le présentant comme une fable mythologique, et il remettait à plus tard une réfutation plus sérieuse et plus approfondie du valentinianisme. En marge de ces polémiques antignostiques et antimarcionites, le docteur s'en prit aussi au peintre carthaginois Hermogène, qui professait l'éternité de la matière (Contre Hermogène, env. 200-206), et en 213 à Praxéas, qui identifiait le Père avec le Fils : ce fut l'occasion pour Tertullien d'écrire son grand traité Contre Praxéas, premier ouvrage consacré à la théologie trinitaire et dont un grand nombre de formules furent reprises par le Concile de Nicée (325). Tertullien affirme la distinction réelle et numérique, dans l'unité, du Père, du Fils et de l'Esprit, définition qu'il n'a pas « inventée », mais dont l'expression et l'explication rationnelle n'avaient jamais été tentées de manière aussi précise avant lui.
L'opuscule « Sur le manteau »
Même sommaire, une revue des œuvres de Tertullien doit mentionner cet obscur « éloge » Du manteau (De pallio), dont ni la date ni l'interprétation ne sont sûres. Nettement en marge des autres traités de Tertullien par le sujet (l'auteur s'y justifie d'avoir abandonné la toge pour le manteau), cet opuscule cache vraisemblablement une intention sérieuse et n'est pas l'exercice de virtuosité rhétorique que l'on a prétendu.
Certains y ont vu la dernière œuvre conservée de Tertullien, écrite à une époque tardive (vers 222), alors que peut-être il avait abandonné la communauté montaniste pour fonder la secte « tertullianiste » ; replié sur lui-même, il chercherait à expliquer et à justifier sa propre évolution. Cette interprétation rend compte à la fois de la forme affectée, voire baroque, que revêt cet « éloge », et des thèmes qui y sont développés ; par là, elle cesse d'en faire un « accident » dans la carrière du Carthaginois.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean-Claude FREDOUILLE : professeur de langue et littérature latines à l'université Jean-Moulin, Lyon
Classification
Autres références
-
ÂGE DE LA TERRE
- Écrit par Pascal RICHET
- 5 145 mots
- 5 médias
liberté divine n’aurait pas été absolue, mais contrainte par la nature de cette matière informe par rapport à laquelle Dieu n’aurait joui d’aucune prééminence ontologique. Dans son Contre Hermogène, l’apologiste Tertullien (~155-~225) résuma l’ampleur du problème en imaginant une matière... -
ART & THÉOLOGIE
- Écrit par Georges DIDI-HUBERMAN
- 6 743 mots
- 1 média
...d'autant plus pervers qu'il se dirige vers une matière inerte, façonnée comme un leurre, un mensonge (Protreptique, iv, 57). Plus radicalement encore, Tertullien, à la fin du iie siècle, déclarera-t-il idolâtre tout plaisir de voir ou d'être vu – par exemple au théâtre – et ira jusqu'à faire de « toute... -
EXEMPLUM
- Écrit par Jean-Pierre BORDIER
- 809 mots
Outre le sens habituel d'« exemple », le mot latin exemplum désigne une ressource de la rhétorique utile à qui veut susciter la persuasion. Aristote rapproche l'exemple, qui repose sur une inférence implicite, (raisonnement inductif) du syllogisme incomplet (déductif)...
-
LATINES (LANGUE ET LITTÉRATURE) - La littérature chrétienne
- Écrit par Pierre HADOT
- 6 309 mots
- 2 médias
- Afficher les 7 références
Voir aussi