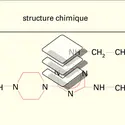THÉRAPEUTIQUE Vue d'ensemble
Prenant le relais des universités médiévales, le xixe siècle a établi les principes de base de l'activité médicale en développant une méthodologie cohérente dans l'analyse des situations pathologiques : c'est la méthode anatomo-clinique, qui est toujours en vigueur. Dans ce contexte, l'acte médical ne peut être exercé sans une longue préparation, à la fois théorique et pratique, qui met le futur médecin en contact avec ses confrères plus expérimentés et avec les patients. Il acquiert ainsi l'exigence des critères éthiques fondamentaux qui sont le principe même de la déontologie. On peut donc définir aujourd'hui l'acte médical comme l'ensemble des activités humaines, techniques et scientifiques exercées par une personne qui a satisfait aux conditions d'exercice de la médecine et ayant pour but la prévention, la guérison ou le soulagement des maladies et des infirmités qui atteignent les êtres humains.
L'auteur d'un tel acte doit s'intégrer à un cadre administratif très strict, et engager, moyennant une formation continue de longue haleine, sa responsabilité vis-à-vis du patient, conformément au célèbre adage : Primum non nocere (« avant tout, ne pas nuire »).
Sur le plan statutaire, il convient de distinguer l'aspect administratif et l'aspect légal.
En France, les conditions administratives pour autoriser l'exercice de la médecine sont au nombre de trois : posséder la nationalité française ; posséder un diplôme d'État de docteur en médecine ou une équivalence reconnue par les autorités compétentes ; être inscrit au tableau de l'Ordre des médecins français.
S'agissant du statut légal, l'acte médical tire sa spécificité de la nécessité thérapeutique : seuls sont autorisés à porter atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui les docteurs en médecine remplissant les conditions d'exercice et les professionnels de santé agissant sous la responsabilité d'un médecin.
L'examen clinique a pour but de rassembler toutes les informations nécessaires pour apprécier l'état de santé du patient ; interrogatoire et anamnèse, inspection, palpation, percussion, auscultation, qui amèneront éventuellement à requérir des examens complémentaires, radiologiques ou autres investigations d'imagerie, biologiques ou tests fonctionnels tels que Doppler, ou enregistrements électrophysiologiques.
Cette étape initiale doit être menée avec grand soin, en y mettant le temps nécessaire et en utilisant les méthodes adaptées et les concours appropriés (art. 33 du Code de déontologie).
Le diagnostic qui résulte de l'analyse approfondie des résultats de l'examen médical permettra d'informer le malade de sa situation clinique, des conséquences thérapeutiques et des évolutions possibles (pronostic).
Nécessairement, tout acte thérapeutique, pour avoir un sens, et une chance de succès, doit modifier l'état dans lequel se trouve le patient. Il implique ainsi de corriger certains paramètres biologiques au risque de déclencher des réactions indésirables.
L'art médical consiste à évaluer ce risque thérapeutique et à en assumer le contrôle responsable. Bien évidemment, il convient d'obtenir le consentement du malade (art. 35-36 du Code de déontologie français) chaque fois que les inconvénients du traitement sont de nature à modifier profondément le statut biologique dont il jouissait. Les modalités selon lesquelles cette information est communiquée ont autant d'importance pour le patient que pour celui qui propose, en conscience, les soins. En effet, la vocation du médecin lui commande de ne réserver l'abstention thérapeutique qu'aux cas désespérés, car son devoir est de donner à ses malades toutes leurs chances de guérison.
Il mettra, à cet effet en œuvre une impressionnante panoplie thérapeutique, qu'éclairent en premier lieu les articles réunis dans l'ensemble thérapeutique, mais aussi, à un autre niveau, de nombreux articles indépendant concernant soit des organes (foie, rein) ou des régions du corps humain (abdomen), soit des agents curatifs (antibiotiques), soit des états cliniques (A.V.C., épilepsies) soit enfin des syndromes pathologiques (anémies, diabète).
L'exécution d'un acte médical, quel qu'il soit, entraîne la responsabilité de celui qui l'accomplit. L'exercice de la médecine est personnel : chaque médecin est responsable de sa décision et de ses actes (art. 69).
Cette responsabilité est d'abord déontologique. Pour donner à l'acte médical toute sa valeur, la législation française lui confère une spécificité en rapport avec son but et son sujet, la personne humaine, en référence au Code de déontologie médicale déjà évoqué.
La responsabilité est également juridique, puisque le médecin est d'autre part responsable de ses actes en tant que citoyen. Il peut donc se trouver traduit devant un tribunal pour une qualification au pénal ou au civil, suivant qu'il est mis en accusation par le procureur ou qu'il fait l'objet d'une demande d'indemnité pour préjudice corporel.
Car la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. L'acte médical ne peut être considéré comme une denrée, une marchandise échangée pour une contrepartie financière. La médecine ne se vend pas, elle est un service. Le contrat de soins qui est à la base de la responsabilité n'est pas une convention commerciale ni un marché.
Si l'on réserve le cas des techniques chirurgicales, la thérapeutique apparaît comme la science établissant les règles d'application des médicaments, des régimes alimentaires et de divers agents physiques à la cure et à la prévention des maladies. Certaines de ses subdivisions, justifiées au début du siècle, n'ont plus de raison d'être aujourd'hui : ainsi la phytothérapie et l'opothérapie, car la plupart des plantes médicinales et des sécrétions glandulaires ont livré leur secret ; les formules chimiques de leurs principes actifs sont connues et la synthèse, au moins partielle, de beaucoup d'entre eux se pratique à l'échelle industrielle.
Il ressort que la thérapeutique médicamenteuse actuelle presque tout entière est une chimiothérapie. Les exemples abondent : on extrait du pavot et du Rauwolfia leurs alcaloïdes, de la digitale ses glucosides, de la pervenche la vinca-leucoblastine, des moisissures les antibiotiques ; il en est de même pour les hormones stéroïdes d'où dérivent les anabolisants protéiques et les contraceptifs, les hormones protéiques (qu'on sait rendre moins antigéniques en modifiant la séquence de leurs acides aminés constitutifs), les diverses vitamines, et enfin, extraites des sérums, les globulines ou mieux les immunoglobulines, qui ont perdu leur mystère tout comme les contacts synaptiques entre les neurones qui assurent la transmission des neuromédiateurs. Les médicaments chimiquement définis y ont gagné une composition scientifiquement établie, une activité plus constante, une posologie plus précise, une meilleure sécurité d'emploi, si bien que la prescription magistrale a pratiquement disparu pour faire place à celle des spécialités pharmaceutiques et souvent à celle de leurs génériques. Avec l'avènement de la physiologie cellulaire et de la biologie moléculaire, la thérapeutique s'est révélée plus dangereuse, soit par la toxicité propre des nouveaux médicaments, soit par leur action seconde, au point d'engendrer une pathologie nouvelle dite « iatrogène », c'est-à-dire d'origine thérapeutique.
Des associations médicamenteuses synergiques, antitoxiques ou correctrices sont en conséquence devenues nécessaires. Par exemple, l'administration simultanée de plusieurs antibiotiques pourra éviter la sélection de souches microbiennes résistantes en fonction de l'action spécifique qu'ils exercent sur les constituants de la cellule microbienne (les pénicillines sur la membrane, les sulfamides sur le métabolisme, les cyclines sur les ribosomes, l'acide nalidixique sur l'ADN bactérien).
Il convient néanmoins d'éviter les interactions délétères ou nocives qui pourraient se produire entre des médicaments incompatibles ou chez certains sujets sensibles (contre-indications).
La thérapeutique endocrinienne réalise soit l'apport d'une substance intégrée à l'organisme qui la produit et qui fait défaut (comme la thyroxine dans le myxœdème, ou l'insuline dans le diabète insulinoprive), soit l'inhibition d'une sécrétion hormonale excessive, dans l'hyperthyroïdisme par exemple, grâce aux antithyroïdiens de synthèse, paradoxalement associés à la prise de tyroxine pour freiner l'antéhypophyse par rétroaction. Parfois elle se propose la destruction ménagée, totale ou partielle, grâce à des corps radioactifs (iode 131 ou yttrium 90), d'une glande devenue tumorale ou en hyperfonction. Ailleurs (syndrome de Cushing), on réalisera le blocage de la sécrétion corticosurrénale par un anticorticoïde de synthèse, l'orthoparadiphényldichloréthane. Cet isomère d'un insecticide proche du D.D.T. réalise une véritable surrénalectomie chimique.
Des biothérapies beaucoup plus sophistiquées sont devenues courantes. Elles utilisent comme on le verra plus loin (cf. Immunorégulation) certains constituants normaux du corps de l'homme tels que les agents de son système immunitaire.
La diététique connaît un renouveau d'intérêt. Car c'est la science de la nutrition. Elle constitue la meilleure prévention des maladies dégénératives par excès, déficit ou déséquilibre nutritionnel. Les divers troubles de l'assimilation digestive exigent des régimes étudiés en fonction du chimisme gastro-intestinal et l'apport d'aliments appauvris ou enrichis industriellement. Cependant, si un déficit enzymatique par erreur innée du métabolisme est en cause, il n'est d'autre possibilité que de supprimer l'aliment nocif, par exemple le fructose ou le saccharose dans l'intolérance correspondante, la phénylalanine (qu'apportent le lait naturel et la viande) dans la phénylcétonurie. Dans ce cadre de thérapeutique utilisant les moyens naturels et pour traiter des pathologies à lente évolution, les cures thermales offrent depuis toujours des solutions efficaces, qui ont encore de nombreux adeptes (cf. thermalisme).
Autrement, la mise en pratique de l'arsenal thérapeutique qui inclut encore la physiothérapie et la radiothérapie (cf. ces articles) est devenue fort complexe. Il faudra, si nécessaire recourir aux injections sous-cutanées avec ou sans l'aide d'un agent diffusant comme l'hyaluronidase, ou à la voie veineuse (perfusion continue grâce à un cathéter laissé en place). Cette dernière voie rend possible l'alimentation parentérale en chirurgie. Dans les mains d'un personnel expérimenté, des contrôles répétés sont indispensables : hémogrammes, bilans des électrolytes sanguins et urinaires, mesure des facteurs de coagulation, antibiogrammes, etc.
Le coût des traitements devient considérable, surtout dans les unités de soins intensifs ou de réanimation, qui utilisent par surcroît des techniques instrumentales puissantes : assistance respiratoire en pneumologie, défibrillateurs, stimulateurs cardiaques, monitoring en cardiologie, épuration rénale en néphrologie grâce à l'hémodialyse (rein artificiel), perfusion de foie sain ou circulation croisée dans les grandes insuffisances hépatiques. Le traitement des malades graves qui échappe au praticien isolé, et devenu un travail d'équipe qu'illustre bien le cas des thérapies substitutives et régénératives. L'incidence de tels progrès sur la structure médicale et sur l'économie est évidente (cf. médecine - Le système de santé français).
C'est pourquoi la thérapeutique ne peut oublier la prévention (cf. médecine - Médecine préventive). Une simple hygiène individuelle (respect du rythme naturel de la veille et du sommeil, activité physique régulière, régime équilibré sans excès calorique) inculquée dès l'adolescence, ce qui implique un entraînement psycho-affectif, est encore la meilleure façon de prévenir le diabète, l'obésité, l'athérome, la sénescence précoce. La vaccination est la méthode préventive idéale, vis-à-vis des germes infectieux, que les vaccins soient antitoxiques (contre la diphtérie et le tétanos), microbiens (contre la tuberculose et la typhoïde) ou viraux (contre la variole, la rage, la fièvre jaune, la poliomyélite, la grippe) (cf. santé - Santé dans le monde).
La thérapeutique est une discipline scientifique difficile, mais sa pratique est soumise à des considérations extra-scientifiques, non seulement celles qu'inspire, dans une perspective « d'économie médicale », le coût des actes curateurs, mais surtout son adaptation (cf. santé - Économie de la santé), dans une tradition humaniste, à la personnalité propre de chaque patient. Par là, elle demeure l'art de guérir.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Bernard GLORION : président d'honneur de l'Ordre national des médecins, membre de l'Académie nationale de médecine
Classification
Autres références
-
RESPIRATOIRE (APPAREIL) - Catégories de médicaments
- Écrit par Encyclopædia Universalis et Henri SCHMITT
- 1 465 mots
- 1 média
Les poumons, comme tout organe du corps, peuvent subir des atteintes pathologiques : infections par des virus (grippe ou Covid-19, par exemple), des microbes (comme les pneumocoques), des champignons (comme les Aspergillus ou des Pneumocystis), divers types de cancer, et, enfin, des atteintes d’origine...
-
ACNÉ
- Écrit par Corinne TUTIN
- 3 313 mots
- 4 médias
Dans les formes très légères ou légères d’acné, letraitement est d’abord local sous forme de gel, crème ou lotion. Il repose sur l’usage de peroxyde de benzoyle (un agent oxydant antibactérien, également kératinolytique et antiséborrhéique) ainsi que sur les rétinoïdes topiques (dérivés du... -
ACUPUNCTURE
- Écrit par François BOUREAU
- 3 001 mots
- 1 média
...de façon à reproduire les effets de l'excitation manuelle. Ils se caractérisent par une fréquence basse (de 2 à 4 cycles par seconde) et par une intensité souvent élevée. Initialement utilisée lors d'interventions chirurgicales, son application s'est étendue au traitement symptomatique de la douleur. -
ACUPUNCTURE AURICULAIRE ou AURICULOTHÉRAPIE
- Écrit par Michel MARIGNAN
- 999 mots
L' acupuncture auriculaire, ou auriculothérapie, est une méthode thérapeutique du domaine des réflexothérapies pour laquelle le pavillon de l'oreille est utilisé à des fins thérapeutiques mais aussi diagnostiques. Technique médicale en première apparence semblable à l'acupuncture chinoise –...
- Afficher les 196 références