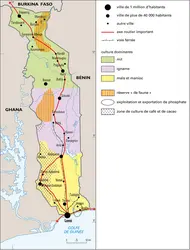TOGO
| Nom officiel | République togolaise |
| Chef de l'État et du gouvernement | Faure Gnassingbé - depuis le 4 mai 2005 |
| Capitale | Lomé |
| Langue officielle | Français |
| Population |
9 304 337 habitants
(2023) |
| Superficie |
56 790 km²
|
Article modifié le
Histoire
Les frontières du Togo ont subi de nombreuses variations qui font que son histoire est inséparable de celle des pays de la « côte des Esclaves » : Gold Coast (actuel Ghana), Dahomey (actuel Bénin), Nigeria occidental.
La période coloniale
Si l'on fait abstraction de l'évangélisation portugaise commencée dès le xvie siècle et de l'arrivée des missionnaires protestants au début du xviiie siècle, l'installation européenne au Togo est tardive ; elle date de la seconde moitié du xixe siècle, dans une région, celle de la côte et des abords immédiats, ravagée par la traite des esclaves et les raids de puissants voisins, le royaume d'Ashanti et le royaume d'Abomey.
Alors que le rôle économique de l'Afrique commence à apparaître, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne entrent en compétition dans cette zone ; par la convention de Berlin du 24 décembre 1885, le Schutzgebiet Togo (territoire protégé) allemand est reconnu par la France qui cède ses droits sur Petit Popo (Aného) et Porto-Seguro où s'étaient installées en 1864 et 1868 les maisons de commerce marseillaises ; en échange, la France reçoit des droits allemands sur la future Guinée française. Côté britannique est opérée la délimitation entre la Côte-de-l'Or et le Togo, la frontière passant à 2 kilomètres à l'ouest de Lomé, en plein pays éwé. La conquête allemande vers le nord se poursuit jusqu'en 1891. Le Togo allemand, qui s'étend sur 85 000 kilomètres carrés, est marqué par une active mise en valeur du sous-sol et des richesses agricoles ainsi que par un développement des moyens de communication (création de routes et de voies ferrées, construction du wharf d'embarquement de Lomé) ; il devient la Musterkolonie (colonie modèle) de l'Empire allemand. La période de la colonisation de l'Allemagne prend fin en août 1914 à la suite d'une brève guerre conduite par un corps expéditionnaire franco-anglais. La reddition de l'Allemagne amorce une série de partages du territoire dont les enjeux sont principalement les hautes terres occidentales riches productrices de cacao (partage du 27 août 1914, accord de Londres du 10 juillet 1919).
Au lendemain de la division du pays, les deux parties du Togo sont placées sous le régime du mandat de la S.D.N. Alors que la France conserve ses pouvoirs au Togo, le Togo britannique est gouverné d'Accra et administré conjointement avec la Gold Coast à laquelle il sera rattaché. Entre les deux guerres, les revendications allemandes sur le Togo ont pour conséquence que la France s'intéresse plus à ce pays qu'à ses autres territoires d'Afrique noire ; la mise en valeur économique et l'appel aux élites locales, chrétiennes et scolarisées, y sont plus poussés, cependant que l'administration française entretient le particularisme togolais à l'égard du Dahomey.
Les droits de la France seront reconduits mais aussi restreints par l'O.N.U. qui, plaçant le Togo sous « tutelle », confie à la puissance coloniale une mission d'administration et de développement politique du territoire appelé à l'indépendance.
Le contexte togolais à la veille de l'indépendance
La société togolaise est constituée de populations arrivées dans la région à différentes époques et qui présentent de fortes disparités sociales, économiques, religieuses et linguistiques. Ainsi qu'on le relève dans d'autres régions d'Afrique de l'Ouest ayant une façade maritime, les peuples éloignés de la côte sont entrés en relation avec les Européens plus tardivement. S'ils n'ont que peu participé au développement de la traite atlantique, ils ont souffert des guerres menées aux fins du commerce négrier alimenté par des intermédiaires africains proches du littoral. L'essentiel des raids, conduits par les puissants royaumes Ashanti et d'Abomey, de part et d'autre de l'actuel Togo, n'ont cependant pas épargné les populations du Sud.
Certains peuples du Nord se rattachaient à des entités politiques bien structurées de l'actuel Burkina Faso, où l'islam constituait çà et là une force de résistance. Ces sociétés, ainsi que les sociétés animistes et acéphales de peuplement ancien, comme les Kabyè, sont restées plus à l'écart des transformations imposées par les administrations coloniales successives, que la zone urbanisée, scolarisée et christianisée du Sud. Celle-ci a été le terreau des travailleurs et auxiliaires coloniaux prêts à former l'élite politique du pays indépendant, mais qui ont été parfois perçus comme les complices des exactions du pouvoir colonial. En outre, les clivages se sont redessinés selon des intérêts locaux à opter pour telle ou telle domination. L'élite africaine de la colonisation allemande s'est trouvée frustrée de ses intérêts par les Français ou les Britanniques, quand d'autres admettaient mieux le nouveau colonisateur. Ces faits ont marqué les relations entre les habitants de sourdes rancœurs et handicapé la construction d'un état d'esprit national. Le Togo n'en est pas moins devenu une nation au xxe siècle, ce qui n'exclut pas la permanence de solidarités entre des fractions de peuples séparés par les frontières héritées de la colonisation. En particulier, les Éwé, ethnie majoritaire du Sud, tôt consciente de son identité grâce à un contact ancien avec les missionnaires protestants, se sont trouvés coupés des leurs par la frontière établie entre la Gold Coast anglaise (futur Ghana) et le Togo allemand lors de la convention de Berlin. De plus, une seconde portion du territoire éwé fut occupée par les Britanniques en 1914 après l'éviction des Allemands, l'autre étant investie par les Français. Ce partage a été confirmé par deux mandats de la Société des Nations attribués en 1919 aux vainqueurs de la guerre. Par la suite, le souvenir de la colonisation allemande, pourtant brutale, s'est confondu dans la mémoire de certains avec la nostalgie d'une identité globale perdue. Toutefois, ce statut de territoire sous mandat international a conféré au Togo une situation politique originale, économiquement privilégiée, face à l'Afrique occidentale française (A.O.F.). C'est pourquoi, dès avant l'accession du pays à l'indépendance, le débat politique est marqué par les positions sur le devenir des Éwé, la réunification du pays, le cadre à donner tant à l'État qu'aux relations avec les pays de l'A.O.F., les colonies britanniques et les métropoles coloniales.
Naissance de l'État togolais
Le Togo français de 1914 constitue le Togo actuel. Après la Seconde Guerre mondiale, les droits des Français sont reconduits, mais restreints par l'O.N.U. qui place sous tutelle la colonie appelée à l'indépendance. La métropole n'y ayant plus qu'une mission d'administration, les associations et les partis politiques sont autorisés. Ils contribuent activement à l'émancipation du pays.
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Éwé ont multiplié les manifestations et appels aux Nations unies en faveur de la réunification sous la tutelle anglaise des Éwé de la Gold Coast, du Togo britannique et du Togo français.
Les courants politiques togolais s'affrontent sur cette question : le Comité de l'unité togolaise (C.U.T., qui deviendra le Mouvement populaire togolais) dirigé par Sylvanus Olympio est partisan d'un État réunifié et autonome immédiatement. Le Parti togolais du progrès de Nicolas Grunitzky prône l'abolition de la tutelle et une association plus étroite avec la France. Des associations régionales voient le jour, comme l'Union des chefs et peuples du Nord (U.C.P.N.), fédérant les groupes politiques favorables à l'indépendance mais hostiles à la réunification qui aurait eu pour conséquence de faire passer les peuples du Nord sous une hégémonie éwé.
Des référendums, organisés en 1956 au Togo britannique et en 1957 au Togo français, tranchent la question : le camp du statu quo territorial l'emporte, grâce notamment aux voix du Nord.
Aussi, en 1956, dans la perspective de l'intégration du Togo britannique au nouvel État indépendant du Ghana, la France concède une autonomie interne au Togo français, premier pays à se voir appliquer la loi-cadre du 23 juin 1956. La République autonome du Togo est proclamée, avec Nicolas Grunitzky comme Premier ministre, mais les premières élections placées sous le contrôle de l'O.N.U., le 27 avril 1958, portent Sylvanus Olympio à la présidence de la nouvelle république : cette fois, l'U.C.P.N. s'était ralliée au C.U.T. pour favoriser le processus d'émancipation. Le 27 avril 1960, le Togo accède à l'indépendance.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean DU BOIS DE GAUDUSSON : vice-président de l'université de Bordeaux-I, doyen de la faculté de droit
- Philippe GERVAIS-LAMBONY : professeur à l'université de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense
- Agnès LAINÉ : docteur en histoire de l'université de Paris-I, chercheuse associée au Centre d'études des mondes africains, unité C.N.R.S. 8171
- Francis SIMONIS : maître de conférences d'histoire de l'Afrique, habilité à diriger des recherches, université d'Aix-Marseille
- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis
Classification
Médias
Autres références
-
TOGO, chronologie contemporaine
- Écrit par Universalis
-
AFRIQUE (Histoire) - Les décolonisations
- Écrit par Marc MICHEL
- 12 429 mots
- 24 médias
L'évolution commença par leTogo et le Cameroun, avec des spécificités dues au statut particulier de ces deux territoires soumis au contrôle de l'O.N.U. En 1956, le plébiscite en faveur de l'intégration de la partie occidentale du Togo à la Gold Coast et la mise en place d'un gouvernement autonome... -
ÉWÉ ou ÉVHÉ
- Écrit par Jacques MAQUET
- 892 mots
Les Éwé (ou Evhé, selon certains historiens comme R. Cornevin) occupent en Afrique occidentale le littoral du golfe de Guinée, de l'embouchure de la Volta, à l'ouest, à celle du Mono, à l'est, et l'arrière-pays sur une profondeur d'environ 150 km. La frontière entre le ...
-
EYADÉMA GNASSINGBÉ (1935-2005)
- Écrit par Comi M. TOULABOR
- 790 mots
Le général Gnassingbé Eyadéma a exercé sur le Togo une dictature implacable pendant trente-huit ans. Les failles sont nombreuses dans son curriculum vitae.
Sa date de naissance officielle, fixée au 26 décembre 1935, relève d'une imagination fertile. Il serait plus exact de dire qu'Étienne Eyadéma...
-
GHANA
- Écrit par Monique BERTRAND et Anne HUGON
- 7 217 mots
- 6 médias
La marche à l'indépendance est entravée un temps par deux obstacles. D'une part, la question du devenir duTogo sous mandat britannique, dont la population éwé semble souhaiter une réunification avec la partie française : mais, en 1956, l'O.N.U. se déclare favorable à un plébiscite, dont le résultat...
Voir aussi
- GOLD COAST ou CÔTE-DE-L'OR
- COMMUNICATION VOIES DE
- ALLEMANDS TERRITOIRES COLONIAUX
- PHOSPHATES
- DÉMOCRATISATION
- GNASSINGBÉ FAURE (1966- )
- GRUNITZKY NICOLAS (1913-1969)
- SOUS-DÉVELOPPEMENT
- POLITIQUE ÉCONOMIQUE
- PARTI UNIQUE
- KABYÈ
- FRAUDES
- RÉPRESSION
- TUTELLE, droit international
- BRITANNIQUE EMPIRE, Afrique
- AFRIQUE, géographie
- AFRIQUE NOIRE, histoire, période coloniale
- AFRIQUE NOIRE, histoire, des indépendances à nos jours
- AFRIQUE NOIRE, histoire précoloniale
- ÉMEUTE
- AFRIQUE NOIRE, ethnologie