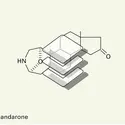TOXICOLOGIE
Article modifié le
Toxicologie et thérapeutique
Les rapports de la toxicologie avec la thérapeutique sont étroits, car la distinction entre poison et médicament est en réalité subtile. Il faut bien savoir que, si, à doses convenables, les médicaments peuvent exercer des effets salutaires, ils peuvent, au contraire, provoquer des actions nocives lorsque les doses administrées sont trop fortes, la marge entre les doses thérapeutiques et les doses toxiques étant parfois d'autant plus faible que, en dehors du médicament, de ses modalités d'administration et de son association éventuelle avec d'autres produits, interviennent des facteurs nombreux et complexes, tenant, entre autres, au terrain physique et psychique du patient, à ses conditions de vie et même à la nature et à l'évolution de sa maladie. Cette notion classique des rapports étroits entre l'action médicamenteuse et l'action toxique, si bien soulignée, après Paracelse, par Claude Bernard dans ses leçons au Collège de France, est connue depuis des temps très anciens ; ainsi, les Grecs désignaient par le même terme, pharmacon, le poison et le médicament. Son importance s'est accrue avec la découverte des multiples effets secondaires indésirables que peuvent exercer les substances médicamenteuses à côté de leurs effets bénéfiques. Il en est résulté l'existence d'une pathologie thérapeutique s'extériorisant par de véritables maladies médicamenteuses. Il suffit de rappeler à cet égard les effets tératogènes exercés par certains produits médicamenteux, dont la thalidomide constitue un exemple spectaculaire. La consommation par la femme enceinte d'un tel médicament, par ailleurs dépourvu de nocivité aux doses d'emploi préconisées comme hypnotique et tranquillisant, mais dont la consommation à une certaine période de la gravidité (celle de la formation des ébauches embryonnaires : du 23e au 40e jour) provoque des anomalies très graves chez le fœtus, se traduit par la naissance de véritables monstres.
Ces remarques expliquent la fréquence relative des accidents causés par les substances médicamenteuses et même, parfois de façon dramatique, en raison du jeu capricieux et imprévisible des intolérances innées ou acquises, par certaines substances que des esprits non avertis tendraient à considérer comme absolument anodines. L'extraordinaire accroissement du nombre des corps synthétiques mis par l'industrie chimique à la disposition des thérapeutes, dans les buts les plus divers, n'a fait que multiplier ces risques que vient encore aggraver l'extrême diversité des agressions exogènes concourant à l'installation de réactions d'allergie.
Il resterait beaucoup à dire sur la toxicologie des produits médicamenteux, et en particulier à envisager l'étude des substances génératrices de toxicomanies qui conduisent à la déchéance physique et morale de l'individu. C'est tout le problème du fléau social que constitue la drogue.
Il est bien évident que l'étude des moyens thérapeutiques de lutte contre l'action nocive des poisons est capitale en toxicologie. Y contribuent puissamment, dans le cas de l'homme, les spécialistes de la toxicologie clinique, notamment au niveau des centres antipoisons. Mais les spécialistes de la toxicologie expérimentale peuvent souvent, par leurs investigations, apporter des bases fondamentales pour la découverte d'antidotes. Il en a été ainsi, parmi beaucoup d'autres exemples, dans le cas du dimercapto-2, 3 propanol (ou BAL), très actif vis-à-vis des intoxications par des éléments thioloprives comme l'arsenic ou le mercure, ainsi que dans celui des réactivateurs des cholinestérases de la série de la pralidoxime, efficaces contre la plupart des insecticides organophosphorés anticholinestérasiques.
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- René TRUHAUT : membre de l'Académie des sciences, membre de l'Académie nationale de médecine.
Classification
Autres références
-
AGNOTOLOGIE
- Écrit par Mathias GIREL
- 4 993 mots
- 2 médias
...part, propose de repérer les études utilisées pour montrer précisément ce qu’elles n’ont pas pour fonction de montrer, par exemple, dans sa lecture, des études toxicologiques pour établir un effet cancérogène. La discussion, qui reste ouverte, est assurément un des fronts les plus vivants de la question.... -
ALCALOÏDES
- Écrit par Jacques E. POISSON
- 5 689 mots
- 5 médias
La forte activité biologique des alcaloïdes en fait parfois des toxiques puissants qui ont été impliqués dans des accidents et des affaires criminelles. On les retrouve comme principes actifs de préparations utilisées dans des cérémonies rituelles ou comme poisons d'épreuve dans des ordalies (mescaline... -
ALCOOLISME FŒTAL
- Écrit par Chantal GUÉNIOT
- 899 mots
Depuis 2007, toutes les bouteilles d'alcool en France comportent un pictogramme pour mettre en garde les femmes enceintes sur les risques de la consommation d'alcool pour le fœtus. Bien qu'à peine visible, ce dessin a constitué une petite révolution dans notre pays viticole, en symbolisant le...
-
ALIMENTATION (Aliments) - Risques alimentaires
- Écrit par Jean-Pierre RUASSE
- 4 759 mots
- 1 média
Les contaminations des aliments par des substances chimiques peuvent être classées selon leur origine accidentelle ou volontaire, ainsi que selon la concentration faible ou élevée des agents contaminateurs. - Afficher les 83 références
Voir aussi
- TOXICITÉ
- RADIOÉLÉMENTS ou RADIONUCLÉIDES ou ISOTOPES RADIOACTIFS
- HERBICIDES ou DÉSHERBANTS
- INSECTICIDES
- POISON
- FLUOROSE
- DDT (dichloro-diphényl trichloréthane)
- DIMERCAPTOPROPANOL ou BAL (british anti-lewisite)
- HEXACHLOROCYCLOHEXANE
- LÉTALE DOSE
- DOSE, toxicologie
- ACONITASE
- THALIDOMIDE
- ALIMENTS
- NITROSAMINES
- ADDITIFS ALIMENTAIRES