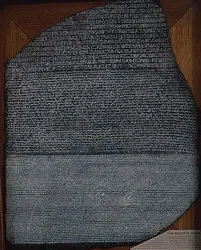TRADUCTION
Article modifié le
Le XXe siècle
Au xxe siècle, la situation devient plus complexe. Deux facteurs ont une incidence sur la traduction : sur le plan scientifique, l'avènement de la linguistique ; sur le plan technique, l'introduction de l'informatique.
La linguistique est tantôt accueillie par les traducteurs comme un outil de précision dans leur pratique, tantôt, au contraire, rejetée. Sur le plan théorique, l'influence de la linguistique est, en revanche, radicale. Elle apparaît tout d'abord dans le cadre théorique du structuralisme, d'une part en Europe de l'Est avec le cercle de Prague, d'autre part aux États-Unis sous l'impulsion d'Eugene Nida, président de l'Association de la traduction de la Bible. Les publications de Nida, Structure of Langage and Theory of Translation, et plus particulièrement Towards a Science of Translating, ont marqué une attitude nouvelle à l'égard de la traduction jusque-là considérée comme un art. Par la suite, l'influence de la linguistique s'est fait sentir en Europe avec une diversification des cadres théoriques. Les théoriciens de la traduction sont nombreux, actuellement, à souligner la nécessité de lier la théorie de la traduction à une théorie du langage : c'est le cas de George Steiner dans After Babel, d' Henri Meschonnic dans Pour la poétique II, de Louis Kelly dans The True Interpreter, de Peter Newmark dans Aspects of Translation et d'Antoine Berman dans L'Épreuve de l'étranger et Pour une critique des traductions : John Donne. Deux aspects du langage sont souvent soulignés, la dimension culturelle et la dimension discursive.
La traduction automatique a fait l'objet de nombreuses recherches sur le plan international. Des centres de recherche ont été créés en Europe, dans le cadre du programme Eurotra lancé par la Communauté européenne. L'objectif de ce programme était de traduire un même texte directement dans plusieurs langues. Les résultats obtenus ont réorienté cette perspective. Plutôt que de traduction automatique, on parle à présent de « traduction assistée par ordinateur ».
Sur le plan culturel, la création de nombreux centres, associations et publications dans le domaine de la traduction, sur les plans économique et social, l'avènement de la Communauté européenne ont donné un nouvel essor à la traduction. En 1953 a été créée la Fédération internationale des traducteurs. En France, on voit naître en 1947 la Société française des traducteurs et, en 1973, l'Association des traducteurs littéraires. La création de centres de traduction – pour la traduction littéraire à Strahlen en Allemagne et à Arles en France, pour la traduction technique, le centre Amyot à Paris – indique un nouveau tournant. La traduction acquiert à présent un statut institutionnel.
Parallèlement à l'évolution dans le domaine pratique de la traduction, les courants théoriques se multiplient et se diversifient. Mais, en dépit des spécificités, on distingue essentiellement deux démarches : le modèle idéal fondé sur la critique des traductions et sur un jugement qualitatif, et le modèle scientifique fondé sur la systématisation des phénomènes observables.
Les tenants de l'optique « évaluative » s'associent aux critères de Walter Benjamin exposés dans La Tâche du traducteur, texte qui a largement influencé tout un courant de réflexion sur la traduction. Benjamin cherche au-delà des langues naturelles un langage qui serait « pure essence ». Il conçoit la traduction comme une mutation qui modifie l'œuvre originale et transforme la langue maternelle grâce à la langue étrangère. Il s'associe en cela à l'optique du romantisme allemand. Henri Meschonnic se réclame de Benjamin dans son rejet de l'« annexion traductrice ». En revanche, il s'inscrit contre le littéralisme formel d'André Chouraqui, qui constitue pour lui une violation de la langue (De Jonas à Jona). Meschonnic insiste sur la nécessité d'une théorie qui s'appuie sur la pratique et qui tienne compte de la dimension globale du discours. Il attache une importance toute particulière au rythme et à l'« oralité » dans le texte écrit (Pour la poétique II).
Antoine Berman se situe également dans la lignée de Benjamin, et il consacre son premier ouvrage, L'Épreuve de l'étranger, à la traduction dans l'Allemagne romantique dans ses rapports avec la culture. Il s'inscrit contre « la négation systématique de l'étrangeté de l'œuvre étrangère » et affirme la nécessité de dégager une éthique de la traduction. La notion d'éthique est reprise dans son deuxième ouvrage (Pour une critique des traductions : John Donne) dans le cadre d'une réflexion sur la possibilité d'évaluer les traductions selon des critères consensuels ; deux critères sont avancés pour fonder un jugement qui dépasserait la dimension subjective. Ces critères sont d'ordre éthique et poétique. Berman centre son analyse sur la critique des traductions, et plus particulièrement celles de John Donne. Il présente également les deux démarches théoriques évoquées plus haut en discutant leurs mérites respectifs.
George Steiner (After Babel) envisage la traduction dans une perspective très large qui inclut la traduction à l'intérieur d'une même langue, conception que récuse Meschonnic. En revanche, il s'inscrit, comme Meschonnic, contre une linguistique abstraite et souligne ce qui est spécifique dans les langues et les cultures. Sur le plan idéologique, il s'élève contre les orientations extrêmes vers le pôle texte origine ou le pôle texte traduit, et conclut qu'il ne peut s'agir en tout état de cause que d'un équilibre en plus ou en moins.
Lorsque Jean Laplanche et son équipe entreprennent de traduire l'œuvre de Freud en français, ils adoptent une position qui, contrairement à celles des autres théoriciens, se définit antérieurement à l'œuvre traduite. Au nom de la cohérence, ils décident de rendre toutes les occurrences d'un même mot chez l'auteur par un même mot en français. Lorsque le volume XIII, le premier à être publié dans la collection, est sorti en 1988, il a donné lieu à un débat parmi les traducteurs, qui faisait suite aux divergences antérieures à ce sujet entre psychanalystes et grammairiens. Les psychanalystes, avec l'appui de Freud, entendaient germaniser le français, les grammairiens, en revanche, s'orientaient vers la francisation de l'allemand. Ces divergences nous ramènent une fois de plus vers le débat langue source/langue cible.
La deuxième démarche que nous avons évoquée n'est plus fondée sur la critique des traductions mais sur l'observation neutre des textes traduits. Elle suppose en cela un rapport entre pratique et théorie, qui n'est plus du même ordre. L'existence de ces deux courants révèle un fait rarement souligné concernant le concept même de théorie. Alors que, dans d'autres domaines, on fonde ses hypothèses sur des faits vérifiables et prédictibles, en matière de traduction, il s'agit, dans la grande majorité des cas, d'une théorie qui est centrée sur un modèle idéal, une visée à atteindre. La question qui est presque systématiquement posée est « comment faut-il traduire ? » et non « comment traduit-on ? ». La première position qui se reflète dans la terminologie utilisée : « la tâche du traducteur » (W. Benjamin), « la visée du traducteur » (A. Berman), se donne pour objectif de définir les critères d'une traduction de qualité ; la deuxième s'appuie sur des ensembles de textes traduits et cherche à définir les constantes dans la pratique des traducteurs. Il s'agit d'une démarche déductive et non prescriptive. Elle apparaît essentiellement dans trois domaines : la sociologie, l'histoire des traductions et la linguistique. Mais avec des différences cependant. Si la théorie découle de la description dans les trois cas, l'approche sociologique de Gideon Toury et de l'école de Tel-Aviv ainsi que l'approche historique de José Lambert mettent l'accent sur la description ; ils envisagent uniquement le texte traduit et se situent en dehors d'une théorie du langage. L'approche linguistique (Jacqueline Guillemin-Flescher) se situe nécessairement dans une théorie du langage et s'appuie non seulement sur les textes traduits, mais sur les textes originaux. Elle fonde sa théorie sur la description, mais elle vise essentiellement la théorie qui en découle.
Une telle optique ne peut pas prendre en compte tous les phénomènes qui entrent en jeu dans la pratique de la traduction. Au-delà d'un certain seuil, les textes et les catégories de textes se différencient. Mais tout ce qui est singulier, que ce soit la créativité d'un auteur ou les choix subjectifs d'un traducteur, échappe nécessairement à la généralisation. Ce qui est singulier est par définition non prédictible. Il n'en reste pas moins que de nombreuses transformations apparaissent de façon récurrente d'un traducteur à l'autre et témoignent de schémas discursifs intériorisés qui diffèrent selon les langues ou les groupes de langues. Devant plusieurs choix théoriquement possibles, on s'aperçoit que, dans de nombreux cas, les traducteurs vont systématiquement privilégier une même solution. Ces choix correspondent à la spécificité culturelle des représentations linguistiques. Ces constantes conditionnent l'activité de traduction à un degré qu'on ne peut soupçonner. Cela implique qu'on ne peut envisager le style d'un auteur en soi comme un phénomène absolu. La créativité, aussi marquée soit-elle, s'inscrit dans la langue, et celle-ci comporte plusieurs niveaux : un premier niveau de contraintes morphologiques et syntaxiques incontournables, un deuxième niveau de « normes » collectives qui constituent des contraintes relatives et, enfin, les choix particuliers des auteurs et traducteurs. Ces différents niveaux s'inscrivent en continu, au point qu'il est souvent difficile de savoir quand on passe de l'un à l'autre. Même dans les cas où un effet stylistique peut être reproduit de façon littérale dans une autre langue, il ne produira pas nécessairement le même effet parce qu'il sera isolé des phénomènes langagiers qui le conditionnent.
La différence que nous avons évoquée entre la langue de catégories textuelles différentes (littérature, textes scientifiques, textes administratifs) n'est pas aussi radicale qu'on a tendance à le croire. Il est certain qu'on ne traduit pas un texte littéraire comme on traduit une recette de cuisine. Néanmoins, ce qui apparaît de façon éclatante dans les ensembles de textes transcatégoriels, c'est que tout texte produit dans une même langue partage un fond commun de langue courante qui est, elle, non différenciée. Quelques exemples à partir de l'anglais et du français suffiront à le démontrer :
– « The voice was still in his ears, but the turf whereon he lay sprawled was clearly vacant », K. Graham (« Taupe croyait encore l'entendre et vit qu'il n'y avait plus personne sur le gazon où un instant auparavant il était étendu », J. Parsons).
– « ... Some familiarity with the theoretical and descriptive studies listed in the bibliography is pre-supposed », N. Chomsky (« ... l'on supposera une certaine pratique des études théoriques et descriptives citées dans la bibliographie », J. C. Milner).
– « Du moins, on ne connaît pas chez nous le désordre », A. Camus (« But a least, social unrest is quite unknown among us », S. Gilbert).
Ces exemples sont pris volontairement dans des textes de nature différente : histoires pour enfants, romans, ouvrages théoriques. Ils comportent tous dans la version française, qu'il s'agisse de la traduction ou de l'original, un verbe qui exprime la perception ou la connaissance. En anglais, c'est systématiquement l'objet de perception ou de connaissance qui paraît en position initiale. La transformation dans le passage à l'autre langue est, dans certains cas, soumise à des contraintes grammaticales. Mais, même lorsque ce n'est pas le cas, on pourrait en multiplier les exemples. Cette transformation n'est cependant pas significative en tant que phénomène isolé. Elle s'inscrit dans un ensemble de paramètres langagiers où cette différence d'orientation paraît également. Ainsi, dans les énoncés suivants, les éléments introduits en anglais par « there is » sont systématiquement repérés en français par rapport à un terme source désignant un animé humain.
– « There were many friends with us as we waited for the results to come in », M. Thatcher (« J'avais beaucoup d'amis avec moi devant ces longues heures où nous attendions les résultats » ; P. Blot et al.).
– « ... there's blood on your hands », A. Christie (« ... vous avez du sang sur les mains », M. Le Houbie).
– « Et Maigret tournait le bout de papier en tous sens. Il lui trouvait quelque chose d'équivoque », G. Simenon (« Maigret turned the piece of paper over and over. There was something peculiar about it », R. Baldick).
On pourrait encore citer comme exemples les cas où une tournure passive sera préférée en anglais et une structure active en français. Ces contraintes entraînent de nombreuses modifications dans le passage à l'autre langue et rendent nécessairement l'identité entre les deux textes illusoire. En revanche, il existe des opérations communes à toutes les langues qui permettent d'établir des équivalences. Ce sont ces propriétés communes qui rendent la traduction possible.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jacqueline GUILLEMIN-FLESCHER : agrégée d'anglais, docteur d'État, professeur d'études anglophones à l'université de Paris-VII
Classification
Média
Autres références
-
ABRAHAM IBN DAUD dit RABAD Ier (1110 env.-env. 1180)
- Écrit par Gérard NAHON
- 595 mots
Historien, philosophe et astronome juif, Abraham ben David Halevi dit Ibn Daud ou Rabad Ier (Rabbi Abraham b. David) est connu des théologiens et philosophes latins du Moyen Âge sous le nom d'Avendauth et, notamment, à travers son œuvre de traducteur de l'arabe en latin (dont il s'acquitta parfois...
-
ANQUETIL-DUPERRON ABRAHAM HYACINTHE (1731-1805)
- Écrit par Jean VARENNE
- 865 mots
Orientaliste français qui révéla à l'Europe les livres sacrés du zoroastrisme et de l'hindouisme. La curiosité des Européens pour les civilisations anciennes d'Orient (Perse, Inde...) date des premières découvertes de Marco Polo et de Vasco de Gama ; accrue au cours des siècles,...
-
BAUDRILLARD JEAN (1929-2007)
- Écrit par Jean-Claude BUSSIÈRE
- 1 040 mots
- 1 média
Sociologue et philosophe, Jean Baudrillard est né le 20 juillet 1929 à Reims dans une famille d'origine paysanne. Fils unique et studieux, il est remarqué par ses instituteurs, qui soutiennent son dossier de bourse. Il intègre le lycée Henri-IV, à Paris, où il prépare le concours d'entrée à l'École...
-
BOUCHET ANDRÉ DU (1924-2001)
- Écrit par Michel COLLOT
- 839 mots
André du Bouchet est unanimement reconnu comme un des plus importants poètes français de la seconde moitié du xxe siècle. Ses débuts coïncident avec le déclin du surréalisme, dont il rejette, avec d'autres, la dérive ésotériste et la fuite dans l'imaginaire. Il reconnaît chez Reverdy l'exemple...
- Afficher les 53 références
Voir aussi