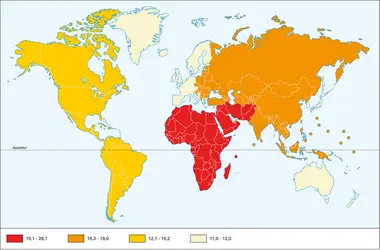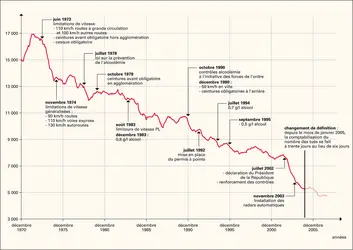TRANSPORTS Transports et risques
Article modifié le
Prévention des actes illicites : la sûreté
Le traitement des risques dus aux aléas de fonctionnement des systèmes de transport, qu'ils soient d'origine matérielle ou qu'ils relèvent du facteur humain est une opération de sécurité (safety en anglais). Celle-ci se décompose en plusieurs stades : la prévention pour éviter la survenance de l'événement redouté, l'alerte pour prévenir les exploitants, les usagers et les services de secours, la protection pour limiter les conséquences de cet événement et enfin l'intervention pour porter secours.
Dans le cas d'actes illicites, qui ne sont plus aléatoires mais intentionnels, ces divers stades existent toujours mais doivent être adaptés, en particulier celui de la prévention. Le terme employé est alors celui de sûreté (security en anglais). Il est évident qu'une politique de sûreté, c'est-à-dire de prévention des actes illicites nécessite de les connaître précisément. Cela n'est pas toujours le cas car on peut assister à une escalade difficile à prévoir comme les attentats du 11 septembre 2001 l'ont montré alors que la parade en place était toujours axée sur le détournement des avions de transport de passagers initié en 1970 avec quatre cas au Moyen-Orient puis sur l'introduction d'explosifs à bord comme les destructions d'avion en vol en 1998 au-dessus de Lockerbie (Royaume-Uni) et du désert du Ténéré.
Classiquement, les professionnels distinguent trois types d'actes illicites : la délinquance comme la fraude au titre de transport, qui touche l'exploitation des systèmes ; la malveillance et le sabotage pour détériorer les infrastructures, le matériel roulant et leur environnement ; enfin, les actes de terrorisme qui portent atteinte aux vies humaines.
Certes les exemples de l'aviation civile sont les plus connus mais ces actes touchent tous les modes de transport, depuis les attaques de particuliers par des voleurs dans leur voiture jusqu'aux actes de piraterie maritime, en passant par les sabotages des réseaux ferroviaires et les agressions dans les transports en commun.
Les principes de la sûreté
Les actes illicites constituent une menace particulièrement grave dans le cas de l'atteinte aux vies humaines. Afin d'assurer une politique de prévention proportionnée, il importe d'abord de s'assurer du degré de cette menace, c'est l'objet du renseignement conduit par les pouvoirs publics à tous les niveaux, du local à la coopération internationale. Une gradation dans l'importance des mesures est alors prévue comme par exemple au niveau national français avec les quatre degrés d'alerte que comporte le plan Vigipirate. Dans les transports, ce sont les opérateurs qui sont concernés au premier chef par leur mise en œuvre mais les services publics sont amenés à intervenir fortement aux deux derniers degrés pour renforcer leurs actions et même en prendre en charge de nouvelles en matière de surveillance et de contrôle.
Cela étant, ces mesures peuvent être non seulement graduées mais aussi systématiques ou aléatoires. Un bon renseignement peut même conduire à des actions aléatoires et en partie ciblées. Les services de la douane pratiquent régulièrement cette méthode en matière de transport de marchandises illicites, ce qui évite des contrôles lents et coûteux pénalisant pour le commerce. La police opère de même en matière de contrôles d'identité.
C'est ainsi que les mesures examinées ci-après sont plus ou moins complètement mises en œuvre.
Les principales mesures de sûreté
Il s'agit essentiellement du contrôle de tout ce qui doit être protégé et/ou de ce qui peut-être vecteur de danger, homme ou machine.
À ce titre, il convient de protéger de toute intrusion ce qui est d'importance vitale pour la sécurité du transport : les centres de contrôle de la navigation aérienne, les centres de surveillance de la sécurité maritime, les zones réservées des aéroports et les terminaux des ports et du tunnel sous la Manche, les ateliers des transporteurs ferroviaires, etc. La question est de savoir jusqu'où et à quel degré étendre cette protection. Les actes de malveillance affectant les transports ferroviaires et urbains guidés conduisent déjà à clôturer et surveiller certaines infrastructures ; certaines routes maritimes doivent être surveillées en cas de menace terroriste ou de piraterie comme cela a pu être perçu lors de l'abordage dans le golfe d'Aden (au large de la Somalie), en août 2008, du Ponant, trois-mâts de croisière français.
Le contrôle doit ensuite porter : sur les matériels de transport, qui doivent être « stérilisés » avant emploi, et où le personnel chargé des tâches de sécurité doit être protégé, en particulier les pilotes et les conducteurs ; sur les personnels des exploitants eux-mêmes, à tout niveau, allant jusqu'à un agrément avec dispositif de reconnaissance biométrique dans l'aviation ; sur les passagers et leurs bagages ; sur les marchandises transportées ; sur les divers consommables utilisés à bord des matériels de transport.
Il est bien évident que ce contrôle ne peut pas être de la même intensité selon le service de transport concerné. L'ancienneté des actes terroristes et le fait que le transport aérien ait été international dès sa création a abouti à un contrôle intégral pour ce mode de transport encore que celui-ci puisse être renforcé en cas de crise grave.
À l'inverse, personne n'imaginerait être contrôlé systématiquement dans sa voiture au franchissement d'un long tunnel routier ou passer un portique de détection avant de prendre le métro. La notion de contrôle est remplacée dans ce cas par celle de surveillance par le personnel de l'exploitant, éventuellement renforcé par les agents de la force publique et assisté par des moyens de visualisation et d'alerte à distance. Les mesures peuvent alors être graduées selon le mode de transport et les caractéristiques des menaces comme cela se pratique sur certaines grandes lignes ferroviaires et maritimes à courte distance.
La coopération internationale
Certes chaque pays est responsable de ses actions de défense pour assurer la sécurité de ses citoyens et c'est dans ce cadre que chaque État agit. En France, par exemple, l'ensemble des décisions et leur application relèvent du Premier ministre assisté pour cela par le Secrétariat général à la Défense nationale et les hauts fonctionnaires de Défense de chaque ministère. Il est cependant évident que, dans les transports internationaux, un accord multinational ou parfois bi-national, comme dans le cas du tunnel sous la Manche, s'impose. Les deux accords les plus importants s'inscrivent dans ce cadre avec une annexe à la convention de Chicago pour le transport aérien et une annexe dite code I.S.P.S. (International Ships and Port facilities Security) à la convention Solas. Ces deux annexes ont donné lieu à des textes européens complémentaires, transposés en droit français pour rendre le tout applicable et aboutir aux dispositifs actuels.
Sans entrer dans le détail de ceux-ci, on peut préciser que tout armateur et toute compagnie aérienne ainsi que tout exploitant de port ou d'aéroport doit établir un programme de sûreté bâti sur les principes précédents et que ceux-ci sont audités à trois niveaux, celui de l'opérateur, celui des administrations nationales responsables des transports, enfin à l'échelle internationale pour le transport aérien.
Précisons que le transport de marchandises comporte une option pour éviter de trop lourds contrôles aux frontières, notamment pour le transport aérien. Afin de ne pas procéder à un examen systématique aussi fouillé que pour les passagers, les chargeurs peuvent adopter la procédure du « chargeur connu » où toutes les obligations de sûreté sont assurées par leurs soins avant expédition. Bien entendu, ils doivent alors être agréés pour cela et assurer en interne et pendant le transport terrestre d'approche toutes les obligations qui sinon s'imposeraient au passage dans l'aéroport.
Tous les principes et les procédures qui viennent d'être évoqués comportent déjà l'usage de technologies avancées comme la biométrie pour identifier les personnes, les clés sécurisées pour fermer et ouvrir les conteneurs à distance, les barrières fictives anti-intrusion sans compter les tomographes, les détecteurs de particules...
Deux voies de perfectionnement sont à envisager pour le futur : celle de l'amélioration des processus de contrôle tant par des appareils plus perfectionnés que par une meilleure traçabilité des opérations concernant les hommes et les marchandises comme l'automatisation de l'identification approfondie des passagers et l'extension à tous les modes de transport du chargeur connu, le suivi par satellite des marchandises dangereuses à haut risque ...
– celle de la surveillance accrue dans les modes où le contrôle systématique est impensable : compléter la vidéo-surveillance par des logiciels de reconnaissance de mouvements suspects et y ajouter les apports de l'audio-surveillance par exemple pour automatiser l'alerte après levée du doute.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Michel QUATRE : ingénieur diplômé de l'École polytechnique et de l'École nationale des ponts et chaussées
Classification
Médias
Autres références
-
AGRICOLE RÉVOLUTION
- Écrit par Abel POITRINEAU et Gabriel WACKERMANN
- 8 077 mots
...avantages offerts par les marchés nationaux, continentaux et transcontinentaux, eux-mêmes activés par la progression du libre-échange et, surtout, des moyens de locomotion ; l'irruption de la machine à vapeur a accéléré la mise au point du chemin de fer, de la navigation fluviale, puis maritime,... -
ALASKA
- Écrit par Claire ALIX et Yvon CSONKA
- 6 051 mots
- 10 médias
L'Alaska Highway, construite par l'armée en 1942, relie Fairbanks au reste des États-Unis en passant par le Canada. Un embranchement mène à Haines, seule localité de la région Sud-Est accessible par la route. De Fairbanks, deux routes permettent d'atteindre Anchorage et les bassins au sud de la chaîne... -
ARGENTINE
- Écrit par Jacques BRASSEUL , Encyclopædia Universalis , Romain GAIGNARD , Roland LABARRE , Luis MIOTTI , Carlos QUENAN , Jérémy RUBENSTEIN , Sébastien VELUT et David COPELLO
- 38 895 mots
- 19 médias
Lesréseaux de communication dans le pays ont été organisés en fonction des itinéraires d'exportation, conférant aux routes principales et aux voies ferrées une forme caractéristique en éventail convergeant vers la capitale et ses satellites. Il existe trois axes historiques reliant Buenos Aires aux... -
ATLANTA
- Écrit par Laurent VERMEERSCH
- 1 255 mots
- 2 médias
Symbole de l’affirmation économique des villes du sud des États-Unis, Atlanta est passée en quarante ans du rang de ville moyenne à celui de métropole internationale. Alors que l’agglomération comptait 2 millions d’habitants en 1980, elle en compte 5,9 millions en 2017, dont 420 000 dans la commune...
- Afficher les 30 références
Voir aussi
- ACCIDENTS
- ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
- SÉCURITÉ
- RÉGLEMENTATION & RÈGLES
- CATASTROPHES TECHNOLOGIQUES
- ROUTES & AUTOROUTES
- PRÉVENTION
- AVIATION CIVILE
- TUNNELS ROUTIERS SÉCURITÉ DANS LES
- TRANSPORT DE MARCHANDISES ou FRET
- TRANSPORT DE VOYAGEURS
- TRANSPORTS EN COMMUN
- TRAINS, chemins de fer
- TRANSPORT ROUTIER
- TRANSPORT FERROVIAIRE
- FRANCE, histoire, de 1974 à nos jours
- NAUFRAGES
- TRANSPORT & TRAFIC MARITIMES
- PÉTROLIER
- TRANSPORT & TRAFIC AÉRIENS
- INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT
- TRANSPORT TERRESTRE
- NORMALISATION
- RISQUES TECHNOLOGIQUES