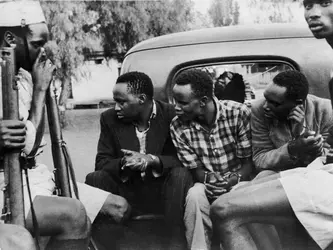TRIBALISME
Article modifié le
Le tribalisme aux prises avec le colonialisme
La résistance anticoloniale
Les premières réactions tribales à l'occupation ou à la conquête coloniale ont donné lieu au développement de formes semblables aux précédentes. Mais une caractéristique fondamentale les en différencie : c'est une cause externe, visant à supprimer ou à contrôler les structures sociales tribales, qui suscite ce tribalisme. Dès lors, celui-ci n'est qu'un instrument de mobilisation politique ou de simple survie sociale (et donc physique en un sens). Ce n'est plus la logique des contradictions internes aux sociétés qui s'exprime, c'est la confrontation avec un processus de domination, comportant destruction de la culture traditionnelle et acculturation systématique par l'Occident. C'est pourquoi le cadre de référence de ce tribalisme est à la fois le groupe dont il est issu et la situation de domination qui l'a provoqué.
Ainsi se développe l'unification « tribaliste » de groupes sociaux hétérogènes habituellement de petite taille. Les confédérations, les associations intertribales se multiplient et prennent parfois l'aspect d'un supertribalisme culturel. La fameuse conquête de l'Ouest a vu des phénomènes de ce genre apparaître chez les Indiens des plaines. Les luttes intertribales ne sont alors qu'une exacerbation des difficultés objectives à constituer un front uni face à un ennemi commun. La tentative de défendre un héritage qui risque de disparaître peut donner naissance à des mouvements d'exaltation de la tradition culturelle, religieuse ou politique. On peut parler de tribalisme, si ces phénomènes s'expriment au moyen d'institutions spécifiquement tribales.
M. I. Pereira de Quéiroz distingue bien deux sortes de réactions à la présence des Blancs parmi les Indiens des forêts d'Amérique latine, dont l'une peut être qualifiée de tribaliste alors que l'autre est messianique. Les Indiens acculturés par l'Occident réagissent les premiers, mais ils inventent une nouvelle religion et des sectes. Par contre, les Indiens dont la structure sociale se trouve encore relativement intacte s'organisent intertribalement selon un modèle guerrier. Bien qu'identiques, les intentions de ces deux mouvements s'expriment dans des formes tout à fait différentes et seule la seconde constitue un tribalisme.
Mais ce tribalisme de défense, qui s'impose comme seul moyen de maintenir la continuité de la vie sociale traditionnelle, devient parfois un véritable instrument de recréation tribale. Ainsi, les Séminoles de la Floride sont nés de la fusion de fragments de tribus dispersées par les colonisateurs. Cette synthèse culturelle et tribale peut même être totalement arbitraire comme dans le cas des Makah de la côte du nord-ouest de l'Amérique : l'entité tribale est ici la réunion de groupes humains totalement hétérogènes, et c'est leur dépendance commune qui les a unifiés.
Ces faux archaïsmes traversent l'anthropologie de toute part. Mais si les apparences sont parfois trompeuses, il y a des situations où c'est l'occupant blanc qui synthétise des groupes distincts, qui les supertribalise en quelque sorte. L'exemple le plus frappant est celui des Yoruba du Nigeria. À l'époque précoloniale, le terme Yoruba ne s'appliquait qu'au royaume d'Oyo, et il n'y avait pas d'expression commune pour désigner les autres royaumes apparentés, dont les membres se considéraient néanmoins comme des étrangers. Ce sont les premiers missionnaires qui ont appelé Yoruba l'ensemble de ces États, et, depuis, cette appellation a eu des conséquences linguistiques et culturelles.
Le développement économique capitaliste
L'implantation d'une économie coloniale et de marché, l'accentuation du sous-développement ont transformé les conditions d'existence des structures tribales et, donc, du tribalisme. Deux phénomènes se sont produits simultanément : une domination des systèmes tribaux par les mécanismes propres à l'économie capitaliste et la naissance de formes nouvelles de morphologie sociale : la ville, l'usine. Les tribalismes anciens – originels – ont disparu. D'abord à cause de la destruction physique ou de la dispersion irrémédiable des groupes qu'ils exprimaient et constituaient. Mais surtout parce qu'ils ne sont plus qu'une apparence formelle investie de sens différents selon la conjoncture.
Pourtant, les interprétations anthropologiques et sociologiques conservent au tribalisme sa référence traditionnelle. Cela tient à la prédominance des théories fonctionnalistes et dualistes dans le traitement de ce problème. Dans cette optique, les choses sont simples : il y a le rural et l'urbain. Le premier secteur, traditionnel, est le propre du tribalisme. L' urbanisation est à la fois synonyme de modernité et de détribalisation. La migration, en un premier temps, est une négation, une perte de l'identité sociale tribale. Mais la nature même de l'urbanisation provoquerait de fait, en un second temps, une retribalisation ou une supertribalisation qui conserverait certaines apparences de tribalisme.
Pour M. Gluckman, le tribalisme de la ville africaine est celui de toutes les villes habitées par de nombreux groupes ethniques. Mais alors que les groupes fonctionnels de l'urbanisation occidentale sont déterminés par les institutions et les valeurs d'une économie capitaliste, en Afrique noire c'est le secteur tribal (sous-entendu rural) qui impose ses catégories. Le tribalisme est donc une complémentarité fonctionnelle de l'économie dite moderne. Cependant, même en tant que produit d'une nouvelle situation historique, le tribalisme urbain ne peut se confondre avec le tribalisme rural. Comme l'explique J. Lombard : « La réalité tribale rurale ne ressemble en rien au groupe ethnique qui se forme en ville. » Par ailleurs, les associations d'originaires sont la forme dominante de ce tribalisme : ce sont des groupes d'entraide et d'assistance sociale. On peut même dire que « l'émigré recherche avant tout les formes de solidarité les plus étroites possibles, familiales plutôt que villageoises, villageoises plutôt que tribales, parce que les possibilités d'assistance seront plus grandes dans les premières que dans les secondes ».
Cette relativisation du tribalisme a été également mise en lumière par le développement du syndicalisme dans le milieu industriel, les associations tribales n'étant pas les organismes les plus efficaces de défense professionnelle (voir notamment les travaux de J. C. Mitchell et ceux de A. L. Epstein sur les centres miniers de l'Afrique de l'Est et du Sud). Ce tribalisme est donc vide de sens ou subordonné à des réalités que ce terme ne peut absolument pas expliquer par lui-même.
Les luttes nationalistes
On a vu qu'il existait un tribalisme originel de défense et de résistance. Le tribalisme des luttes anticoloniales en tant qu'instrument politique de mobilisation volontaire est tout à fait différent. C'est un tribalisme complexe qui joue sur deux registres : ses moyens sont indéniablement tribaux, mais ses objectifs ne le sont plus du tout.
C'est cette contradiction qui explique à la fois le succès et les limites du mouvement des Mau-Mau au Kenya dans les années 1952-1954. Pour R. Buitenhuijs, « vu sous son aspect de mouvement de renouveau culturel, le mouvement mau-mau est incontestablement un mouvement tribal ». Ce sont les valeurs et les symboles kikuyu qui permettent d'unir le peuple kikuyu contre le colonisateur. Mais ce tribalisme kikuyu, tout en renforçant l'anticolonialisme des Mau-Mau, ne permet pas à leur mouvement de toucher les autres ethnies. Ressuscitant des comportements traditionnels en voie de disparition, ce tribalisme n'en est pas moins et avant tout un anticolonialisme. Cela permet à Buitenhuijs de reprendre une expression de J. Favret et de caractériser la révolte des Mau-Mau comme un « traditionalisme par excès de modernité ». Ce tribalisme kikuyu n'est pas dirigé contre d'autres tribalismes.
Lorsque la polarisation anticoloniale disparaît, le tribalisme n'est plus au service du nationalisme, car il s'y oppose théoriquement, mais il s'agit là d'une fausse opposition. En effet, les contradictions raciales et coloniales, qui justifiaient un retour partiel au passé tribal, seul capable de construire une mémoire et une conscience communes, cèdent la place à des contradictions sociales internes, communes à l'ensemble des groupes tribaux. D'un tribalisme à la fois substitut et moteur du nationalisme on passe à un tribalisme garant et moyen de domination de certains groupes sociaux.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean COPANS : docteur de troisième cycle (sociologie), maître assistant au Centre d'études africaines de l'École des hautes études en sciences sociales
Classification
Médias
Autres références
-
ETHNIE
- Écrit par Jean-Loup AMSELLE
- 3 865 mots
- 1 média
De la même façon, il n'existe pas de coupure entre letribalisme moderne et son homologue ancien dans les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Le mouvement de franchissement des barrières ethniques, de migration vers les villes (détribalisation) et d'utilisation des réseaux de natifs comme... -
TRIBU
- Écrit par Maurice GODELIER
- 9 680 mots
- 3 médias
Les anthropologues désignent habituellement par le terme « tribu » deux réalités, deux domaines de faits différents mais liés. D'une part, presque tous s'en servent pour distinguer un type de sociétéparmi d'autres, un mode d' organisation sociale spécifique qu'ils comparent...
Voir aussi