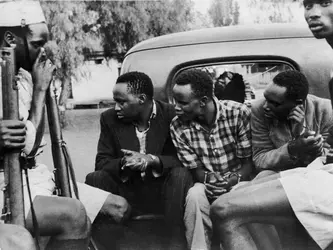TRIBALISME
Article modifié le
Le tribalisme dans la société contemporaine
Les luttes sociales
Les anthropologues et les sociologues perçoivent encore à peine les dimensions inédites du tribalisme en liaison avec les luttes sociales ; ses rapports avec les tribalismes originels ou les tribalismes reconstitués de l'époque coloniale sont, de ce point de vue, des plus ténus. D'après J. Lombard, les contradictions sociales risquent de prendre et d'utiliser une forme tribale lorsqu'il y a deux ou trois grandes ethnies majoritaires à l'intérieur du cadre national. Dans les cas où c'est un seul groupe ethno-culturel qui domine ou au contraire une multiplicité d'ethnies qui s'équilibrent, l'argument tribaliste a moins de chances de prévaloir. Pour P. Mercier et P. L. van den Berghe, c'est la rareté des ressources et donc la lutte pour le pouvoir et les richesses qui expliquent les conflits ethniques et tribaux. C'est surtout au sein des classes privilégiées que la compétition prend ce caractère.
Il n'est pas évident que ce tribalisme empêche le développement de classes sociales et l'apparition d'une conscience de classe. Certains anthropologues pensent même que le tribalisme offre à l'heure actuelle un des moyens les plus efficaces de domination idéologique à certaines classes sociales : bourgeoisie naissante, bureaucratie. Ce tribalisme s'intègre à leur tactique politique ; il mobilise une masse de manœuvre et fait diversion ; il est mystificateur. Il n'exprime donc plus du tout l'ensemble des caractéristiques et des intérêts d'un groupe tribal ou de son élite politique et économique traditionnelle. Au contraire, ce nouveau tribalisme est plutôt une idéologie de classe. Son particularisme est sans doute trompeur, mais il provient du fait que seul un tribalisme peut toucher les groupes et classes dominés : il est la traduction obligée de la domination, si elle veut se maintenir et s'étendre.
L'histoire récente du Nigeria et la sécession ratée du Biafra le démontrent bien. C'est le processus colonial qui, par la scolarisation massive des Ibo, est à l'origine des particularités sociales et ethniques du groupe des fonctionnaires et des militaires. Les élites politiques haoussa n'avaient pas le pouvoir et la prééminence politique correspondant à leur place économique dans la société nigérienne, alors que les fonctionnaires ibo n'avaient pas l'ensemble de la base matérielle et économique correspondant à la place qu'ils occupaient dans l'appareil militaire et administratif. L'appel au nationalisme ethnique, au tribalisme, était dans ce cas le seul moyen idéologique à la disposition des fonctionnaires et bourgeois ibo pour mobiliser l'ensemble de la population ibo dans la défense de ses intérêts de classe.
Formes communautaires et idéologie tribaliste
Produit spécifique de la situation d'où il tire son nom, le tribalisme néo-colonial est un tribalisme aliénant. Il vise à faire accepter la domination de certains groupes sociaux par l'ensemble des groupes dominés et exploités. Parfois, il permet même de susciter de faux conflits entre groupes dominés, afin de consolider la domination de classes encore faibles sur le plan numérique ou institutionnel. Dans le cas où le tribalisme est l'idéologie dominante, la lutte contre celle-ci passe obligatoirement par un antitribalisme.
Il existe pourtant des tribalismes libérateurs. C'est ainsi qu'on peut qualifier le contenu des luttes récentes des Indiens d'Amérique du Nord. Ce tribalisme indien vise plusieurs objectifs : il est d'abord pantribal ou panindien ; il n'est donc pas la propriété d'un groupe tribal particulier. La déliquescence de la vie indienne dans les réserves et la dispersion de celles-ci à travers tout le territoire des États-Unis et du Canada rendent nécessaire une unité du peuple ou de la nation indienne, unité qui n'a d'ailleurs de réalité que dans la politique faite aux Indiens depuis la conquête et non dans leur passé socioculturel. Ce tribalisme est d'autre part une critique de l'ordre établi ou du moins un contre-modèle de la société blanche existante. Il s'oppose à la fois à l'individualisme bourgeois et chrétien et à la société de consommation de la « foule solitaire ». Ce tribalisme peut d'ailleurs se trouver aux prises avec une situation politique particulièrement complexe. Ainsi, au Canada, dans la mesure où c'est le gouvernement fédéral qui administre les populations et le territoire des Amérindiens et des Inuit, la modernisation et la scolarisation ont été synonymes d'anglicisation. C'est pourquoi la volonté de récupération des revendications autochtones par les nationalistes et indépendantistes du Parti québecois, au pouvoir dans la province de Québec depuis 1976, a suscité de vives oppositions. Le « tribalisme » indien s'est donc trouvé soumis à une double domination politique et à des stratégies complexes de cooptation. Néanmoins, le contenu souvent radical de certaines luttes (comme en témoigne le cas du barrage de la baie James, des eaux de pêches des Montagnais) a permis de revaloriser les formes « traditionnelles » de subsistance et de s'opposer, au moins idéologiquement, à un processus de marginalisation. Les films du cinéaste Arthur Lamothe sont un précieux témoignage de cette quête d'identité.
Instrument d'identification et donc de repli dans les réserves, le tribalisme risquait de disparaître avec la fin des réserves et les migrations en ville. C'est pourquoi les mouvements indiens veulent urbaniser la vie tribale et tribaliser la vie urbaine. Le petit groupe (tribal) prend le pas sur les masses anonymes. En décrivant le tribalisme comme une démocratie participante, les idéologues indiens débouchent sur une défense des structures locales opprimées et réprimées par les systèmes bureaucratiques.
Selon les orientations politiques, ce tribalisme est un Red Power (un « pouvoir rouge ») ou bien un réformisme humaniste. Mais une question se pose : l'unité politique pantribale nécessaire pour faire aboutir les revendications indiennes peut-elle donner naissance à une véritable culture tribale de symbiose ? Ce tribalisme privilégie la communauté, le groupe restreint : il devient une construction idéologique volontaire. Les essais de Vine Deloria Jr. sont instructifs à cet égard : un tel tribalisme n'est rien d'autre qu'un pluralisme culturel pseudo-autogestionnaire.
À la limite, il est celui de la jeunesse contestataire, des hippies et des communes. La tribu est une image publicitaire, un hochet sémantique.
Cette simple énumération illustre les ambiguïtés, pour ne pas dire les emplois contradictoires, du mot tribalisme. Cette situation théorique correspond toutefois à une réalité sociale en pleine évolution et exprime un phénomène dont on cerne imparfaitement les lois. La transformation plus ou moins ancienne des sociétés précoloniales ou précapitalistes suscite des formes nouvelles où se combinent, se juxtaposent ou s'intègrent des éléments de provenance historique et sociale très variée. Les continuités sont plus prégnantes qu'on ne le croit, les mutations plus en profondeur qu'elles ne le paraissent. En reprenant les distinctions établies par G. Balandier à propos des traditionalismes, on pourrait classer les tribalismes dans des catégories qui sont autant de transitions ou de ruptures. Au tribalisme fondamental succèdent les tribalismes formels ou de résistance. Le langage tribaliste en tant que traduction n'est plus alors qu'un pseudotribalisme. Une certitude demeure : la mort des tribus n'est pas la fin du tribalisme.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean COPANS : docteur de troisième cycle (sociologie), maître assistant au Centre d'études africaines de l'École des hautes études en sciences sociales
Classification
Médias
Autres références
-
ETHNIE
- Écrit par Jean-Loup AMSELLE
- 3 865 mots
- 1 média
De la même façon, il n'existe pas de coupure entre letribalisme moderne et son homologue ancien dans les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Le mouvement de franchissement des barrières ethniques, de migration vers les villes (détribalisation) et d'utilisation des réseaux de natifs comme... -
TRIBU
- Écrit par Maurice GODELIER
- 9 680 mots
- 3 médias
Les anthropologues désignent habituellement par le terme « tribu » deux réalités, deux domaines de faits différents mais liés. D'une part, presque tous s'en servent pour distinguer un type de sociétéparmi d'autres, un mode d' organisation sociale spécifique qu'ils comparent...
Voir aussi