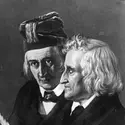TYPOLOGIE, sociologie
Article modifié le
Le mot « typologie » apparaît au xixe siècle pour désigner les types ou les classifications des sciences de la nature, et différencier leur mode d'élaboration « scientifique » des classifications communes ou des types des philosophes et des exégètes bibliques. Il implique, comme en philosophie, une explicitation raisonnée des principes « essentiels » des êtres et des choses mais aussi des méthodes expérimentales validant des hypothèses.
La sociologie adapte ce mode d'élaboration pour expliquer et comprendre les sociétés humaines. Auguste Comte la place au premier rang de sa typologie des sciences : toute pensée et toute organisation sont une construction historique et sociale. L'ambition est grande : elle soutient d'abord la mise en œuvre de macrotypologies de l'évolution des sociétés qui différencient la sociologie d'autres sciences sociales. Les typologies limiteront ensuite leurs objets tout en approfondissant leurs méthodes et en prenant distance avec le modèle « positiviste » des sciences de la nature.
Les macrotypologies des pères fondateurs posent des principes durables. Émile Durkheim en énonce dans les Règles de la méthode sociologique : expliquer le social par le social ; chercher les causes et les fonctions dans l'histoire ; les classer en privilégiant leurs manifestations les plus visibles et durables ; les relier logiquement entre elles (Max Weber dira « comprendre », on parlera de causalité structurale). Pour Durkheim, « la sociologie est comparative » : elle compare des hypothèses et leurs effets attendus aux faits sociaux observables, compare les variations des types sociaux ainsi définis. Karl Marx et Max Weber posent des principes analogues avec d'autres accentuations. La « domination » du mode de production est fortement affirmée par Marx ; pour Weber la méthode est « idéaltypique » et implique de privilégier des points de vue et des concepts dont « on ne peut savoir s'ils sont pur jeu de la pensée ou féconds pour la science » avant de « leur comparer la réalité ».
Ils retiennent des déterminants communs (démographie, économie, droit, etc.) mais ceux qu'ils privilégient les opposent. Marx classe les sociétés en fonction de leur mode de production. Selon Durkheim, la différenciation croissante des sociétés est une augmentation de « densité morale » qui induit une division sociale du travail, un autre type de solidarité (plus fonctionnelle, moins communautaire) et une rationalisation et individualisation croissantes ; trop rapide, l'évolution entraîne une anomiemorale et juridique dans les sociétés capitalistes. Weber quant à lui analyse ce que l'esprit du capitalisme doit à un type d'éthique protestante.
Tandis que l'héritage de Marx a été clivé par la guerre froide puis disqualifié par le néolibéralisme, les analyses durkheimiennes perdurent pendant près d'un demi-siècle, aux États-Unis notamment. En référence aussi à Ferdinand Tönnies, une opposition binaire entre communautés (traditionnelles) et sociétés (modernes) se décline sous des intitulés divers : sociétés closes et ouvertes (Karl Popper), sacrées et profanes (Ernest Becker), etc. La rationalité, l'autonomisation de la culture et des individus y sont souvent valorisées. Dans les typologies, on emprunte aussi à Weber les notions de différenciation du monde de l'action et de la pensée, du savant et du politique, des types de morale, de gestion du sacré, de rationalité et de légitimité. Weber n'a cessé de retravailler ces notions. Ses macrotypologies (économie, droit, religion...) sont, en ce sens, inabouties. Leurs exigences préfigurent une évolution vers des objets plus limités, des déterminations plus complexes de typologies plus ouvertes. Essais de synthèse des macrotypologies, celles de Talcott Parsons et Robert K. Merton en annoncent aussi le déclin. Norbert Elias aura le sentiment de renouer avec elles en étudiant le long processus de civilisation et d'intériorisation des contraintes par les individus. Son analyse détaillée des comportements et des interactions participe pourtant d'une orientation nouvelle.
Les typologies s'articulent en effet de plus en plus à des recherches « empiriques ». Les divergences entre « recherche de terrain qualitative » et « enquête quantitative » s'accusent. Chacune affine ses méthodes, l'une plutôt pour comprendre, l'autre pour expliquer des objets qui se différencient. Mais des orientations descriptives (sociographiques ou statistiques) détournent parfois du principe des typologies : expliquer et comprendre.
Intégrant des observations de terrain, les typologies analysent des pratiques et des interactions, et affinent sur des « cas construits » des grilles de lecture applicables à d'autres. Trois exemples illustrent la limitation progressive des objets.
Pierre Bourdieu engage une typologie des « champs sociaux » (économique, politique, culturel...), en analyse des types (champ littéraire, de la mode, des institutions éducatives, de l'économie...). Chacun structure, en les polarisant, les positions occupées dans son espace ainsi que les pratiques, les représentations, les stratégies et les interactions de ceux qui les occupent. L'accès à ces positions dépend des types de trajectoires qui déterminent les volumes et les structures des « espèces de capital » détenu. Cette typologie est ouverte à d'autres « cas » d'une histoire structurale des champs qu'elle aide alors à construire.
Observant la condition des malades mentaux en hôpital psychiatrique, Erving Goffman articule le projet réformateur (guérir) et la surveillance généralisée de l'institution à son système de contraintes auxquelles les « internés » répondent par des stratégies d'adaptation et de résistance qui sont tenues pour autant de symptômes. L'hôpital est un type d'« institution totale » parmi d'autres (foyers, internats, monastères, prisons...). Son analyse engage une typologie des interactions. Grille d'analyse ouverte, elle est applicable à l'étude d'autres institutions totales et d'autres interactions sociales.
Des microtypologies sont plus ouvertes encore. Qu'il s'agisse des types de carrières déviantes dont Howard S. Becker compare la genèse ou des rites d'interaction que Goffman observe dans les mises en scène de la vie quotidienne, elles se gardent de conclure. Elles affinent des grilles de lecture de « modèles séquentiels », de « cadres de l'expérience » pour comprendre « comment ça marche » dans les interactions : ce sont des typologies de travail.
Les typologies quantitatives illustrent une tendance inverse : une montée en généralité soutenue par les progrès de l'informatisation et la monopolisation par les statistiques de la définition légitime de « la représentativité » et du caractère « significatif » de ses analyses. Elles procèdent d'enquêtes par questionnaire et d'entretiens semi-directifs dont l'analyse par la méthode « des tas » est relayée par l'analyse informatisée des occurrences. Dans le traitement du nombre, croiser des variables (tableaux) devient un outil d'analyse et de typologies possibles. Durkheim a ouvert la voie. À partir de statistiques nationales des suicides, il constate que leur fréquence varie en fonction de différents « états des milieux sociaux » et en déduit une typologie des causes de suicide et, partant, des suicides. La sociologie inscrit vigoureusement ses hypothèses dans cette voie. Des variables de classe (catégorie socio-professionnelle, âge, genre, diplôme, revenu, nationalité...), des « types de trajectoires » et de « positions » définis sur une ou deux générations deviennent les facteurs explicatifs de typologies des pratiques et des représentations. Des méthodes statistiques évaluent et hiérarchisent ces facteurs, en comparent l'influence ou matérialisent graphiquement la force des liens entre des ensembles de variables, explicatives et dépendantes. Des lois de variation modélisent les évolutions. Mais la technicité de ces applications – les plus sophistiquées surtout – conduit parfois à dire que ces typologies sont rigoureusement et uniquement « descriptives ».
Le fossé qui se creuse entre les modes de production typologique conduit parfois à récuser la démarche typologique qu'on identifie alors aux (trop ambitieuses) macrotypologies ou aux (trop descriptives) typologies des statistiques. Fausse sur le fond, la querelle est symptomatique d'un éclatement, tout comme l'opposition récurrente entre qualitatif et quantitatif qui oublie d'analyser leurs usages complémentaires. Certains, fréquents, conduisent à spécialiser les statistiques dans la caractérisation des « contextes » sociaux et historiques qui cadrent et définissent le « type » de cas traité. D'autres, plus rares malgré la croissance des comparaisons internationales, évaluent à partir du « terrain » la comparabilité des variables des typologies statistiques ou en proposent de nouvelles. Mais un des effets peut-être majeurs de cet éclatement est le développement d'une sociologie typologique de la production sociologique : une analyse réflexive de ses déterminants sociaux et de ses rapports à la science, une auto-analyse.
Bibliographie
H. S. Becker, Outsiders : Studies in the Sociology of Deviance, Free Press, New York, 1963 ; trad. franç. Outsiders. Études de sociologie de la déviance, A.-M. Métaillé, Paris, 1985
P. Bourdieu, La Distinction. Critique sociale du jugement, Minuit, Paris, 1979
P. Bourdieu, J.-C. Chamboredon & J.-C. Passeron, Le Métier de sociologue : préalables épistémologiques, Mouton, Berlin-New York-Paris, 1968
J. C. Combessie, La Méthode en sociologie, coll. Repères, La Découverte, Paris, 1996
É. Durkheim, Les Règles de la méthode sociologique, coll. Quadrige, P.U.F., Paris, 1988 [1re éd. 1895] ; Le Suicide, ibid., 1981 [1re éd. 1897]
E. Goffman, Asylums : Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates, Doubleday Anchor, New York, 1961 (trad. franç. Asiles. Études sur la condition sociale des malades mentaux, Minuit, 1968)
D. Schnapper, La Compréhension sociologique. Démarche de l'analyse typologique, P.U.F., 1999
F. Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft, 1887 (trad. franç. Communauté et société : catégories fondamentales de la sociologie pure, Retz-C.E.P.L., Paris, 1977)
M. Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, 1904-1905 (trad. franç. L'Éthique protestante et l'esprit du capitalisme suivi d'autres essais, Gallimard, Paris, 2003) ; Essais sur la théorie de la science, Paris, Plon, 1965.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean-Claude COMBESSIE : professeur émérite, université de Paris-VIII
Classification
Autres références
-
FOLKLORE
- Écrit par Nicole BELMONT
- 12 230 mots
- 1 média
...finnois Antti Aarne, partant d'un double fait – la variabilité infinie des textes recueillis et leurs ressemblances indéniables –, proposa la notion de conte type, c'est-à-dire une organisation particulière de motifs qui se retrouve dans un certain nombre de contes, les variantes, dont les modifications... -
LIBIDO
- Écrit par Pierre KAUFMANN
- 11 339 mots
- 1 média
... dans la lecture que propose Lacan de la pensée freudienne –, l'appétit sexuel ou libido est alors appelé à s'orienter à la manière de l'aiguille aimantée dans un champ magnétique ; et le spectre des orientations ainsi ouvertes se spécifie en une classification des types libidinaux. -
PSYCHOMOTRICITÉ
- Écrit par Michel BERNARD
- 3 271 mots
...individu a une complexion motrice personnelle qui dépend des réglages variables de ses différentes activités musculaires. C'est ce que Wallon appelle un « type psychomoteur ». Or il y a, selon lui, autant de types qu'il y a de possibilités de défaillance ou d'insuffisance de l'un ou l'autre de ces réglages... -
SOCIÉTÉ
- Écrit par André AKOUN
- 9 309 mots
...sociétés dans lesquelles il voit des réalités. Il ne peut y parvenir qu'à la condition de faire des regroupements à partir de critères jugés pertinents, c'est-à-dire de forger des types. « Il semblait, observe Durkheim dans les Règles de la méthode sociologique, que la réalité sociale ne pouvait...
Voir aussi